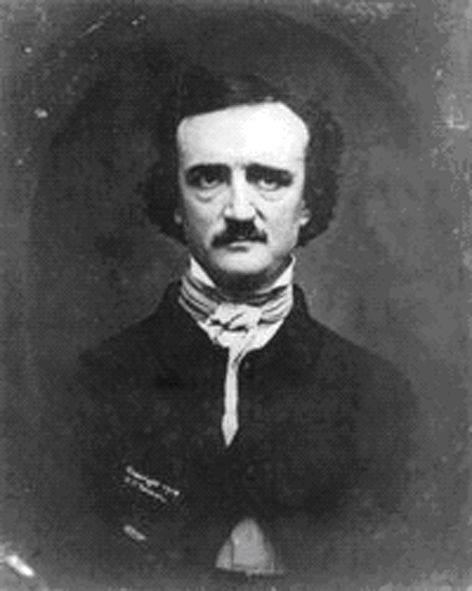A propos de ce blog

Nom du blog :
arcaneslyriques
Description du blog :
Cercle littéraire "Arcanes Lyriques" retranscription des réunions.
Catégorie :
Blog Littérature
Date de création :
13.07.2007
Dernière mise à jour :
16.11.2011

>> Toutes les rubriques <<
· Dossiers (9)
· Contes (4)
· Mythes et Légendes (12)
· Critiques de livres (53)
· Poèmes d'auteurs classiques (65)
· Art pictural et illustration (7)
· Poèmes de nos membres (16)
· Mystères et Enigmes (4)
· Nouvelles d'auteurs classiques (20)
· Cinéma (3)
Accueil
Gérer mon blog
Créer un blog
Livre d'or arcaneslyriques
Contactez-moi !
Faites passer mon Blog !
· Le Romantisme littéraire
· CONTE DE BARBE BLEUE - Explications et Analyse
· La tuberculose, maladie romantique du 19ème siècle
· LE CORBEAU
· Des fleurs pour Algernon
· LA FEMME NUE DES PYRENEES
· LE PHENIX
· LE BARON PERCHE
· POEMES DE JOHN KEATS
· CHARON, passeur d'âmes
· La nuit de décembre
· LA MOLDAU
· LE CORBEAU D'EDGAR ALLAN POE
· CARLOS SCHWABE - La Mort du fossoyeur
· LE GOLEM
· chaosdei
· elissandre
· nosferatuttiquanti
Statistiques 209 articles
bonsoir à tous j'ai rêver d'un phoenix rouge qui lâche une bombe atomique dans la mer provocant un tsunami. j'
Par Samba, le 19.04.2025
puisque j'ai mis ma ***** sur tes lèvres
Par Anonyme, le 11.05.2024
puisque j'ai mis ma **** sur tes lèvres
Par Anonyme, le 11.05.2024
que dire de plus un jour peut-être il nous refera un album c'est un poète magnifique sensible j'aime beaucoup
Par Anonyme, le 22.03.2024
merci j'ai beaucoup aimé votre résumé grâce à vous j'ai compris l'histoire en 3minute au lieu de 5h de lecture
Par Anonyme, le 09.01.2023

Nouvelles d'auteurs classiques
LE VAMPIRE
De John William Polidori (1795-1821)
Dans ce temps-là parut au milieu des dissipations d’un hiver à Londres, et parmi les nombreuses assemblées que la mode y réunit à cette époque, un lord plus remarquable encore par ses singularités que par son rang. Son œil se promenait sur la gaieté générale répandue autour de lui, avec cette indifférence qui dénotait que la partager n’était pas en son pouvoir. On eût dit que le sourire gracieux de la beauté, savait seul attirer son attention, et encore n’était-ce que pour le détruire sur ses lèvres charmantes, par un regard, et glacer d’un effroi secret un cœur où jusqu’alors l’idée du plaisir avait régné uniquement. Celles qui éprouvaient cette pénible sensation de respect ne pouvaient se rendre compte d’où elle provenait. Quelques-unes, cependant, l’attribuaient à son œil d’un gris mort que, lorsqu’il se fixait sur les traits d’une personne, semblait ne pas pénétrer, au fond des replis du cœur, mais plutôt paraissait tomber sur la joue comme un rayon de plomb qui pesait sur la peau sans pouvoir la traverser. Son originalité le faisait inviter partout : chacun désirait le voir, et tous ceux qui avaient été longtemps habitués aux violentes émotions, mais à qui la satiété faisait sentir enfin le poids de l’ennui, se félicitaient de rencontrer quelque chose capable de réveiller leur attention languissante. Sa figure était régulièrement belle, nonobstant le teint sépulcral qui régnait sur ses traits, et que jamais ne venait animer cette aimable rougeur fruit de la modestie, ou des fortes émotions qu’engendrent les passions. Ces femmes à la mode avides d’une célébrité déshonorante, se disputèrent, à l’envi, sa conquête, et à qui du moins obtiendrait de lui quelque marque de ce qu’elles appellent penchant. Lady Mercer qui, depuis son mariage, avait eu la honteuse gloire d’effacer, dans les cercles, la conduite désordonnée de toutes ses rivales, se jeta à sa rencontre, et fit tout ce qu’elle pût, mais en vain, pour attirer son attention. Toute l’impudence de lady Mercer échoua, et elle se vit réduite à renoncer à son entreprise. Mais quoi qu’il ne daignât pas même accorder un regard aux femmes perdues qu’il rencontrait journellement, la beauté ne lui était cependant pas indifférent ; et pourtant encore, quoi qu’il ne s’adressât jamais qu’à la femme vertueuse ou à la fille innocente, il le faisait avec tant de mystère que peu de personnes même savaient qu’il parlât quelquefois au beau sexe. Sa langue avait un charme irrésistible : soit donc qu’il réussit à comprimer la crainte qu’inspirait son premier abord, soit à cause de son mépris apparent pour le vice, il était aussi recherché par ces femmes dont les vertus domestiques sont l’ornement de leur sexe, que par celles qui en font le déshonneur.
Vers ce même temps vint à Londres un jeune homme nommé Aubrey : la mort de ses parents l’avait, encore enfant, laissé orphelin, avec une sœur et de grands biens. Ses tuteurs, occupés exclusivement au soin de sa fortune, l’abandonnèrent à lui-même, ou du moins remirent la charge plus important de former son esprits, à des mercenaires subalternes. Le jeune Aubrey songea plus à cultiver son imagination que son jugement. De là, il prit ces notions romantiques d’honneur et de candeur qui perdent tant de jeunes écervelés. Il croyait que le cœur humain sympathise naturellement à la vertu, et que le vice n’a été jeté ça et là, par la Providence, que pour varier l’effet pittoresque de la scène : il croyait que la misère d’une chaumière n’était qu’idéale, les vêtements du paysan étant aussi chauds que ceux de l’homme voluptueux ; mais mieux adaptés à l’œil du peintre, par leurs plis irréguliers et leurs morceaux de diverses couleurs, pour représenter les souffrances du pauvre. Enfin, il croyait qu’on devait chercher les réalités de la vie dans les rêves singuliers et brillants des poètes. Il était beau, sincère et riche : par tous ces motifs, dès son entrée dans le monde, un grand nombre de mères l’environnèrent, s’étudiant à qui lui ferait les portraits les plus faux des qualités qu’il faut pour plaire ; tandis que leurs filles, par leur contenance animée, quand il s’approchait d’elles, et leurs yeux pétillant de plaisir, quand il ouvrait la bouche, l’entraînèrent bientôt dans une opinion trompeuse de ses talents et de son mérite ; et bien que, rien dans le monde ne vint réaliser le roman qu’il s’était créé dans sa solitude, sa vanité satisfaite fut une espèce de compensation de ce désappointement. Il était au moment de renoncer à ses illusions, lorsque l’être extraordinaire que nous venons de décrire vint le croiser dans sa carrière.
Frappé de son extérieur, il l’étudia et l’impossibilité même de reconnaître le caractère d’un homme entièrement absorbé en lui-même, et qui ne donnait d’autre signe de son attention à ce qui se passait autour de lui, que son soin d’éviter tout contact avec les autres, avouant par là tacitement leur existence, cette impossibilité même permit à Aubrey de donner cours à son imagination pour se créer un portrait qui flattait son penchant, et immédiatement il revêtit ce singulier personnage de toutes les qualités d’un héros de roman, et se détermina à suivre en lui la créature de son imagination plutôt que l’être présent à ses yeux. Il eût des attentions pour lui, et fit assez de progrès dans cette liaison, pour en être du moins remarqué chaque fois qu’ils se trouvaient ensemble. Bientôt il apprit que les affaires de lord Ruthven étaient embarrassées, et, d’après les préparatifs qu’il vit dans son hôtel, s’aperçut qu’il allait voyager.
Avide de plus précises informations sur cet étrange caractère qui, jusqu’à présent, avait seulement aiguillonné sa curiosité, sans aucun moyen de la satisfaire, Aubrey fit sentir à ses tuteurs qu’il était temps pour lui de commencer son tour d’Europe, coutume adoptée depuis nombre d’années par nos jeunes gens de famille, et qui ne leur offre que trop souvent l’occasion de s’enfoncer rapidement dans la carrière du vice, en croyant se mettre sur un pied d’égalité avec les personnes plus âgées qu’eux, et en espérant paraître comme elles au courant de toutes ces intrigues scandaleuses, sujet éternel de plaisanteries ou de louanges, suivant le degré d’habileté déployée dans leur conduite. Les tuteurs d’Aubrey donnèrent leur assentiment, et immédiatement il fit part de ses intentions à lord Ruthven dont il fut agréablement surpris de recevoir une invitation à voyager avec lui. Aubrey flatté d’une telle marque d’estime d’un homme qui semblait n’avoir rien de commun avec l’espèce humaine, accepta cette proposition avec empressement, et quelques jours après, nos deux voyageurs avaient passé la mer. Jusqu’ici Aubrey n’avait pas eu occasion d’étudier à fond le caractère de lord Ruthven, et maintenant il s’aperçut que, bien que témoin d’un plus grand nombre de ses actions, les résultats lui offraient différentes conclusions à tirer des motifs apparents de sa conduite : son compagnon de voyage poussait la libéralité jusqu’à la profusion : le fainéant, le vagabond, le mendiant recevait de lui des secours plus que suffisants pour soulager ses besoins immédiats : mais Aubrey remarquait avec peine, que ce n’était pas sur les gens vertueux, réduits à l’indigence par des malheurs, et non par le vice, qu’il versait ses aumônes : en repoussant ces infortunés de sa porte, il avait peine à supprimer de ses lèvres un sourire dur ; mais quand l’homme sans conduite venait à lui, non pour obtenir un soulagement de ses besoins, mais pour se procurer les moyens de se plonger plus avant dans la débauche et dans la dépravation, il s’en retournait toujours avec un don somptueux. Aubrey, cependant, croyait devoir attribuer cette distribution déplacée des aumônes de lord Ruthven à l’importunité plus grande des gens vicieux, qui trop souvent réussit de préférence à la modeste timidité du vertueux indigent. Néanmoins, à la charité de lord Ruthven se rattachait une circonstance qui frappait encore plus vivement l’esprit d’Aubrey : tous ceux en faveur de qui cette générosité s’exerçait, éprouvait invariablement qu’elle était accompagnée d’une malédiction inévitable ; tous, bientôt, finissaient par monter sur l’échafaud, ou par périr dans la misère la plus abjecte : à Bruxelles, et autres villes qu’ils traversèrent, Aubrey vit avec surprise l’espèce d’avidité avec laquelle son compagnon recherchait le centre de la dépravation : dans les maisons de jeu, il s’élançait de suite à la table de Pharaon ; il pariait et jouait toujours avec succès, excepté lorsqu’il avait affaire à l’escroc connu, et alors il perdait plus qu’il ne gagnait ; mais c’était toujours sans changer de visage, et avec cet air indifférent qu’il portait partout, mais non lorsqu’il rencontrait le jeune homme sans expérience, ou le père infortuné d’une nombreuse famille ; alors la fortune semblait être dans ses mains : il mettait de côté cette impassibilité qui lui était ordinaire, et son œil étincelait de plus de feu que n’en jette celui du chat, au moment où il roule entre ses pattes la souris déjà à moitié morte. Au sortir de chaque ville, il laissait le jeune homme, riche avant son arrivée, maintenant arraché du cercle dont il faisait l’ornement, maudissant, dans la solitude d’un cachot, son destin qui l’avait mis à portée de l’influence pernicieuse de ce mauvais génie ; tandis que le père, désolé et l’œil hagard, pleurait assis au milieu de ses enfants affamés, sans avoir conservé, de son immense fortune, une seule obole pour apaiser leurs besoins dévorants. Lord Ruthven cependant ne sortait pas finalement plus riche des tables de jeu, mais perdait immédiatement, contre le destructeur de la fortune d’un grand nombre de malheureux, la dernière pièce d’argent qu’il venait d’arracher à l’inexpérience, ce qui ne pouvait provenir que de ce qu’il possédait un certain degré d’habileté incapable toutefois de lutter contre l’astuce des escrocs expérimentés. Aubrey souvent fut sur le point de faire là-dessus des représentations à son ami, et de le prier en grâce de renoncer à l’exercice d’une charité et d’un passe-temps qui tournaient à la ruine de tous sans lui être du moindre avantage à lui-même : mais il différait de jour en jour ses représentations, se flattant à chaque moment que son ami lui donnerait enfin quelque occasion de lui ouvrir son cœur franchement et sans réserve ; toutefois cette occasion ne se présentait jamais. Lord Ruthven, dans sa voiture, et quoique traversant sans cesse de nouvelles scènes intéressantes de la nature, restait toujours le même : ses yeux parlaient encore moins que ses lèvres ; et bien que vivant avec l’objet qui excitait si vivement sa curiosité, Aubrey n’en recevait qu’un constant aiguillon à son impatience de percer le mystère qui enveloppait un être que son imagination exaltée se représentait de plus en plus comme surnaturel.
Bientôt ils arrivèrent à Rome, et Aubrey, pour quelque temps, perdit de vue son compagnon ; il le laissa suivant assidûment le cercle du matin d’une comtesse italienne, tandis que lui-même se livrait à la recherche d’anciens monuments des arts. Cependant, des lettres lui parvinrent d’Angleterre ; il les ouvrit avec impatience. L’une était de sa sœur, et ne renfermait que l’expression d’une tendre affection ; les autres étaient de ses tuteurs, et leur contenu eut lieu de frapper son attention : si déjà, auparavant, son imagination avait supposé qu’une influence infernale résidait dans son compagnon, ces lettres durent bien fortifier ce pressentiment. Ses tuteurs insistaient pour qu’il se séparât immédiatement de son ami, dont le caractère, disaient-ils, joignait à une extrême dépravation, des pouvoirs irrésistibles de séduction qui rendaient tout contact avec lui d’autant plus dangereux. On avait découvert, depuis son départ, que ce n’était pas par haine pour le vice des femmes perdues, qu’il avait dédaigné leurs avances ; mais que pour que ses désirs fussent pleinement satisfaits, il fallait qu’il rehaussât le plaisir de ses sens par le barbare accompagnement d’avoir précipité sa victime, la compagne de son crime, du pinacle d’une vertu intacte au fond de l’abîme de l’infamie et de la dégradation. On avait même remarqué que toutes les femmes qu’il avait recherchées en apparence, à cause de leur chaste conduite, avaient, depuis son départ, mis le masque de côté, et exposé sans scrupule, au public, toute la difformité de leurs mœurs.
Aubrey se décida à se séparer d’un personnage dont le caractère ne lui avait pas encore présenté un seul point de vue brillant. Il se détermina à inventer quelque prétexte plausible pour l’abandonner tout-à-fait, se proposant, dans l’intervalle, de le veiller de plus près, et de faire attention aux moindres circonstances. Il entra dans le même cercle de sociétés que lord Ruthven, et ne fut pas long à s’apercevoir que son compagnon cherchait à abuser de l’inexpérience de la fille de la dame dont il fréquentait surtout la maison. En Italie, il est rare qu’on rencontre dans le monde les jeunes personnes encore à marier. Lord Ruthven était donc obligé de mener cette intrigue à la dérobée ; mais l’œil d’Aubrey le suivait dans tous ses détours, et bientôt il découvrit qu’une entrevue avait été fixée, et il ne prévit que trop que la ruine totale de cette jeune imprudente en serait le résultat infaillible. Sans perdre un seul instant, il entra dans le cabinet de son compagnon, et le questionna brusquement sur ses intentions à l’égard de la jeune personne, le prévenant en même temps qu’il savait de source certaine qu’il devait avoir un rendez-vous avec elle cette même nuit. Lord Ruthven répliqua que ses intentions étaient celles naturelles en pareil cas ; et étant pressé de déclarer s’il avait des vues légitimes, sa seule réponse fut un malin sourire. Aubrey se retira, et lui ayant de suite écrit quelques lignes pour l’informer qu’à compter de cette heure il renonçait à l’accompagner, suivant leur accord, dans le reste de ses voyages, il ordonna à son domestique de lui procurer d’autres appartements, et se rendit lui-même, sans perdre une minute, chez la mère de la jeune personne, pour lui faire part, non seulement de ce qu’il avait appris sur sa fille, mais aussi de tout ce qu’il savait de défavorable aux mœurs de lord Ruthven. Cet avis vint à temps pour faire manquer le rendez-vous projeté. Lord Ruthven, le lendemain, écrivit à Aubrey, pour lui notifier son assentiment à leur séparation ; mais ne lui donna pas même à entendre qu’il le soupçonnait d’être la cause du renversement de ses plans.
Aubrey, au sortir de Rome, dirigea ses pas vers la Grèce, et traversant le golfe, se vit bientôt à Athènes. Il y choisit pour sa résidence la maison d’un Grec, et ne songea plus qu’à rechercher les traces d’une gloire passée sur des monuments qui, honteux sans doute d’exposer le souvenir des grandes actions d’hommes libres, aux yeux d’un peuple esclave, semblent chercher un refuge dans les entrailles de la terre, ou se dérober aux regards sous une mousse épaisse. Sous le même toit que lui, respirait une jeune fille de formes si belles et si délicates, qu’elle aurait offert à l’artiste le plus digne modèle pour représenter une de ces houris que Mahomet promet, dans son paradis, au crédule Musulman ; mais, non ! ses yeux possédaient une expression qui ne peut appartenir à des beautés que le Prophète représente comme n’ayant pas d’âme. Lorsqu’Ianthe dansait sur la plaine, ou effleurait dans sa marche rapide, le penchant des collines, elle faisait oublier la légèreté gracieuse de la gazelle. Et quel autre qu’un disciple d’Épicure, en effet, n’eût pas préféré le regard animé et céleste de l’une à l’œil voluptueux mais terrestre de l’autre ? Cette nymphe aimable, souvent accompagnait Aubrey dans ses recherches d’antiquités. Que de fois, ignorante de ses propres charmes, et toute entière à la poursuite du brillant papillon, elle développait toute la beauté de sa taille enchanteresse, flottant, en quelque sorte, au gré du zéphir, aux regards avides du jeune étranger, qui oubliait les lettres, presque effacées par le temps, qu’il venait avec peine de déchiffrer sur le marbre, pour ne plus contempler que ses formes ravissantes : que de fois, tandis qu’Ianthe voltigeait à l’entour, sa longue chevelure flottant sur ses épaules, par ses tresses onduleuses d’un blond céleste, n’offrait que trop d’excuse à Aubrey pour abandonner ses poursuites scientifiques, et laisser échapper de son idée le texte d’une inscription qu’il venait de découvrir, et qu’un instant auparavant son utilité, pour l’interprétation d’un passage de Pausanias, avait rendue à ses yeux de la plus haute importance. Mais pourquoi tenter de décrire des charmes plus aisés à sentir qu’à apprécier ? Innocence, jeunesse, beauté, tout respirait en elle cette fraîcheur de la nature, étrangère à l’affectation de nos salons à la mode.
Lorsqu’Aubrey dessinait ces augustes débris, dont il désirait conserver l’image pour l’amusement de ses heures futures, Ianthe, debout, et penchée sur son épaule, suivait avec avidité les progrès magiques de son pinceau, retraçant les sites pittoresques des lieux où elle était née. Elle lui racontait alors, avec tout le feu d’une mémoire encore toute fraîche, ses compagnes foulant avec elle, dans leur danse légère, la verte pelouse des environs, ou la pompe des fêtes nuptiales, dont elle avait été témoin dans son enfance. Quelquefois encore, tournant ses souvenirs sur des objets qui évidemment lui avaient laissé une impression plus profonde, elle lui redisait les contes surnaturels dont sa nourrice avait effrayé sa jeune attention. Son ton sérieux et son air de sincérité, quand elle faisait ce récit, excitaient une tendre compassion pour elle, dans le cœur d’Aubrey : souvent même, comme elle lui décrivait le Vampire vivant qui avait passé des années au milieu d’amis, et des plus tendres objets d’attachement, forcé chaque an, par un pouvoir infernal, de prolonger son existence pour les mois suivants, par le sacrifice de quelque jeune et innocente beauté, Aubrey sentait son sang se glacer dans ses veines, tout en essayant de tourner en ridicule de si horribles fables ; mais Ianthe en réponse lui citait le nom de vieillards qui avaient fini par découvrir un Vampire vivant au milieu d’eux, seulement après que plusieurs de leurs filles avaient succombé victimes de l’horrible appétit de ce monstre ; et, poussée à bout par son apparente incrédulité, elle le suppliait ardemment de prêter foi à ses récits ; car on avait remarqué, ajoutait-elle, que ceux qui osaient douter de l’existence des Vampires, ne pouvaient éviter quelque jour d’être convaincus de leur erreur par leur propre et funeste expérience. Ianthe lui dépeignait l’extérieur que l’on accordait à donner à ces monstres, et l’impression d’horreur qui avait déjà frappé l’esprit d’Aubrey, redoublait encore par un portrait qui lui rappelait, d’une manière effrayante, lord Ruthven. Il persistait néanmoins dans ses efforts pour lui persuader de renoncer à des terreurs aussi vaines, quoiqu’en lui-même il frémit de reconnaître ces mêmes traits, qui avaient tous tendu à lui faire voir quelque chose de surnaturel dans lord Ruthven.
Aubrey, de jour en jour, s’attachait davantage à Ianthe ; son innocence, si différente de ces vertus affectées qu’il avait rencontrées jadis dans ces femmes, parmi lesquelles il avait cherché à retrouver ces notions romanesques sucées dans son jeune âge, séduisait incessamment son cœur ; et tandis qu’il se représentait à lui-même le ridicule d’une union conjugale entre un jeune homme élevé suivant les usages de l’Angleterre, et une jeune Grecque sans éducation, il sentait s’accroître de plus en plus son affection pour la jeune enchanteresse avec qui s’écoulaient tous ces moments. Quelquefois il voulait s’éloigner d’elle ; et, bâtissant un plan de recherches d’antiquités, il projetait de partir, décidé à ne pas reparaître à Athènes avant d’avoir rempli l’objet de son excursion ; mais il trouvait toujours impossible de fixer son attention sur les ruines des environs, tandis que l’image fraîche d’Ianthe vivait au fond de son cœur. Ignorant l’amour qu’elle lui avait inspiré, elle avait toujours avec lui cette même franchise enfantine, qu’elle lui avait montrée dès le premier abord. Elle semblait toujours ne se séparer de lui qu’avec une extrême répugnance ; mais c’était uniquement parce qu’elle n’avait plus alors de compagnon pour parcourir avec elle ces sites favoris où elle errait, tandis que non loin d’elle Aubrey s’occupait à retracer ou découvrir quelque fragment échappé à la faux destructive du temps. Elle avait appelé en témoignage de ce qu’elle avait raconté à Aubrey, au sujet des Vampires, son père et sa mère, qui tous deux, ainsi que plusieurs autres personnes présentes, avaient affirmé leur existence, en pâlissant d’horreur à ce nom seul. Peu de temps après, Aubrey se décida à entreprendre une petite excursion qui devait l’occuper plusieurs heures : lorsque ses hôtes l’entendirent désigner l’endroit, d’un commun accord ils se hâtèrent de le supplier de revenir à Athènes avant la nuit tombante ; car il devait, lui dirent-ils, traverser nécessairement un bois où nul Grec ne se hasarderait à entrer, pour aucune considération au monde, après le coucher du soleil. Ils le lui dépeignirent comme le repaire des Vampires dans leurs orgies nocturnes, et le menacèrent des malheurs les plus épouvantables, s’il osait troubler, par son passage, ces monstres dans leur cruelle fête. Aubrey traita légèrement leurs représentations, et essaya même de leur faire sentir toute l’absurdité de pareilles idées ; mais pourtant, quand il les vit tressaillir de terreur à son audacieux mépris d’un pouvoir infernal et irrésistible, dont le nom seul suffisait pour les faire frissonner, il se tut.
Le lendemain matin Aubrey se mit en route sans suite ; à son départ, il observa avec peine et surprise l’air mélancolique de ses hôtes, et l’impression de terreur que ses railleries sur l’existence des Vampires avait répandue sur leurs traits. A l’instant même où il montait à cheval, Ianthe vint près de lui, et d’un ton sérieux le conjura, par tout ce qu’il avait de plus cher au monde, de retourner à Athènes avant que la nuit vînt rendre à ces monstres leur pouvoir. Il promit de lui obéir : mais ses recherches scientifiques absorbèrent tellement son esprit qu’il ne s’aperçut même pas que le jour était prêt à finir, et qu’à l’horizon se formait une de ces taches qui, dans ces brûlants climats, grossirent avec une telle rapidité que, bientôt devenues une masse épouvantable, elles versent sur la campagne désolée toute leur rage. A la fin cependant il se décida à remonter à cheval, et à compenser, par la vitesse de son retour, le temps perdu. Mais il était trop tard. Le crépuscule est, pour ainsi dire, inconnu dans ces contrées méridionales, et la nuit commence avec le coucher du soleil. Avant qu’Aubrey fut loin dans la forêt, l’orage avait éclaté sur sa tête avec fureur. Le tonnerre grondait coup sur coup, et répété par les nombreux échos d’alentour, ne laissait presque point d’intervalle de silence. La pluie, tombant à torrent, forçait son passage jusqu’à Aubrey à travers l’épais couvert du feuillage, tandis que les éclairs brillaient autour de lui, et que la foudre même venait quelque fois éclater à ses pieds. Son coursier épouvanté tout à coup l’emporta à travers le plus épais du bois. L’animal hors d’haleine à la fin s’arrêta, et Aubrey, à la lueur des éclairs, remarqua près de lui une hutte presque enterrée sous des masses de feuilles mortes et de broussailles, qui l’enveloppaient de tout côté. Aubrey descendit de cheval, et approcha de la hutte, espérant y trouver quelqu’un qui lui servirait de guide jusqu’à la ville, ou du moins s’y procurer un abri contre la tempête. Au moment où il s’en approchait, le tonnerre s’étant ralenti pour quelques instants, il put distinguer les cris perçants d’une femme répondus par un rire amer et presque continu : Aubrey tressaillit, et hésita s’il entrerait ; mais un éclat de tonnerre, qui soudain gronda de nouveau sur sa tête, le tira de sa rêverie ; et, par un effort de courage, il franchit le seuil de la hutte. Il se trouva dans la plus profonde obscurité ; le bruit qui se prolongeait lui servit pourtant de guide ; personne ne répondait à son appel réitéré. Tout à coup il heurta quelqu’un qu’il arrêta sans balancer ; quand une voix horrible fit entendre ces mots : Encore troublé…auxquelles succéda un éclat de rire affreux ; et Aubrey se sentit saisi avec une vigueur qui lui parut surnaturelle. Décidé à vendre chèrement son existence, il lutta, mais en vain : ses pieds perdirent, en un instant, le sol ; et, enlevé par une force irrésistible, il se vit précipiter contre la terre, qu’il mesura de tout son corps. Son ennemi se jeta sur lui ; et, s’agenouillant sur sa poitrine, portait déjà ses mains à sa gorge, quand la réverbération d’un grand nombre de torches, pénétrant dans la hutte par une ouverture destinée à l’éclairer pendant le jour, vint troubles le monstre dans son épouvantable orgie ; il se hâta de se relever, et, laissant là sa proie, s’élança hors de la porte : le bruit qu’il fît en s’ouvrant un passage à travers l’épaisse bruyère cessa au bout de quelques instants.
L’orage cependant s’était calmé tout à fait, et les nouveaux venus purent entendre, du dehors, les plaintes d’Aubrey que l’épuisement total de ses forces empêchait de remuer. Ils entrèrent dans la hutte : la lumière de leurs torches vint se réfléchir sur ses voûtes mousseuses, et ils se virent tous couverts de flocons d’une suie épaisse. A la prière d’Aubrey ils s’éloignèrent de lui pour chercher la femme dont les cris l’avaient attiré ; et comme ils s’avançaient sous les replis caverneux de la hutte, il se vit replonger encore dans les plus profondes ténèbres ; mais bientôt de quelle horreur ne fût-il pas frappé quand, à la lueur des torches qui revenaient fondre sur lui, il reconnut le corps inanimé de la charmante Ianthe, porté par ses compagnons ! Vainement il ferma les yeux, se flattant que ce n’était qu’une vision, fruit de son imagination dérangée ; mais quand il les rouvrit, il revit encore les restes de son amante étendus sur la terre à côté de lui : ces joues arrondies et ces lèvres délicates, qui naguère auraient fait honte à la rose par leur fraîcheur, étaient maintenant d’une pâleur sépulcrale : et cependant encore il régnait à présent, sur les traits charmants d’Ianthe, un calme admirable et presque aussi attachant que la vie qui jadis les animait : sur son cou et sa poitrine on voyait des traces de sang, et sa gorge portait les empreintes des dents cruelles qui avaient ouvert ses veines ; les villageois avaient porté le corps, indiquant du doigt ces marques funestes, et comme frappés simultanément d’horreur, s’écrièrent : Un Vampire ! un Vampire ! Ils formèrent à la hâte une litière, et placèrent dessus Aubrey à côté de celle qui naguère avait été pour lui l’objet des rêves de félicité les plus flatteurs, mais dont maintenant la vie venait de s’éteindre dans sa fleur. Aubrey ne pouvait plus retrouver le fil de ses idées, ou plutôt semblait chercher un refuge contre le désespoir dans une totale absence de pensées. Il tenait, presque sans le savoir dans sa main, un poignard nu d’une forme extraordinaire, qu’on avait ramassé dans la hutte : bientôt le triste cortège fut rencontré par d’autres paysans, qu’une mère alarmée envoyait encore à la recherche de son enfant chérie : mais les cris lamentables que poussait la troupe désolée, au moment où ils approchaient de la ville, furent pour cette mère et son époux infortuné l’avant-courreur de quelque horrible catastrophe. Décrire l’angoisse de leur attente inquiète serait impossible ; mais quand ils eurent découvert le corps de leur fille adorée, ils regardèrent Aubrey, lui firent remarquer du doigt les indices affreux de l’attentat qui avait causé sa mort, et tous deux expirèrent de désespoir.
Aubrey étendu sur sa couche de douleur et en proue à une fièvre ardente, au milieu des accès de son délire, appelait lord Ruthven et Ianthe. Quelquefois il suppliait son ancien compagnon d’épargner celle qu’il aimait : d’autres fois il accumulait les imprécations sur sa tête, et le maudissait comme le destructeur de sa félicité. Lord Ruthven se trouvait justement alors à Athènes ; et, ayant eu connaissance de la triste situation d’Aubrey, pour quelque motif secret, vint se loger sous le même toit, et devint son compagnon assidu. Quand son ami sortit de son délire, il tressaillit d’horreur à l’aspect de celui dont l’image s’était maintenant confondue dans sa tête avec l’idée d’un Vampire ; mais lord Ruthven, par son ton persuasif, ses demi-aveux qu’il regrettait la faute qui avait causé leur séparation, et encore plus par les attentions soutenues, l’anxiété et les soins qu’il prodigua à Aubrey, le réhabilita bientôt à sa présence. Lord Ruthven semblait tout-à-fait changé ; ce n’était plus cet être dont l’apathie avait tellement étonné Aubrey ; mais aussitôt que ce dernier commença à faire des progrès rapides dans sa convalescence, il s’aperçut avec chagrin que son compagnon retombait dans son phlegme ordinaire, et il retrouva en lui tout-à-fait l’homme de leur première liaison, si ce n’est que de temps à autre, Aubrey observait avec surprise que lord Ruthven semblait fixer sur lui un regard pénétrant, tandis qu’un sourire cruel de dédain voltigeait sur ses lèvres. Il se perdait en conjectures sur l’intention de cet affreux sourire, si souvent réitéré. Lorsqu’Aubrey entra dans le dernière période de son rétablissement, lord Ruthven s’éloignant de plus en plus de lui, semblait exclusivement occupé à contempler les vagues soulevées par la brise rafraîchissante, ou à suivre la marche de ces planètes, qui, ainsi que notre globe, meuvent autour d’un astre immobile ; mais le fait qu’il semblait chercher principalement à se soustraire aux yeux de tous.
La tête d’Aubrey avait été très affaiblie par le choc qu’il venait d’éprouver ; et cette élasticité d’esprit, qui avait tant brillé en lui jadis, semblait s’être évanouie pour toujours. Il était maintenant aussi épris de la solitude et du silence que lord Ruthven lui-même. Mais c’est en vain qu’il soupirait après cette solitude ; pouvait-elle exister pour lui dans le voisinage d’Athènes ? La cherchait-il parmi ces ruines qu’il avait jadis fréquentées, l’image d’Ianthe l’y accompagnait comme autrefois ; la cherchait-il au fond des bois, il s’imaginait y voir encore la démarche légère d’Ianthe, voltigeant au milieu des taillis, à la découverte de la modeste violette ; quand par une transition subite, sa sombre imagination lui représentait son amante, la figure pâle, la gorge soignante, et ses lèvres décolorées, mais qu’un sourire toujours aimable, malgré le trépas, venait encore orner.
Il se détermina enfin à fuir des sites dont chaque trait était, pour sa raison affaiblie, une source de tableaux douloureux. Il proposa à lord Ruthven, qu’il croyait ne devoir point quitter, après tous les soins qu’il en avait reçus pendant son indisposition, de visiter ensemble ces parties de la Grèce qui leur étaient encore inconnues à tous deux. Ils partirent donc, et allèrent à la recherche de chaque lieu auquel se rattachait un ancien souvenir ; mais, quoiqu’ils courussent constamment d’une place à une autre, ils ne semblaient cependant, ni l’un ni l’autre, prêter une attention réelle aux objets variés qui passaient sous leurs yeux. Ils entendaient souvent parler de voleurs infestant le pays ; mais, graduellement, ils en vinrent à mépriser ces rapports, qu’ils regardaient comme une pure invention de gens intéressés à exciter la générosité de ceux qu’ils défendaient de prétendus dangers. Entre autres occasions, ils voyageaient un jour avec une garde si peu nombreuse, qu’elle pouvait plutôt servir de guide que de défense. Au moment, cependant, où ils venaient d’entrer dans un étroit défilé, au fond duquel était le lit d’un torrent qui roulait, confondu avec des masses de roc, dans les précipices voisins, ils eurent raison de regretter leur imprudente confiance ; à peine étaient-ils engagés dans ce pas dangereux, qu’une grêle de balles vint siffler à leurs oreilles, tandis que les échos d’alentour répétaient le son de plusieurs armes à feu. Bientôt une balle vint se loger dans l’épaule de lord Ruthven, qui tomba du coup. Aubrey vola à son assistance ; et, ne songeant plus à se défendre, ni à son propre péril, se vit bientôt entouré par les brigands. L’escorte, aussitôt qu’elle avait vu tomber lord Ruthven, avait jeté ses armes et demandé quartier. Par la promesse d’une forte récompense, Aubrey décida les voleurs à transporter son ami blessé, à une cabane voisine ; et, étant convenu avec eux d’une rançon, il ne fut plus importuné de leur présence, les bandits se bornant à surveiller la chaumière jusqu’au retour de l’un d’eux, qui alla recevoir, dans une ville voisine, le montant d’une traite qu’Aubrey leur donna sur son banquier.
Les forces de lord Ruthven déclinèrent rapidement ; au bout de deux jours la gangrène parut, et l’instant de sa dissolution sembla s’avancer à grand pas. Sa manière d’être et ses traits étaient toujours les mêmes. On aurait dit qu’il était aussi indifférent à la douleur, qu’il l’avait été autrefois à tout ce qui se passait autour de lui : mais, vers la fin de la seconde soirée, il sembla préoccupé de quelque idée pénible ; ses yeux se fixaient souvent sur Aubrey, qui, s’en apercevant, lui offrit, avec chaleur, son assistance. Vous voulez m’assister, lui dit son ami ! vous pouvez me sauver ! vous pouvez faire plus encore ! Je ne parle pas de ma vie ; je regarde d’un œil aussi insouciant le terme de mon existence, que celui du jour prêt à finir ! mais vous pouvez sauver mon honneur, l’honneur de votre ami ! Comment ! oh ! dites-moi comment ! lui répondit Aubrey, je ferais tout au monde pour vous être utile. Je n’ai que peu de chose à vous demander, répliqua lord Ruthven. Ma vie décline rapidement, et il me manque le temps pour vous développer toute mon idée ; mais si vous vouliez cacher tout ce que vous savez de moi, mon honneur serait, dans le monde, à l’abri de toute atteinte : et si ma mort était ignorée pour quelque temps en Angleterre… Je la cacherai, dit Aubrey ! Mais ma vie ! s’écria lord Ruthven ! j’en tairai l’histoire, ajouta Aubrey… Jurez donc, cria son ami expirant, se relevant par le dernier effort d’une avide joie ; jurez par tout ce que votre âme révère ou redoute ; jurez que pour un an et un jour, vous garderez un secret inviolable sur tout ce que vous savez de mes crimes, et sur ma mort, vis-à-vis de quelque personne que ce puisse être, quelque chose qui puisse arriver, quelque objet qui puisse arriver, quelque objet extraordinaire enfin qui puisse frapper vos regards : En prononçant ces mots, ses yeux pétillant semblaient sortir de leurs orbites. Je le jure, dit Aubrey… et lord Ruthven, retombant sur son chevet, avec un éclat de rire horrible, exhala son dernier soupir. Aubrey se retira dans son appartement, pour se reposer ; mais il n’y put trouver le sommeil. Les circonstances extraordinaires qui avaient accompagné toute sa liaison avec lord Ruthven se pressaient involontairement dans sa mémoire frappée ; et quand il en venait à son serment, un frissonnement irrésistible s’emparait de lui, comme un pressentiment de quelque chose d’horrible qui l’attendait. S’étant levé de bonne heure le lendemain, au moment où il allait entrer dans la chambre où il avait laissé le corps de son ami, il rencontra un des bandits qui le prévint qu’il n’était plus à cette place, et qu’avec l’aide de ses compagnons, il avait transporté le cadavre immédiatement après qu’Aubrey s’était retiré chez lui, et suivant la promesse qu’ils en avaient faite à lord Ruthven, sur le sommet d’une colline voisine, afin de l’y exposer au premier pâle rayon de la lune, qui se lèverait après sa mort. Aubrey, surpris, et prenant avec lui quelques-unes de ces hommes, se décida à gravir cette colline, et à s’y ensevelir, sur le lieu même, son compagnon ; mais quand il eut atteint le faîte de la montagne, il n’y trouva de trace, ni du corps ni des vêtements, quoique les bandits lui assurassent qu’il était sur la roche même où ils avaient déposé les restes de lord Ruthven. D’abord, son esprit se perdait en conjectures sur cet étrange événement ; mais il finit par se persuader, en retournant chez lui, que les voleurs avaient tout simplement enseveli le corps pour s’approprier les vêtements.
Las d’une contrée où il avait rencontré de si terribles catastrophes, et où tout semblait conspirer pour approfondir cette mélancolie superstitieuse qui avait frappé son esprit, il prit le parti de s’éloigner de la Grèce, et bientôt arriva à Smyrne. Tandis qu’il y attendait un navire pour le transporter à Otrante ou à Naples, il s’occupa de l’inspection des divers effets qui avaient appartenu à lord Ruthven : entre autres choses, il remarqua une caisse contenant des armes offensives, toutes singulièrement adaptées pour porter une prompte mort dans le sein de ses victimes. Il observa plusieurs poignards ; et, pendant qu’il les retournait dans cet examen, et admirait leurs formes curieuses, quelle fut sa surprise à l’aspect d’un fourreau, dont les ornements étaient exactement du même goût que le poignard ramassé dans la fatale hutte ? Il tressaillit à cette vue ; et se hâtant d’acquérir une nouvelle preuve à l’appui de la présomption qui frappait déjà son âme, il chercha de suite le poignard, et qu’on juge l’horreur qui vint le saisir à la découverte désespérante que l’arme cruelle, quelque extraordinaire que fût sa forme, remplissait justement le foureau qu’il tenait à la main ! Ses yeux semblaient ne plus demander d’autres témoins pour le confirmer dans son affreux soupçon, et paraissaient ne pouvoir se détacher de l’instrument de mort : il désirait cependant se faire encore illusion ; mais cette ressemblance d’une forme aussi singulière, cette même variété de couleurs qui ornaient le manche du poignard et le foureau, et plus que tout cela encore, quelques gouttes de sang empreintes sur l’un et sur l’autre, détruisaient toute possibilité d’un doute. Il quitta Smyrne, et en passant par Rome, son premier soin fut de recueillir quelques informations sur le sort de la jeune personne qu’il avait essayé de sauver de la séduction de lord Ruthven. Ses parents, d’une brillante fortune, étaient tombés maintenant dans une extrême détresse, et on ne savait ce que leur fille elle-même était devenue depuis le départ de son amant. Il n’eut que trop lieu de craindre que la jeune Romaine n’eût succombé victime du destructeur d’Ianthe.
Tant d’horreurs réitérées avaient enfin désolé le cœur d’Aubrey. Il devint hypocondre et silencieux : son unique soin était d’accélérer la marche des postillons, comme s’il s’agissait d’aller sauver la vie de quelqu’un qui lui fût cher. Bientôt il arriva à Calais ; une brise, qui semblait obéir à ses désirs, le porta promptement à la côte d’Angleterre ; il se hâta de se rendre à l’antique manoir de ses pères, et y parut pour quelque temps perdre dans les tendres embrassement de sa sœur, le souvenir du passé : si jadis ses caresses enfantines l’avaient vivement intéressé, maintenant qu’elle avait atteint sa dix-huitième année, ses manières avaient acquis avec l’âge une nuance plus douce et encore plus attachante.
Miss Aubrey n’avait pas cette grâce brillante qui captive l’admiration et l’applaudissement d’un cercle nombreux. Il n’y avait rien dans sa contenance de cette teinte animée qui n’existe que dans l’atmosphère échauffée d’un salon tumultueux. Son grand œil bleu n’était jamais visité par cette gaîté insouciante qui n’appartient qu’à la légèreté d’esprit ; mais il respirait cette langueur mélancolique, qui provient moins de l’infortune que d’une âme religieusement empreinte de l’attente d’une vie future, et plus solide que notre existence éphémère. Elle n’avait pas cette démarche aérienne qu’un papillon, une fleur, un rien suffit pour mettre en mouvement. Son maintien était calme et pensif. Dans la solitude ses traits ne perdaient jamais cet air sérieux et réfléchi qui leur était naturel ; mais était-elle près de son frère, tandis qu’il lui exprimait sa tendre affection et s’efforçait d’oublier en sa présence ces chagrins qu’elle savait trop bien avoir détruit sa félicité sans retour, qui aurait voulu échanger alors le sourire reconnaissant de miss Aubrey contre le sourire même de la Volupté ? Ses yeux, ses traits, respiraient alors une céleste harmonie avec les douces vertus de son âme. Elle n’avait pas encore fait sa première entrée dans le monde, ses tuteurs ayant jugé plus convenable de différer cette grande époque jusqu’au retour de son frère, pour qu’il pût lui servir de protecteur. Il fut donc maintenant décidé que le cercle qui allait sous peu se tenir à la Cour serait choisi pour son introduction dans la société. Aubrey eût préféré ne pas quitter la demeure de ses ancêtres, et y nourrir cette mélancolie qui le consumait sans cesse. Quel intérêt, en effet, pouvaient avoir pour lui les frivolités des réunions à la mode, après les impressions profondes dont les évènements passés avaient empreint son âme ? mais il n’hésita pas à faire le sacrifice de ses propres goûts à la protection qu’il devait à sa sœur. Ils se rendirent à Londres, et se préparèrent pour le cercle qui devait avoir lieu dès le lendemain de leur arrivée. La foule était prodigieuse. Il n’y avait pas eu de réunion à la Cour depuis long-temps, et tous ceux qui étaient jaloux de briguer la faveur d’un sourire royal étaient là. Tandis qu’Aubrey se tenait à l’écart, insensible à ce qui se passait autour de lui, et que justement il venait de se rappeler que c’était à cette même place qu’il avait vu pour la première fois lord Ruthven, il se sentit tout à coup saisi par le bras, et une voix qu’il ne reconnut que trop bien fit retentir ces mots à son oreille : Souvenez-vous de votre serment ! Tremblant de voir un spectre prêt à le réduire en poudre, il eut à peine le courage de se retourner, quand il aperçut près de lui cette même figure qui avait tellement attiré son attention justement au même endroit, le premier jour de son début dans la société. Il la regarda d’un air effaré jusqu’à ce que ses jambes se refusant presque à le soutenir, il se vit obligé de prendre le bras d’un ami, et , se frayant un chemin à travers la foule, il se jeta dans sa voiture. Rentré chez lui, il arpentait son appartement à pas précipités, et portait ses mains sur sa tête, comme s’il eût craint que la faculté de penser ne s’en échappât sans retour. Lord Ruthven était toujours devant ses yeux : les circonstances se combinaient dans sa tête dans un ordre désespérant ; le poignard, son serment… Honteux de lui-même et de sa crédulité, il cherchait à secouer ses esprits abattus, et à se persuader que ce qu’il avait vu ne pouvait exister : un mort sortir du tombeau ! son imagination seule avait sans doute évoqué du sépulcre l’image de l’homme qui occupait incessamment son esprit : enfin, il en vint à se convaincre que cette vision était certainement sans réalité. Quoi qu’il en pût être, il se décida à retourner encore dans la société ; car, quoiqu’il essayât vingt fois de questionner ceux qui l’entouraient, sur lord Ruthven, ce nom fatal restait toujours suspendu sur ses lèvres, et il ne pouvait réussir à recueillir aucune information sur l’objet qui l’intéressait si fortement. Quelques soirées après, il conduisit encore sa sœur à une brillante assemblée, chez quelqu’un de ses parents. La laissant sous la protection d’une dame d’un âge respectable, il se plaça lui-même dans un coin isolé des appartements ; et là, se livra tout entier à ses tristes pensées. Un long-temps s’écoula ainsi, et enfin il s’aperçut qu’un grand nombre de personnes avaient déjà quitté les salons ; il sortit forcément de cet état de stupeur, et entrant dans une pièce voisine, il y vit sa sœur environnée de plusieurs personnes, avec qui elle paraissait en conversation soutenue ; il s’efforçait de s’ouvrir route jusqu’à elle, et venait de prier une personne devant lui de le laisser passer, quand cette personne, se retournant, lui montra les traits qu’il abhorrait le plus au monde. Tout hors de lui-même, à cette fatale vue, il se précipita vers sa sœur, la saisit par la main, et, à pas redoublés, l’entraîna vers la rue. Sur le seuil de l’hôtel il se trouva arrêté quelques instants par la foule de domestiques qui attendaient leurs maîtres ; et tandis qu’il traversait leurs rangs, il entendit cette voix qui ne lui était que trop bien connue, faire résonner à son oreille ces mots terribles : Souvenez-vous de votre serment ! Éperdu, terrifié, il n’osa pas même lever les yeux autour de lui ; mais, accélérant la marche de sa sœur, il s’élança dans sa voiture, et bientôt fut chez lui.
Le désespoir d’Aubrey maintenant alla presque jusqu’à la folie. Si déjà auparavant son esprit avait été absorbé par un seul objet, combien en devait-il être frappé plus profondément à présent que la certitude que le monstre était encore vivant, le poursuivait sans relache. Il était devenu insensible aux tendres attentions de sa sœur, et c’était en vain qu’elle le suppliait d’expliquer la cause de ce changement subit qui s’était opéré en lui. Il ne lui répondait que par quelques mots entrecoupés, et ce peu de mots toutefois suffisait pour porter la terreur dans l’âme de sa sœur. Plus Aubrey réfléchissait à tout cet horrible mystère et plus il s’égarait dans ce cruel labyrinthe. L’idée de son serment le faisait frémir. Que devait-il faire ? devait-il permettre à ce monstre de porter son souffle destructeur parmi toutes les personnes qui lui étaient chères, sans arrêter d’un seul mot ses progrès ; sa sœur même pouvait avoir été touchée par lui ! mais quoi ! si même il osait rompre son serment, et découvrir l’objet de ses terreurs, qui y ajouterait foi ? quelquefois il songeait à employer son propre bras pour débarrasser le monde de ce scélérat : mais l’idée qu’il avait déjà triomphé de la mort l’arrêtait. Pendant nombre de jours, il resta plongé dans cet état de marasme : enfermé dans sa chambre il ne voulait voir personne, et ne consentait même à prendre quelque nourriture que lorsque sa sœur, les larmes aux yeux, venait le conjurer de soutenir son existence par pitié pour elle. Enfin incapable de supporter plus long-temps la solitude, il sortir de chez lui, et courait de rue en rue comme pour échapper à l’image qui le suivait si obstinément. Insouciant sur l’espèce de vêtements dont il couvrait son corps, il errait ça et là aussi souvent exposé aux feux dévorants du soleil de midi qu’à la froide humidité des soirées. Il était devenu méconnaissable ; d’abord il rentrait chez lui pour y passer la nuit ; mais bientôt il se couchait sans choix partout où l’épuisement de ses forces l’obligeait de prendre quelque repos. Sa sœur, inquiète des dangers qu’il pouvait courir, voulut le faire suivre ; mais Aubrey laissait promptement derrière lui ceux qu’elle avait chargés de cet emploi, et échappait à ses surveillants plus vite qu’une pensée ne nous fuit. Il changea néanmoins tout d’un coup de conduite. Frappé de l’idée que son absence laissait ses meilleurs amis sans le savoir dans la société d’un être aussi dangereux, il se décida à paraître de nouveau dans le monde et à veiller de près lord Ruthven, avec l’intention de prévenir, en dépit de son serment, toutes les personnes dans l’intimité desquelles il chercherait à s’immiscer. Mais lors qu’Aubrey entrait dans un salon, son regard effaré et soupçonneux était si remarquable, ses tressaillements involontaires si visibles, que sa sœur se vit à la fin réduite à le solliciter de s’abstenir de fréquenter, uniquement par condescendance pour elle, un monde font la seule vue paraissait l’affecter si fortement. Quand ses tuteurs s’aperçurent que les conseils et les prières de sa sœur étaient inutiles, ils jugèrent à propos d’interposer leur autorité ; et craignant qu’Aubrey ne fut menacé d’une aliénation mentale, ils pensèrent qu’il était grandement temps qu’ils reprisent la charge qui leur avait été confiée par ses parents.
Désirant ne plus avoir à craindre pour lui le renouvellement des souffrances et des fatigues auxquelles ses excursions l’avaient souvent exposé, et dérober aux yeux du monde ces marques de ce qu’ils nommaient folie, ils chargèrent un médecin habile de résider auprès de lui pour le soigner, et de ne le jamais perdre de vue. A peine Aubrey s’apperçut-il de toutes ces mesures de précaution, tant ses idées étaient absorbées par un seul et terrible objet. Renfermé dans son appartement, il y passait souvent des jours entiers dans un état de morne stupeur dont rien ne pouvait le retirer. Il était devenu pâle, décharné ; ses yeux n’avaient plus qu’un éclat fixe : le seul signe d’affection et de réminiscence qu’il déployait encore, était à l’approche de Miss Aubrey ; alors il tressaillait d’effroi, et pressant les mains de sa sœur avec un regard qui portait la douleur dans son cœur, il lui adressait ces mots détachés : oh ! me le touchez pas : par pitié, si vous avez quelque amitié pour moi, n’approchez pas de lui. Et cependant quand elle le suppliait de lui indiquer du moins de qui il parlait, sa seule réponse était : Il est trop vrai ! il est trop vrai ! et il retombait dans un affaiblissement dont elle ne pouvait plus l’arracher. Cet état pénible avait duré nombre de mois ; cependant lorsque l’année fatale fut au moment d’être éculée, l’incohérence de ses manières devint moins alarmante ; son esprit parut être dans des dispositions moins sombre, et ses tuteurs observèrent même que plusieurs fois le jour il comptait sur ses doigts un nombre déterminé, tandis qu’un sourire de satisfaction s’épanouissait sur ses lèvres.
L’an était presque passé, quand le dernier jour un de ses tuteurs étant entré dans son appartement, entretint le médecin du triste état de santé d’Aubrey, et remarqua combien il était fâcheux qu’il fut dans une situation aussi déplorable, tandis que sa sœur devait se marier le lendemain. Ces mots suffirent pour réveiller l’attention d’Aubrey ; et il demanda avec empressement, à qui ? Son tuteur, charmé de cette marque de retour de sa raison, dont il craignait qu’il n’eût été à jamais privé, lui répondit, avec le comte Marsden. Pensant que c’était quelque jeune noble qu’il avait rencontré en société, mais que sa distraction d’esprit ne lui avait pas permis de remarquer dans le temps, Aubrey parut fort satisfait, et surprit encore davantage son tuteur, par l’intention qu’il exprima d’être présent aux noces de sa sœur, et son désir de la voir auparavant. Pour toute réponse, quelques minutes après, sa sœur était près de lui : il semblait être redevenu sensible à son sourire aimable : il la serra contre son cœur, et pressa tendrement de ses lèvres ses joues humides de larmes de plaisir que lui causait l’idée que son frère avait retrouvé toute son affection pour elle. Il lui parla avec chaleur, et la félicita vivement sur son union avec un personnage d’une naissance aussi distinguée et aussi accompli, lui avait-on dit, quand, soudain, il remarqua un médaillon sur son sein : l’ayant ouvert, quelle fut son horrible surprise à la vue des traits du monstre qui, depuis si long-temps, avait un tel ascendant sur son existence. Il saisit le portrait dans un accès de rage, et le foula aux pieds ; et, comme sa sœur lui demanda, pourquoi il détruisait l’image de l’homme qui allait devenir son mari, il regarda d’un air effaré, comme s’il n’avait pas compris sa question ; et alors, lui serrant les mains, et jetant sur elle un coup d’œil désespéré et frénétique, il la supplia de lui promettre, sous serment, qu’elle n’épouserait jamais ce monstre ; car il… Mais, là, il fut contraint de s’interrompre : il lui sembla comme si la voix fatale lui recommandait encore de se rappeler son serment. Il se retourna brusquement, pensant que lord Ruthven était là ; mais il ne vit personne. Cependant, les tuteurs et le médecin qui avaient entendu tout ce qui s’était passé, et qui s’imaginèrent que c’était un retour de désordre d’esprit, entrèrent tout à coup, et l’éloignant de sa sœur, la prièrent de quitter la chambre. Il tomba sur ses genoux, et les conjura de différer la cérémonie, ne fût-ce que d’un seul jour. Mais eux, supposant que tout cela n’était qu’un pur accès de folie, s’efforcèrent de le tranquilliser, et se retirèrent. Lord Ruthven, dès le lendemain du cercle de la Cour, s’était présenté chez Aubrey ; mais la permission de le voir lui avait été refusée ainsi qu’à tout le monde. Lorsqu’il apprit, bientôt après, l’état alarmant de sa santé, il sentit immédiatement que c’était lui qui en était la cause ; mais quand on lui dit qu’Aubrey paraissait être tombé en démence, il eut peine à cacher sa triomphante joie à ceux qui lui donnaient cette information. Il se hâta de se faire introduire auprès de miss Aubrey ; et, par une cour assidue, et l’intérêt qu’il semblait prendre sans cesse à la déplorable situation de son frère, il réussit à captiver son cœur. Qui, en effet, aurait pu résister à ses pouvoirs de séduction ? Sa langue insinuante avait tant de fatigues, de dangers inconnus à raconter ; il pouvait avec tant d’apparence de raison, parler de lui-même comme d’un être tellement différent du reste du genre humain, et n’ayant de sympathie qu’avec elle seule : il avait tant de motifs plausibles pour prétendre que ce n’était que depuis qu’il pouvait savourer les délices de sa voix charmante, qu’il commençait à perdre cette insensibilité pour l’existence qu’il avait dénotée jusqu’alors : enfin, il savait si bien mettre à profit l’art dangereux de la flatterie, ou du moins tel était l’arrêt de la destinée, qu’il conquit toute sa tendresse. Dans ce même temps l’extinction d’une branche aînée, lui transmit le titre de comte de Marsden ; et dès que son union avec miss Aubrey fut convenue, il prétexta des affaires importantes qui l’appelaient sur le continent, pour presser la cérémonie, nonobstant l’état affligeant du frère, et il fut décidé que son départ aurait lieu le jour même de son mariage. Aubrey ayant été abandonné à lui-même par ses tuteurs, et même par son médecin, essaya de corrompre, à force de présents, les domestiques, mais inutilement ; n’ayant pu obtenir qu’ils le laissassent sortir, il demanda une plume et du papier, et il écrivit à sa sœur, la conjurant, par considération pour sa propre félicité, son honneur et celui de ses parents renfermés dans la tombe, de différer seulement de quelques heures, une union qui devait être accompagnée des plus grands malheurs. Les domestiques lui promirent de remettre la lettre à sa sœur ; mais ils la portèrent au médecin, qui jugea plus convenable de ne pas la chagriner davantage, par ce qu’il considérait comme de purs actes de démence.
La nuit se passa dans les préparatifs pour la cérémonie du lendemain. Aubrey entendait le tout avec une horreur plus aisée à imaginer qu’à décrire. La fatale matinée n’arriva que trop tôt : déjà le bruit des nombreux équipages venait frapper l’oreille d’Aubrey. Il délirait presque de rage. Heureusement la curiosité des domestiques chargés de le veiller, l’ayant emporté sur leur zèle à remplir leur devoir, ils s’éloignèrent tous l’un après l’autre, le laissant imprudemment sous la garde d’une femme âgée et sans force. Il saisit avidement l’occasion, et d’un seul bond était hors de son appartement ; dans un instant il se trouva dans le salon, où presque tout le monde était déjà rassemblé. Lord Ruthven fut le premier à l’apercevoir. Il s’approcha immédiatement d’Aubrey, et prenant son bras de force, l’entraîna de la chambre hors d’état de parler de rage. Quand ils furent sur l’escalier, lord Ruthven lui murmura ces mots à l’oreille : Souvenez-vous de votre serment, et sachez que votre sœur, si elle ne devient pas mon épouse aujourd’hui même est déshonorée ; la vertu des femmes est fragile… Après ce peu de mots, il le repoussa violemment entre les bras des domestiques chargés de le surveiller, et qui, dès qu’ils se furent aperçus de son évasion, étaient accourrus à sa poursuite.
Aubrey n’était plus en état de soutenir le poids de son propre corps, et, par un effort extraordinaire pour exhaler son désespoir forcéné, il se rompit un vaisseau dans la gorge, et, baigné dans son sang, fut transporté au lit.
On laissa ignorer tout ce qui venait de se passer à sa sœur, qui malheureusement était hors du salon quand il y était entré. La cérémonie fut célébrée, et les deux époux quittèrent de suite Londres.
L’état de faiblesse d’Aubrey alla en s’accroissant rapidement ; et la vaste quantité de sang qu’il avait perdu ne produisit que trop tôt des indices d’une prompte dissolution. Il fit donc appeler ses tuteurs, et la rage qui l’avait presque suffoqué s’étant un peu appaisée ; dès que minuit sonna, il raconta avec calme ce que le lecteur vient de lire, et expira immédiatement après ce récit.
Ses tuteurs se hâtèrent de voler au secours de miss Aubrey ; mais il était trop tard ; lord Ruthven avait disparu, et le sang de son infortunée compagne avait assouvi la soif d’un Vampire.
L'AME ERRANTE
SOUVENIRS DES EXISTENCES ANTÉRIEURES
par Maxime DU CAMP (1822-1894)
À mon cher Frédéric F...
L’homme n’est qu’un souffle et une ombre.
(Sophocle.)
J’ai connu autrefois un littérateur qui s’appelait Jean-Marc ; c’était un rêveur qui chérissait les longues chevelures, les parfums, et le soleil. Ainsi que Figaro, il était paresseux avec délices et restait volontiers plusieurs semaines sans toucher une plume, causant tout seul avec ses idées en regardant sauter les étincelles de son feu. Parfois aussi il se mettait au travail, et alors, comme disent les bonnes gens, il abattait beaucoup de besogne.
Un soir, – un beau soir de printemps tout chargé d’étoiles, – il était couché sur son divan, jambe de ci, jambe de là, perdu dans quelque bon souvenir d’amour, fumant un narghilé et vêtu d’une robe de chambre turque, comme il convient à un homme qui a voyagé en Orient. Les fenêtres ouvertes laissaient entrer les molles tiédeurs de la nuit, la flamme vacillante des bougies se reflétait dans leurs collerettes de cristal, des fleurs s’épanouissaient dans de grands vases, et, sur une large table, des plumes fraîchement taillées s’entassaient entre un encrier plein et des feuilles de papier blanc. Ce soir-là, Jean-Marc devait commencer un roman nouveau.
Il en était arrivé à ce moment terrible où il faut porter une main hardie sur la virginité du papier ; il fallait commencer, il fallait écrire ce premier mot, si difficile, qu’il fait souvent reculer les plus braves, La raison lui criait : « À l’oeuvre ! » et la rêverie – cette bonne soeur des mauvais jours – murmurait à son oreille : « Reste encore, ne me quitte pas ; viens avec moi ; nous irons tous les deux sous les orangers de Scio, vers cette petite maison de marbre blanc où tu voudrais cacher tes amours et ta vie ; viens, je t’emmènerai dans les étoiles, et tu verras de grands regards bleus qui se fixeront sur toi. »
Jean-Marc hésitait, il était tout prêt à composer encore avec sa conscience ; sans doute il allait remettre son oeuvre à des temps moins songeurs, lorsqu’un bruit singulier lui fit tourner la tête. Sur sa table, ses plumes se remuaient. Il crut qu’un gros scarabée, détourné de sa route par l’éclat des lumières, était venu étourdiment tomber chez lui. Comme il avait bon coeur, il se levait déjà pour lui rendre la liberté ; mais il resta immobile et pâle devant le mouvement étrange qui s’agitait sur sa table. Voici ce qu’il vit :
Une plume se dressa toute seule, se regarda à la bougie, se trempa dans l’encre et se mit à écrire ; elle fit un pâté et se jeta au loin avec colère. Jean-Marc, épouvanté, retomba sur son siège. Une autre plume alla s’abreuver à l’encrier et bientôt se prit à courir sur le papier ; parfois elle s’arrêtait avec hésitation sur un mot, faisait une rature et continuait. Lorsqu’un feuillet était écrit, il se mettait de côté, et un autre se présentait comme soulevé par un souffle invisible. Quand une plume était fatiguée, elle se laissait tomber sur le tapis, et une autre la remplaçait. Cela dura longtemps ; Jean-Marc regardait toujours et ne comprenait pas. Enfin une plume, la dernière, écrivit en majuscules le mot FIN et l’accompagna d’un grand parafe ; puis tout resta paisible.
Jean-Marc se rassura ; il quitta la pipe éteinte qu’il fumait machinalement depuis deux heures, il s’approcha de la table, y rassembla toutes les feuilles écrites, les mit en ordre, et ce fut avec des yeux agrandis par l’étonnement qu’il lut ce qui suit :
Je suis une âme errante, une âme en peine ; je vague à travers les espaces en attendant un corps, je vais sur les ailes du vent, dans l’azur du ciel, dans le chant des oiseaux, dans les pâles clartés de la lune : je suis une âme errante.
Je suis une âme éternelle comme le sont toutes mes soeurs. Pendant mes existences différentes, bien souvent j’ai entendu discuter sur nous. – Les uns disaient : « L’âme n’existe pas ! » Les autres disaient : « L’âme est immortelle ! » Ils se trompaient tous, nous sommes éternelles. – Nous coexistons avec Dieu, dont nous sommes une émanation directe, nous sommes une parcelle de son immensité, et plus tard nous remonterons vers lui pour nous y absorber à jamais. Seuls ils ont entendu la voix du Seigneur, seuls ils ont été élus par lui, ceux qui ont confessé notre éternité.
Depuis l’instant où Dieu nous a séparées de lui, nous avons vécu sur terre bien des fois, montant de générations en générations, abandonnant sans regret les corps qui nous sont confiés, et continuant l’oeuvre de notre propre perfectionnement à travers les existences que nous subissons.
Lorsque nous quittons cet hôte incommode qui nous sert si mal, lorsqu’il est allé féconder et renouveler la terre dont il est sorti, lorsqu’en liberté nous ouvrons enfin nos ailes, Dieu nous donne alors de connaître notre but. Nous revoyons nos existences précédentes, nous jugeons des progrès que nous avons faits depuis les siècles, nous comprenons les punitions et les récompenses qui nous ont atteintes par les joies et les douleurs de notre vie, nous voyons notre intelligence croître de naissance en naissance, et nous aspirons vers l’état suprême par lequel nous quitterons cette patrie inférieure pour gagner les planètes rayonnantes où les passions sont plus élevées, l’amour moins oublieux, le bonheur plus tenace, les organes plus développés, les sens plus nombreux, et dont le séjour est réservé aux monades qui, par leurs vertus, ont approché plus que nous de la béatitude.
Lorsque Dieu nous renvoie dans des corps qui doivent vivre par nous leur misérable vie, nous perdons toute conscience de ce qui a précédé ces naissances nouvelles ; le moi, qui s’était réveillé, s’est rendormi, il ne persiste plus, et de nos existences passées il ne nous reste que de vagues réminiscences qui causent en nous les sympathies, les antipathies, et aussi parfois les idées innées.
Je ne parlerai point de toutes les créatures qui ont vécu de mon souffle, mais ma vie dernière a subi un malheur si grand, que de celle-là seule je dirai l’histoire.
Avant que mon imprudence m’eût fait perdre ma forme humaine, je vivais parmi les hommes, et beaucoup eussent envié ma fortune, mon bonheur et ma jeunesse.
Une amie de ma mère avait une fille qui était plus jeune que moi de cinq ans, et qui se nommait Marguerite ; avec elle j’avais partagé tous les jeux de mon enfance ; je l’aimais d’une de ces tendresses vives et prévoyantes, qui empruntent à la paternité sa faiblesse attendrie et ses douces sévérités ; je la traitais en enfant gâté, parfois elle me tyrannisait bien un peu, mais, dès qu’une circonstance grave se présentait, je devenais sérieux, et, par les raisonnements de mon amitié, j’obtenais tous les sacrifices qu’on lui demandait. Marguerite était plus qu’une affection pour moi, c’était une habitude ; nous avions ensemble d’interminables causeries, nous faisions tous deux mille projets d’avenir ; nous avions grandi côte à côte, et il me semblait que nous devions traverser la vie en nous tenant par la main.
Cependant j’arrivais à la jeunesse : j’avais vingt ans et Marguerite en avait quinze. À cette époque je fis un voyage de cinq mois, et, lorsque je revins, tout heureux de la revoir, j’eus peine à la reconnaître. Ce n’était plus cette enfant joyeuse et babillarde, qui sautait sur mes genoux et jouait avec moi comme avec un frère aîné ; c’était une jeune fille sérieuse et pâle, dont les yeux avaient d’ineffables langueurs et devant laquelle je me sentis troublé. Je m’étonnai de ce changement profond, car j’ignorais que les femmes atteignent la gravité de leur sexe tout à coup et presque sans transition.
Maintenant les rôles n’étaient plus les mêmes : c’était elle qui me grondait, et chaque jour elle prenait plus d’ascendant sur moi. À ses côtés ma gaieté s’évanouissait, j’étais triste, embarrassé, et je ne comprenais rien au trouble qui remuait mon coeur. J’en parlai à ma mère.
« Ô ma mère ! lui dis-je, il me semble que je n’aime plus Marguerite, et cependant plus qu’autrefois j’ai besoin de la voir ; j’ai de singuliers affadissements, je sens des émotions que j’ignorais et que je ne puis exprimer ; lorsqu’elle est là, je voudrais lui parler et je ne trouve rien à lui dire. »
Ma mère ne me répondit pas et passa en souriant sa main dans mes cheveux.
Un jour d’hiver qu’il avait beaucoup neigé, j’étais assis au coin de mon feu, l’oeil immobile, la tête abaissée, et je pensais à Marguerite. J’étais la proie d’une mélancolie douloureuse, et j’avais je ne sais quel vague désir de mourir. Une angoisse violente me monta au coeur et je me pris à pleurer. Ce malaise nerveux, que j’éprouvais pour la première fois, fut comme un rayonnement subit, il m’illumina tout entier ; je compris alors que j’aimais et je criai le nom de Marguerite. Je courus vers ma mère et me jetai dans ses bras ; elle sourit encore et me répondit : « Vous êtes bien jeunes, mes enfants ; dans quelques années nous verrons ! »
Lorsque je vis Marguerite, je me mis à genoux devant elle, je pressai ses mains sur mes lèvres et lui racontai cette révélation d’amour qui s’était faite en moi ; elle renversa la tête en fermant les yeux ; puis ramenant vers mon visage son regard humide : « Oh ! dit-elle, ce n’est pas d’aujourd’hui que je t’aime ! »
De ce moment, ses manières changèrent ; elle me traitait avec une réserve pleine de tendresse et de pudeur ; elle perdit ce qu’elle avait encore d’enfantin ; chaque jour la femme se dessinait en elle : c’était une toute petite grande dame de quinze ans !
Oh ! comme nous eussions été heureux ! comme la joie eût toujours habité notre vie, si mes imprudentes curiosités n’avaient attiré sur moi les punitions de Dieu !
J’étais fier d’être amoureux ; j’avais concentré toutes les forces de mon être dans cette passion que j’exagérais à plaisir, et ce jeune amour remplissait ma vie. Je voyais souvent Marguerite, quelquefois tous les jours, et il me semblait que ce n’était jamais assez. J’aurais voulu la suivre, la voir, l’écouter sans cesse. Le soir, surtout, lorsque j’étais seul, je me racontais la journée dans tous ses détails ; je me répétais, en cherchant à imiter sa voix, les mots qu’elle avait prononcés ; je me rappelais mille choses que j’avais oublié de lui dire, et je m’abandonnais avec délices à ces souvenirs charmants qui baisent le coeur comme des lèvres tièdes ; j’invoquais un miracle qui pût me transporter à ses côtés ; je comptais les années, les mois, les jours, les heures, qui nous séparaient encore, et j’aspirais vers elle avec toute la fiévreuse intensité d’un coeur de vingt ans !
Un soir qu’elle avait longtemps fait de la musique, je la quittai tout tremblant d’émotion, serrant sur ma poitrine un bouquet de roses jaunes qu’elle m’avait donné, et je me couchai après avoir mis mes fleurs sous l’oreiller, afin d’avoir de jolis songes. Une indicible inquiétude me tourmentait, je ne pouvais dormir ; des étincelles d’or couraient devant mes yeux, une insupportable chaleur me brûlait, des formes vagues de Marguerite m’apparaissaient, et mon esprit chantait des mélodies étranges, que jamais je n’avais entendues. Je faisais des rêves insensés ; je regrettais ces temps heureux où les fées mignonnes vous donnaient à votre naissance de toutes les vertus et de toutes les beautés ; j’aurais voulu être un de ces enchanteurs des contes orientaux, qui ont des anneaux qui rendent invisibles, des filtres qui font aimer et des paroles mystérieuses qui vous emportent à travers les airs.
À force de désirer, il me sembla qu’une puissance inconnue descendait en moi ; il me sembla que, si je le voulais avec violence, mon âme pourrait se séparer de mon corps et courir vers celle qu’elle aimait. Cette idée s’empara de moi jusqu’à me faire douter de ma raison ; je ne pensais plus au sommeil, qui me fuyait sans relâche. Une sorte de terreur inexpliquée m’avait envahi ; je n’avais plus qu’un besoin : sortir de moi-même pour aller voir Marguerite. Aux premières lueurs du jour, je ne dormais pas encore ; alors, poussé peut-être par un pressentiment fatal, je ne combattis plus mes désirs, je m’y abandonnai, et j’ordonnai à ma volonté d’être assez forte pour obtenir le miracle. – Hélas ! elle m’obéit, et de là sont venues toutes mes infortunes !
Je me sentis tout à coup allégé d’un grand poids, mon corps perdit la faculté de se mouvoir, et mon âme, effrayée de sa liberté, voltigeait dans la chambre au-dessus de celui qu’elle animait tout à l’heure, et qui, maintenant, semblait profondément endormi. – Sans tarder je voulus éprouver ce pouvoir surnaturel qui venait de se révéler en moi, et auquel je ne comprenais rien, sinon que j’en avais peur. – Je traversai les appartements, passant dans les fissures des portes, me glissant sous les draperies, trouvant ma route par les ouvertures les plus étroites.
J’arrivai ainsi chez ma mère ; elle était éveillée et lisait dans son lit. Je fus surpris qu’elle ne s’étonnât pas de me voir entrer chez elle à pareille heure. Je m’approchai d’une glace, je regardai et ne vis rien ; je n’avais plus de reflet ; j’allai voltiger autour de ma mère, elle ne fit aucun mouvement ; je me plaçai entre son livre et ses yeux, elle continua de lire. – J’étais diaphane, invisible, impalpable ; je voyais, j’entendais, je jouissais d’une partie immatérielle de mes sens, mais je ne pouvais les manifester : j’étais un souffle, une essence, une monade ; enfin, j’étais mon âme. – Je retournai dans ma chambre, mon corps dormait toujours ; je me posai sur ses lèvres, je rentrai en lui et mon être complet se réveilla.
Le soleil rayonnait ; le jour, à pleines effluves, pénétrait à travers mes croisées ; il était trop tard pour aller chez Marguerite ; j’attendis la nuit avec anxiété.
Le soir vint enfin et avec lui une appréhension douloureuse ; je prétextai, pour me retirer, une indisposition que justifiait ma pâleur. Ma mère m’accompagna, me dit bonsoir en me donnant le baiser d’habitude, et je restai seul. J’hésitai longtemps, j’étais effrayé de moi-même ; je n’osais tenter une seconde expérience de mon pouvoir, mais une curiosité ardente et immodérée me sollicitait ; comme la veille, je sortis de mon corps, je le laissai immobile sur mon lit, et, me précipitant en liberté, je pris mon chemin dans les airs, vers la demeure de Marguerite.
À peine étais-je entré dans sa petite chambre qu’elle arriva. Je me blottis dans un des coins afin de ne pas attirer ses regards, oubliant déjà que je me perdais dans la transparence de l’air. Elle s’approcha de la glace en fredonnant une ariette italienne, déroula ses cheveux, et, tout en se souriant à elle-même, elle les tressa autour de son front. Elle se considéra ainsi quelques secondes, fit une petite moue et murmura à demi-voix :
« Les tresses ne me vont pas bien ; et puis, ajouta-t-elle, il me préfère en bandeaux ! »
« Ô mon âme, mon âme ! pensais-je, que je vous remercie ! »
Je la vis dépouiller ses vêtements épingle à épingle, je vis apparaître ses bras charmants et ses frêles épaules ; je la contemplai tout entière à la clarté du pâle flambeau qui brûlait près d’elle. Lorsqu’elle eut longtemps sautillé et gazouillé comme une fauvette, qu’elle eut revêtu son costume blanc, lorsqu’ainsi que Gretchen elle eut lentement récité les Litanies de la Vierge, et que sa tête reposa enfin sur l’oreiller, je m’approchai d’elle, caressant son visage et passant comme un souffle dans les nappes de ses cheveux.
« Mes pauvres fleurs sont toutes fanées ! dit-elle en effeuillant quelques roses du Bengale placées auprès d’elles, demain je ferai prendre des violettes de Parme. »
Peu à peu ses yeux se fermèrent ; le sommeil s’étendit sur elle ; et pendant toute la nuit, je voltigeai sur ses lèvres, au souffle tiède et régulier de son haleine. – Au point du jour, j’avais rejoint mon corps endormi, et mon premier soin fut d’envoyer à Marguerite les fleurs qu’elle avait désirées.
Lorsqu’au matin je vis ma mère, elle s’informa avec sollicitude de ma santé.
« Cette nuit, me dit-elle, je ne pouvais dormir ; j’étais inquiète de ton indisposition ; je me suis levée et j’ai été dans ta chambre ; tu ne t’es pas réveillé au bruit ; tu étais couché sur le dos, pâle et sans mouvement ; je n’entendais pas ta respiration, tu dormais si profondément, que tu m’as fait peur ; tu avais l’air d’un mort ; je t’ai embrassé sur le front et tu ne t’en es pas aperçu. »
Chaque soir il en fut ainsi ; en partant, je fermais avec soin les yeux de mon corps afin de faire croire à son sommeil ; chaque soir, invisible pour Marguerite, j’assistais avec amour aux pensées de sa solitude, au charme de son repos, aux songes de ses nuits, au moindre de ses désirs qu’à tout prix je parvenais à réaliser. J’étais certain de sa tendresse, l’espérance chantait ses hosannah dans mon coeur, et cependant une mordante inquiétude me dévorait, une invincible crainte empoisonnait ma vie, me dérobait l’avenir, et, malgré tout mon bonheur, je ne me sentais pas heureux. Mais, lorsque j’étais auprès d’elle, lorsque je passais sur ses lèvres en m’enivrant de sa présence, j’oubliais mes pressentiments, je reniais mon effroi et je ne pensais plus qu’à ma félicité.
Mon temps se passait ainsi, entre mes angoisses et les charmantes niaiseries de ma tendresse. Depuis plus d’une année déjà que j’usais de cette faculté surhumaine, j’avais bien gardé mon secret et nul ne le soupçonnait. Qui donc eût donné croyance à cette merveilleuse histoire ? Une fois, j’avais osé dire que je croyais à la possibilité d’une séparation momentanée de l’âme et du corps, et on avait déclaré en riant que j’avais des idées exagérées qui se modifieraient avec l’âge. – À cela je n’avais rien à répondre, et mes raisonnements ne pouvaient convaincre que moi.
Jamais de frivoles curiosités ne me détournèrent de ma route ; en partant, je n’avais qu’une idée, qu’un désir, qu’un rêve, qu’un amour : Marguerite ! Il y avait en elle une grâce qui agitait mon corps lorsque mon âme lui en apportait le souvenir ; ses traits étaient d’une exquise finesse, et sous la maigreur de la jeune fille on prévoyait l’avenir d’une incomparable beauté. Bien souvent, lorsqu’elle dépouillait ses vêtements et déroulait sa chevelure, j’ai pensé à ces naïades blondes qui riaient au soleil, sur le bord des grands fleuves, en secouant leurs couronnes de roseaux verts. En la voyant, je savourais le bonheur qui m’était promis, je me façonnais une vie remplie de paisibles amours, mes espoirs touchaient à la réalité, je me croyais arrivé à ce terme qui se rapprochait chaque jour davantage, et, dans l’ombre, à mes côtés, le malheur m’attendait pour m’emporter dans son tourbillon.
Un soir que je revenais d’un court voyage pendant lequel je n’avais point entendu parler de Marguerite, je me jetai promptement au lit, et, tout ardent d’impatience, je laissai là mon corps et je partis. Lorsque j’arrivai chez elle, je fus étonné de l’ordre symétrique qui régnait partout. Les meubles étaient enveloppés de housses, les rideaux enlevés, et je ne rencontrai personne dans les appartements déserts. J’attendis. La nuit avançait ; je voulus regarder l’heure aux pendules, elles étaient toutes arrêtées. Je cherchai à oublier pour forcer le temps à passer plus vite ; je courais dans les chambres, je furetais, j’appelais à moi des idées étrangères, mais en vain ! je retombais toujours sur cette pensée : « Pourquoi n’est-elle pas ici ? » J’avais besoin de la voir, depuis deux longues semaines que je ne l’avais pas contemplée. Une horloge voisine sonna et je comptai quatre heures. Une âpre inquiétude me saisit, je redoutais vaguement un malheur que je ne connaissais pas, mais dont la prévision m’épouvantait. Ma pauvre âme ne savait que répondre aux mille questions qu’elle s’adressait. Dans l’espoir de découvrir enfin la cause de cette absence navrante, je parcourus la maison : je la fouillai, et ne découvris rien. Je revins chez Marguerite, espérant que peut-être elle serait rentrée ; non ! Le même silence morne dormait autour de moi ; alors je crus mourir et je me perdis dans les rideaux de ce lit dont l’immobile régularité me désespérait. « Où est-elle ? où est-elle ? » me disais-je avec angoisse. J’étais brisé par un insurmontable effroi. Je peuplais de fantômes le calme qui m’environnait, et, comme ces oiseaux de nuit surpris par une clarté soudaine, je fuyais, je voletais tout effrayé de ma solitude. J’avais tout oublié : mon âme, mon corps, ma mère ; je ne pensais qu’à Marguerite ; je voulais la revoir, à tout prix, à l’instant, et je ne savais où elle était.
Mon anxiété dura jusqu’au matin ; le jour était déjà venu lorsqu’une circonstance imprévue vint m’apprendre que Marguerite, avec sa mère, était à la campagne. Je n’hésitai point ; mes terreurs de la nuit ne me laissaient point réfléchir ; une aspiration désordonnée me poussait vers elle ; j’oubliai l’heure, la distance, le danger, et je partis à tire d’aile.
« Ce soir je serai revenu, me disais-je en volant plus vite ; on croira à un sommeil prolongé que j’expliquerai par la fatigue du voyage. » – Je traversais les prairies, les champs, les bois, les villes et les rivières ; j’allais, sous le ciel, en compagnie des oiseaux, et je les devançais tous dans l’ardeur de mon désir et la rapidité de ma course.
Enfin j’arrivai ! Je trouvai Marguerite agenouillée, dans le jardin, devant une plate-bande, et remuant la terre autour d’une fleur, je me posai sur une touffe d’héliotrope et restai absorbé dans sa contemplation.
Elle se leva, je la suivis ; après avoir marché le long des parterres en murmurant tout bas une romance syracusaine que je lui avais apprise, elle s’assit à l’ombre d’un platane et réunit en faisceau les fleurs qui remplissaient son tablier. Parfois elle s’arrêtait et inclinait imperceptiblement la tête sur son épaule pour considérer le bouquet. Tout à coup elle y prit une large marguerite et arracha un à un ses petits pétales lancéolés en disant :
« Il m’aime ! un peu... beaucoup... passionnément ! »
Elle battit des mains et s’écria avec une joie d’enfant :
« Il m’aime ! il m’aime passionnément ! »
Son visage tout rose de chaleur semblait rayonner ; ses yeux, levés et brillants, souriaient en même temps que ses lèvres ; sa main, pendante sur son genou, tenait encore la fleur découronnée dont l’oracle avait dit si vrai. J’étais plongé dans une extase ineffable ; je regrettais mon corps, j’aurais voulu reprendre une forme et tomber à ses pieds pour y mourir de bonheur.
Je m’arrête avec complaisance sur ces détails frivoles ; j’aime à me les raconter ; eux seuls, dans mes longues souffrances, ont soutenu mon courage ; ils sont maintenant mes dernières jouissances, car demain je ne me souviendrai plus.
Cette journée s’écoula comme un songe heureux, et la nuit vint que j’étais encore perdu dans le crépuscule, contemplant Marguerite qui écoutait les oiseaux chanter et regardait le soleil couchant.
La raison m’ordonnait de fuir et sa voix me criait : « Il est temps ! » mais une invincible attraction me retenait ; dégagé de tous les liens terrestres, mon âme s’était comme infusée en elle : « Je ne veux, je ne peux la quitter, me disais-je, demain il sera bien temps de partir. »
Et le lendemain je ne partis pas !
Je restai à ses côtés ; il s’élevait en moi un frémissement de tendresse et d’enivrement lorsque j’allais sur ses pas, oubliant le monde entier, pour ne plus voir que ma blanche chérie. Quand mon âme seule était auprès d’elle, il y avait dans mes sentiments et dans mes pensées une angélique pureté que je ne retrouvais plus lorsque j’étais redevenu mon être complet.
Le soir de ce second jour, elle chanta, et je me blottis sur son sein pour écouter sa voix. – je l’ai dit, j’avais tout oublié, je ne prévoyais, je ne redoutais rien. – Lorsqu’elle fut retirée chez elle, elle se tressa, avec un enfantillage enchanteur, des couronnes de chèvrefeuille qu’elle posa sur sa tête, et se fit, ainsi parée, de grandes révérences devant sa glace. C’était un spectacle digne d’envie que de la voir, demi-vêtue, le front chargé de fleurs, rire en dansant sur ses petits pieds roses.
Elle s’endormit ; son sommeil fut inquiet ; une sueur glacée mouillait ses tempes, ses mains s’agitaient convulsivement, pendant qu’elle semblait se débattre contre l’oppression d’un cauchemar ; une expression d’épouvante décomposait son visage, et plusieurs fois elle cria mon nom.
Il était déjà tard lorsque sa mère entra chez elle.
« Es-tu souffrante, lui dit-elle en l’embrassant, tu parais fatiguée ?
– Non, ma mère, répliqua Marguerite, mais cette nuit j’ai fait un songe affreux ; j’ai rêvé que j’entendais une voix bien connue qui pleurait sous terre et qu’une autre voix répondait : "Il est trop tard, tu ne reviendras plus !« »
À ces mots, le souvenir revint à ma mémoire. Il y avait bientôt soixante heures que j’avais abandonné mon corps ; une vague terreur passa en moi et je pris mon vol. Le ciel était chargé d’orage ; un vent lourd et chaud m’enveloppait comme l’haleine d’une forge ; les oiseaux se réfugiaient dans les arbres ; des corbeaux sinistres croassaient autour de moi ; je me hâtais, je courais, je dévorais l’espace.
J’atteignis enfin le but de ma course, et bientôt j’allais pouvoir rassurer ma mère. Lorsque j’arrivai devant ma maison, deux spectacles inaccoutumés me frappèrent. Des hommes détachaient une tenture noire suspendue au-dessus de la porte et enlevaient de grands flambeaux de cuivre ; à mes fenêtres ouvertes je distinguai des draps étendus. Que se passe-t-il donc ?
Je me précipitai dans ma chambre ; elle était en désordre et mon corps n’était plus sur mon lit bouleversé. Sur les tapis, j’aperçus un marteau, quelques clous, des linges ensanglantés, et un vase d’argent où trempait une branche de buis. Dans mon effroi je ne compris rien : à travers les appartements déserts je courus et j’entrai chez ma mère.
Oh ! je n’oublierai jamais ce que je vis alors : elle était assise affaissée sur elle-même, les yeux fermés, le visage pâle et les mains jointes ; ses amis étaient à ses côtés ; tout le monde pleurait.
Quelqu’un se pencha à son oreille et lui murmura des paroles que je ne pus entendre. Alors elle renversa sa tête en arrière, et s’écria avec des sanglots :
« Mon enfant ! mon enfant ! qui m’eût dit que tu devais mourir ainsi, si jeune et si cruellement ! »
Je compris alors ; et l’horrible vérité se dévoila tout entière ! Pendant l’absence de mon âme, on m’avait cru mort ; on avait appelé les médecins. Ils avaient longuement discuté, et s’étaient résumés en déclarant que j’avais succombé à une apoplexie foudroyante. Pour s’en assurer, ils firent l’autopsie et pratiquèrent à mon pauvre corps une grande ouverture par laquelle mon âme eût été forcée de s’échapper.
Un dernier espoir me restait ; je volai, j’allai à l’église, au cimetière. Hélas ! il était trop tard ! Les dernières pelletées de terre venaient de résonner sur mon cercueil, et la foule s’écoulait tristement.
Je rentrai chez ma mère éperdu, accablé par un regret immense. Je pleurai mon imprudence et cette faculté maudite qui l’avait causée. Pendant plusieurs jours, absorbé par mon malheur, je restai immobile, contemplant avec désespoir cette douleur que j’avais fait naître.
Depuis quelques jours déjà j’étais mort pour tous, lorsqu’un matin la porte s’ouvrit et Marguerite se jeta dans les bras de ma mère, je vis alors à quel point j’étais aimé, et quel trésor d’amour j’avais bénévolement perdu. Mon bonheur, mon beau bonheur, était maintenant évanoui pour toujours.
Je fis un effort surhumain pour parler et faire comprendre mon invisible présence. Je voulais leur crier : « Ne pleurez plus, femmes chéries, ne pleurez plus. Je suis à vos côtés, invisible, mais toujours aimant ; mon corps est parti, mais mon âme vous reste, jamais elle ne vous quittera. Je me partagerai entre vous deux, j’écouterai vos paroles sans pouvoir y répondre, mais vous me devinerez à l’atmosphère de tendresse que je répandrai autour de vous. »
Mes efforts furent impuissants et je restai muet, invisible, impalpable ; j’enviais le sort de mon corps qui dormait pour toujours et n’avait plus à souffrir. Je me sentais si malheureux, que j’eusse voulu mourir, et je ne le pouvais pas, j’étais en possession de mon éternité !
Voilà deux ans de cela, et, depuis ce temps, je fais partie de ces légions d’âmes voyageuses qui errent dans les espaces sans formes et sans bruit, et qui demeurent inconnues dans les airs jusqu’à ce qu’il plaise à Dieu de les renfermer dans de nouveaux corps.
Pendant de longs jours, je fus sans courage, mon malheur m’avait brisé ; à ma propre infortune, au regret déchirant d’avoir perdu celle pour qui j’étais mort et pour qui j’aurais dû vivre, au remords des souffrances que j’avais répandues sur tous mes amours, se joignait l’épouvante de l’avenir. Au milieu de ces douleurs, je pensais à Marguerite : « Eh bien ! me disais-je, puisqu’il en est ainsi, puisqu’il m’est défendu de reparaître à ses yeux sous la forme qu’elle a aimée, je ne la quitterai plus, je marcherai dans son ombre et je dormirai sur ses paupières. »
De ce moment, je donnai toute mon existence à ma mère et à Marguerite. Je la voyais chaque jour croître en beauté, et je me désespérais.
À sa gracieuse pétulance avait succédé une mélancolie paisible ; bien souvent je l’entendis m’appeler en pleurant, et elle ne se doutait guère que c’était mon âme qui gémissait en elle. En effet, c’est en vertu du don d’ubiquité que nous avons, peut-être à notre insu, pendant notre vie, que nous sommes malheureux en amour et que nous regrettons les morts.
Lorsqu’on aime et qu’on est aimé, l’âme s’échange ; on donne à la créature chérie et on reçoit d’elle une portion égale du souffle divin qui nous anime ; nous sommes à la fois en nous et en elle, nous vivons dans son coeur comme elle vit dans le nôtre ; de cette sorte, la monade ravivée par ces éléments étrangers, fécondée par cette copulation nouvelle, sent ses forces se développer, sa joie grandir, ses facultés s’élever, et alors l’être est heureux.
Mais, lorsqu’un des amants, fatigué de tendresse, poussé vers d’autres jouissances par son inconstance naturelle, rappelle à lui la part de son âme qu’il a donnée, l’équilibre se trouve brisé chez celui qui aime encore ; un grand vide se fait en lui, il se sent dépossédé d’une partie de lui-même ; il est plein d’hésitations, de contractions, de troubles, de douleurs ; il souffre et connaît alors toutes les douleurs de l’amour malheureux, jusqu’à ce qu’il rentre en possession d’une portion d’âme qui remplace celle qui lui a été ravie.
Lorsque la mort a fait élection du corps que nous habitons, lorsque nous le rejetons pour ne jamais le retrouver, nous partons, laissant à ceux que nous avons aimés sur terre la part de nous-mêmes que nous leur avions donnée pendant que nous vivions auprès d’eux, et c’est ainsi qu’ils gardent notre mémoire. Lorsqu’ils se souviennent de nous, c’est notre voix qui parle en eux, c’est l’écho du baiser que leur âme reçoit de la nôtre qui leur rappelle l’être qu’ils ont pleuré. Lorsque l’homme a des tristesses vagues et des aspirations profondes vers les choses inconnues, c’est son âme qui obéit instinctivement à l’appel d’une de ses parties emportées par la mort.
Nous-mêmes, nous emportons aussi des portions d’âme que nos amis nous ont données, et c’est cette agrégation de monades diverses qui servira d’éléments aux instincts nouveaux ou modifiés qui doivent agir en nous dans les créations futures. Donc, l’âme va toujours ainsi, à travers les existences qu’elle parcourt, s’échangeant, se complétant, s’irradiant, grandissant, et devient digne enfin de ces mondes rayonnants où nous devons nous absorber un jour.
Marguerite ne savait pas cela ; elle ignorait qu’elle me portait en elle, et sa douleur accroissait la mienne.
Partout je la suivais ; dans les bals où la conduisait sa mère, je me glissais sur ses pas, je voltigeais autour d’elle et je rafraîchissais de mon souffle ses épaules brûlantes. Ah ! si elle avait pu savoir que souvent, sur les guirlandes de son jeune front, reposait l’âme de celui qu’elle regrettait ! Parfois, j’allais me coucher au soleil dans le calice des fleurs, et je revenais vers elle tout chargé des parfums qu’elle aimait.
En hiver, je suis bien malheureux. Les arbres n’ont plus de feuilles et les fleurs sont mortes ; je ne sais où m’abriter. C’est à peine si quelque hâtif perce-neige peut me donner asile ; alors j’erre, je cours effrayé, cherchant un refuge contre les frimas, et je finis toujours par voler vers Marguerite. Souvent, lorsque je touche à sa demeure, lorsque je vais pouvoir me réchauffer à son haleine, un tourbillon de vent passe et m’emporte. Je ne peux lutter, sa force m’entraîne ; je me trouve en compagnie des mes soeurs les âmes en peine, et sur les ailes des ouragans je traverse des pays désolés, sous un ciel âpre et dur, parmi les pâles bruyères et les ronces déchirantes, dans les forêts mugissantes et sur les flots, où le matelot tremble et invoque Notre-Dame de Bon-Secours, en entendant passer la rafale toute chargée de nos gémissements. Quelquefois je parviens à m’échapper ; tout meurtri de la fureur du vent, bien loin de celle vers laquelle je tends toujours, je vais dans les campagnes, j’entre dans les fermes isolées, et je cours me cacher auprès de l’âtre, dans l’étroite retraite où le grillon chante en s’accompagnant des pétillements du feu.
Ces supplices eussent peut-être duré pendant l’éternité entière si Dieu, dans sa pitié infinie, ne m’avait permis de vivre de nouveau parmi l’humanité. Cette nuit, peut-être, va s’opérer mon incarnation, et je profite d’une dernière grâce que Dieu a concédée à mes prières : je me hâte et j’écris mes mémoires, afin qu’ils servent de leçon aux imprudents de l’avenir.
Un soir, j’étais chez Marguerite lorsque sa mère entra. Elle lui prit la main, la baisa au front et lui dit qu’elle avait vingt ans, que le moment était venu de songer au mariage. À ces mots, la pauvre enfant baissa la tête et sanglota en prononçant mon nom.
Sa mère lui parla longtemps avec de douces remontrances ; une douleur exagérée, un regret inutile, ne devaient pas l’empêcher de prévoir l’avenir, et le souvenir de celui qui n’était plus ne pouvait porter obstacle à une union qui s’offrait avec toutes les conditions que recherchent les jeunes filles.
Marguerite hésitait ; un combat se livrait dans son coeur que j’occupais encore ; elle regardait sa mère sans parler, puis, enfin, se jetant dans ses bras :
« Ô ma mère, dit-elle, je vous obéirai ! »
Que dirai-je ? tout fut conclu, et ce mariage fut décidé.
Elle fut froide d’abord et réservée avec son fiancé ; quelque chose lui disait sans cesse : « Souviens-toi ! souviens-toi ! » Mais cet écho de ma pensée s’affaiblit peu à peu et finit par s’éteindre. Marguerite s’adoucit et se charma de cette nouvelle tendresse. Mon amour avait quitté son coeur, il n’y passait plus que comme une image à demi effacée, ainsi que la chaleur qui reste encore dans le nid lorsque déjà les oiseaux sont envolés.
Cet oubli me désespéra. Je n’avais pas réfléchi que toutes les douleurs se cicatrisent, et que l’amour est comme le phénix, qui meurt souvent et renaît toujours.
Au milieu des tourments de ma jalousie, une idée soudaine m’illumina. Ils allaient se marier, et peut-être obtiendrais-je de Dieu la permission de rentrer sur terre sous une forme adorée de Marguerite. Je montai moi-même porter ma prière au Seigneur, il avait été touché du long martyre qui avait si cruellement puni mon imprudence, et il m’accorda la grâce que je demandais. Maintenant tout est prêt de finir, et demain il y aura dans les désespoirs secrets de l’espace une âme en peine de moins.
Je reviendrai aux yeux de Marguerite sous une apparence qui lui sera plus chère encore que je ne l’ai jamais été. Ce matin le prêtre a béni leur union ; et cette nuit, bientôt, dans quelques minutes, la porte de la chambre nuptiale retombera sur les deux époux. Alors commenceront ces doux mystères de l’alcôve que j’ai tant rêvés, que j’ai tant pleurés ; alors je serai là ; alors, Dieu me l’a promis, ils prendront mon âme entre deux baisers, et moi, qui fus l’amant de Marguerite, bientôt je serai son enfant !
Le manuscrit s’arrêtait là. Lorsque Jean-Marc eut terminé cette lecture, il reconnut qu’il était trop tard pour commencer son roman. Il ralluma son narghilé, et maintenant il croit avec ferveur à la transmigration des âmes.
Paru dans Le Visage vert, numéro 6,
Éditions Joëlle Losfeld et Le Visage vert, 1999.
Illustration : Caspar David Friedrich (1774-1840).
LE SOUTERRAIN DE L’ALHAMBRA - Washington Irving
Washington Irving
A l’intérieur de la forteresse de l’Alhambra, en face du palais royal, à Grenade, se trouve une vaste esplanade ouverte appelée la Place des Citernes (la Plaza de los Algibes), nom qu’elle doit aux réservoirs d’eau établis sous terre, cachés à la vue, et existant en cet endroit depuis l’époque des Mores.
Dans un coin de cette esplanade se voit un puits moresque creusé dans le roc à vif, et dont l’eau est aussi froide que la glace et aussi transparente que le cristal.
Les puits faits par les Mores sont encore aujourd’hui en renom, car on n’ignore point les peines que l’on se donnait alors pour arriver jusqu’aux sources les plus pures et les plus douces.
L’un de ces puits, celui dont il est question ici, est fameux dans tout Grenade. On y voit les porteurs d’eau, qui tenant en équilibre de grandes cruches sur leurs épaules, qui poussant devant eux des ânes chargés de vaisseaux en terre, monter et descendre, ― de l’aube à la nuit noire, ― les pentes des avenues boisées de l’Alhambra.
Les fontaines et les puits dès les temps éloignés dont parle l’Ecriture, ont toujours été sous les climats chauds des lieux de rendez-vous préférés où l’on se livre volontiers aux commérages.
Autour du puits dont il est question dans ce récit il y a eu de temps immémorial une sorte de club perpétuel composé des invalides, des vieilles femmes, et d’autres badauds et badaudes, formant la population désœuvrée de la forteresse, qui y prennent place sur des bancs de pierre, sous un auvent recouvrant le puits pour servir d’abri contre le soleil au collecteur du péage.
Les conversations et les cancans y vont bon train. On n’y laisse approcher aucun porteur d’eau sans l’interroger sur les nouvelles de la ville et sans faire de longs commentaires sur tout ce qu’il a vu et entendu dire. Il ne se passe pas une heure de la journée que des commères en humeur de flânerie, des servantes sans besogne ne viennent y baguenauder, la cruche sur la tête, pour entendre l’incessant babil de ces maîtres bavards.
Parmi les porteurs d’eau qui venaient autrefois s’approvisionner à ce puits, il y avait un petit bonhomme aux épaules trapues, au dos solide, aux jambes arquées, que l’on appelait Pedro Gil et par abréviation Perégil.
Comme tous ceux qui exerçaient le même métier que lui à Grenade, il était Gallégo, c’est-à-dire natif de Gallicie.
La nature semble avoir formé des races d’hommes, comme elle a créé des races d’animaux tout exprès pour les professions qu’ils ont à remplir. C’est ainsi qu’en France tous les cordonniers sont savoyards, tous les portiers d’hôtel suisses, et qu’au temps où les vertugadins et les coiffures poudrées étaient de mode en Angleterre, il n’y avait qu’un Irlandais coureur de marais pour imprimer le balancement à la chaise à porteur.
De même en Espagne, les porteurs d’eau et les portefaix en général sont tous petits, trapus et originaires de Gallicie. Aussi ne dit-on point « Faites venir un homme de peine » mais « Appelez un Gallégo. »
Pour en revenir à mes moutons, Pérégi le Gallégo avait débuté avec une grande cruche de terre qu’il portait tout bonnement sur l’épaule ; par degrés, sa situation s’était agrandie dans le monde et il s’était trouvé en mesure de s’acheter un auxiliaire appartenant à une classe correspondante d’êtres animés, en d’autres termes un gros âne tout velu.
De chaque côté de son aide-de-camp aux longues oreilles, dans une espèce de panier, étaient suspendues ses cruches d’eau recouvertes de feuilles de vigne pour les protéger contre le soleil.
Il n’y avait pas dans tout Grenade de porteur d’eau plus industrieux et plus joyeux que Pérégil.
Les rues résonnaient de ses gais accents lorsqu’il trottinait derrière son aliboron, en chantant de cette voix qu’on peut appeler ensoleillée et qui s’entend dans toutes les villes espagnoles : Quien quiere agua, agua mas fria que la nieve ? Qui veut de l’eau, de l’eau plus froide que la neige ? Qui veut de l’eau du puits de l’Alhambra, froid comme la glace et limpide comme le cristal ?
Quand il servait à un client un verre pétillant, de son liquide c’était toujours avec un mot plaisant qui provoquait un sourire ; et lorsque par hasard il avait affaire à une belle dame ou à une jeune demoiselle dont la joue ou le menton avait une gracieuse fossette, il ne manquait pas de lui adresser un compliment sur sa beauté.
Aussi Pérégil le Gallégo était-il cité dans tout Grenade pour le plus poli, le plus aimable, le plus gai et le plus heureux des mortels.
Pourtant ce n’est pas toujours celui qui chante le plus haut et qui raille le plus qui a le cœur le plus léger.
Sous toute cette apparence de jovialité, le brave Pérégil avait ses soucis et ses peines.
Il avait à entretenir une grande famille d’enfants en haillons, affamés et bruyants comme une nichée de jeunes hirondelles, qui l’accablaient de leurs demandes de pain chaque fois qu’il rentrait le soir de ses corvées du jour.
Il avait, à vrai dire, une compagne, mais elle ne lui était d’aucune aide. Elle était jadis une reine de beauté dans son village, et tout son village vantait son habileté à danser le boléro et à faire sonner les castagnettes ; elle avait, depuis son mariage, gardé ses penchants d’autrefois, dépensant en toilettes toute la recette amassée à force de labeur par le bon Pérégil, et mettant à contribution jusqu’au baudet même pour faire des parties de plaisir les dimanches et les jours de fête, et ces innombrables jours de repos qui en Espagne sont presque plus nombreux que ceux de la semaine. Avec tout cela elle était musarde, plus souvent couchée que debout et jacassant comme pas une pie : bref, négligeant sa maison, sa famille, délaissant tout pour rôder en traînant la semelle chez les commères, ses voisines.
Fort heureusement, celui qui mesure le vent à brebis tondue sait accommoder le joug du mariage au cou qui doit le porter. Pérégil endurait le gaspillage de sa femme et les cris de ses enfants avec autant de résignation que son âne en mettait à transporter les cruches d’eau ; et quoiqu’il lui arrivât quelquefois de hocher la tête lorsqu’il était seul, jamais il ne se serait risqué à mettre en doute les vertus ménagères de sa moitié.
Il aimait ses enfants comme le hibou chérit ses petits, et il était fier de voir en eux se multiplier et se perpétuer sa propre image, car ils étaient tous trapus, solides et bancroches comme lui.
Son plus grand plaisir, quand il avait un peu de répit et une poignée de maravédis à dépenser, était d’emmener toute la bande, les uns dans ses bras, les autres accrochés à ses habits, les plus grands trottant derrière ses talons, et de leur laisser prendre leurs ébats et faire leurs cabrioles dans les vergers de la Véga, pendant que sa femme dansait avec ses amis dans les Angosturas du Darro.
C’était par une belle soirée d’été, à une heure déjà avancée.
La plupart des portefaix et porteurs d’eau avaient achevé leur rude besogne de la journée. Il avait fait excessivement chaud. La nuit était délicieuse, une de ces nuits qu’éclaire la lune et qui invitent les habitants de ces climats méridionaux à s’indemniser de la chaleur et de l’inaction forcée de la journée en se promenant en plein air et en jouissant de la fraîcheur de la température le plus longtemps possible. Les acheteurs d’eau étaient encore dehors. Pérégil, en bon petit père peinant à la tâche, songeait à ses enfants affamés.
— Encore un voyage au puits, se disait-il, pour pouvoir acheter un puchero du dimanche à mes plus petits.
Tout en parlant, il trottinait vaillamment dans l’avenue de l’Alhambra, chantonnant comme il en avait l’habitude et de temps à autre administrant un bon coup de bâton au baudet, autant pour battre la mesure sur le dos de la pauvre bête que pour la régaler ; car les rations de coups tiennent lieu en Espagne de rations d’herbe pour les bêtes de charge.
Arrivé au puits, Pérégil le trouva désert.
Il n’y vit qu’un étranger en costume mauresque, assis seul au clair de lune sur le banc de pierre.
Pérégil fit d’abord une pause et considéra l’inconnu avec un air de surprise, mêlée de crainte ; mais le More lui fit signe faiblement d’approcher.
— Je suis las et malade, dit-il, aide-moi à regagner la ville et je te payerai le double de ce que tu gagnerais à remplir les cruches d’eau.
Le bon cœur du petit porteur d’eau fut touché de compassion à cet appel de l’étranger.
— Dieu me garde, dit-il, de demander un pourboire ou un salaire pour un simple acte d’humanité.
Il aida donc le More à s’asseoir sur son âne et partit lentement pour Grenade, car le pauvre musulman était si faible qu’il dut le tenir des deux mains pour l’empêcher de tomber.
Lorsqu’ils atteignirent la ville, le porteur d’eau lui demanda où il devait le conduire.
— Hélas ! dit le More d’une voix expirante, je n’ai ni feu ni lieu, je suis étranger ici. Laisse-moi passer la nuit sous ton toit et tu seras largement récompensé.
Le bon Pérégil se voyait donc d’une manière tout inattendue cet infidèle sur les bras ; mais il était trop humain pour refuser l’hospitalité à un de ses semblables dans un cas aussi désespéré : Il mena le More chez lui.
Les enfants qui accouraient, suivant leur habitude, la bouche ouverte en entendant le pas de l’âne, rentrèrent dans la maison avec effarement quand ils virent l’étranger coiffé d’un turban et allèrent se cacher derrière les jupons de leur mère. Celle-ci s’avança hardiment, comme une poule alarmée s’élance devant ses poussins à l’approche d’un chien errant.
— Qu’est-ce à dire ? Un mécréant ? Un païen ? s’écria-t-elle. Est-ce là tout ce que tu nous amènes à cette heure indue, pour appeler sur nous les regards de l’Inquisition.
— Un peu de calme, ma femme, répartit le Gallégo. Voici un étranger malade, sans amis, sans asile. Aurais-tu le courage de le repousser pour le faire succomber dans la rue ?
La femme allait maugréer de plus belle, car bien que son gîte ressemblât à une tanière, elle n’en tenait pas moins à « la réputation de sa maison » ; mais cette fois le petit porteur d’eau voulut en faire à sa tête et se refusa positivement à se courber sous le joug. Il aida le pauvre musulman à mettre pied à terre, et étendit une natte et une peau de mouton pour lui sur le sol à l’endroit le plus frais de la maison, car il n’avait dans sa pauvreté pas d’autre lit à lui offrir.
Quelques instants après le More fut saisi de violentes convulsions qui défièrent toute la science médicale du Gallégo. Les yeux du malade exprimaient sa bonté. Dans un moment de calme, il l’appela près de lui et lui parlant à voix basse :
— Je sens, dit-il, que ma fin approche. Si je meurs, je te lègue cette boîte en récompense de ta charité.
En disant ces paroles, il ouvrit son burnous et fit voir une petite boîte en bois de sandal qu’il avait attachée à sa ceinture.
— Dieu veuille, mon ami, répondit le brave petit Gallégo, que vous puissiez vivre encore de longues années pour jouir vous-même de votre trésor quel qu’il soit.
Le More secoua la tête ; il mit la main sur la boîte et voulut entrer dans quelques explications, mais il fut saisi de nouvelles convulsions plus violentes et au bout de peu de temps il expira.
La femme du porteur d’eau était comme une folle.
— Voilà ce que tu gagnes, dit-elle, avec ta manie de te mettre dans l’embarras pour obliger les autres. Qu’allons-nous devenir si l’on trouve ce cadavre chez nous? Nous serons mis en prison et traités de meurtriers, et si nous en réchappons, les alguazils et les hommes de loi nous ruineront.
Le pauvre Pérégil n’était pas moins perplexe, et il se repentait presque d’avoir fait une bonne action. A la fin, il lui vint une idée.
— Il ne fait pas encore jour, dit-il, je vais porter le corps du More hors de la ville et l’enterrer dans le sable au bord du Xénil. Personne n’a vu cet étranger entrer chez nous et personne ne saura rien de sa mort.
Aussitôt dit, aussitôt fait.
La femme lui vint en aide. Ils roulèrent le corps du pauvre musulman dans la natte sur laquelle il venait d’expirer, le couchèrent en travers sur le baudet et Pérégil se mit en route pour la rivière.
Par malheur pour lui, le porteur d’eau avait pour voisin d’en face un barbier nommé Pédrillo Perdrugo, qui était bien le plus indiscret; le plus bavard et le plus méchamment malicieux de toute la tribu des faiseurs de cancans.
Il avait la mine d’un blaireau, des jambes d’araignée, l’allure insinuante. Le fameux barbier de Séville n’aurait pu l’égaler dans son penchant à se mêler des affaires d’autrui, et ce qu’il savait il ne le gardait pas plus qu’un crible.
On disait qu’il ne dormait que d’un œil et ne se couvrait qu’une oreille, de manière à pouvoir, même pendant son sommeil, voir et entendre tout ce qui se passait.
Ce qu’il y avait de sûr, c’est qu’il était une espèce de chronique scandaleuse pour les questionneurs de Grenade et qu’il avait plus de clients que tout le reste de la confrérie.
Or, ce barbier mêle-tout avait entendu Pérégil arriver chez lui la nuit à une heure inaccoutumée et les exclamations de la femme du Gallégo et de ses enfants avaient éveillé sa curiosité.
Une minute après, sa tête passait par la lucarne qui lui servait d’observatoire et il vit son voisin aider un homme vêtu du costume moresque à entrer chez lui.
Cet événement était si extraordinaire que Pédrillo Perdrugo n’en dormit pas de toute la nuit.
Toutes les cinq minutes il apparaissait à son poste, surveillant les lumières qui filtraient à travers les fentes de la porte de son voisin : avant le jour il aperçut Pérégil sortant mystérieusement de chez lui avec son âne portant une charge inusitée.
Le barbier inquisiteur avait la fièvre ; il endossa prestement ses habits et se glissant silencieusement hors de sa maison, il suivit prudemment à distance le porteur d’eau jusqu’à ce qu’il le vît creuser un trou dans le sable au bord du Xénil et y enfouir quelque chose qui avait tout l’air d’un cadavre.
Le barbier se hâta de rentrer, et ne fit que tourner dans sa boutique, mettant tous sens dessus dessous jusqu’au lever du soleil.
Alors, il prit son plat à barbe sous le bras et gagna à pas précipités la demeure de son client quotidien l’alcade.
L’alcade venait de se lever. Pédrillo Perdrugo attendit qu’il se fût assis dans un fauteuil, lui attacha la serviette au cou, lui passa le plat à barbe sous le menton et commença à lui adoucir le poils avec les doigts et la savonnette.
— Etranges aventures ! dit Perdrugo qui cumulait les rôles de raseur et de nouvelliste. Etranges aventures, vol, assassinat, inhumation clandestine, le tout en une nuit !
— Hein ! quoi ! qu’est-ce que vous dites ? cria l’alcade.
— Je dis, répliqua le barbier, en frottant la boule de savon sur le nez et la bouche du personnage, car le barbier espagnol dédaigne l’emploi du blaireau, je dis que Pérégil le Gallégo a volé et assassiné un More musulman et l’a enterré cette nuit. Maldita .sea la noche.
— Mais d’où savez-vous cela ? demanda l’alcade.
— Un peu de patience, senor, et vous saurez tout, répondit Pédrillo en lui pinçant le nez tandis qu’il promenait un rasoir sur sa joue.
Il raconta alors tout ce qu’il avait vu, en poursuivant ses deux besognes simultanément, c’est-à-dire en rasant, levant et essuyant avec une serviette sèche le menton de son client, pendant qu’il expliquait comme le musulman avait été volé, assassiné, enterré.
Or, il se faisait que cet alcade était le grippe-sou le plus envieux et le plus ladre de tout Grenade.
On ne pouvait nier, à vrai dire, qu’il ne fit grand cas de la justice, puisqu’il la vendait au poids de l’or.
Il se dit tout de suite que s’il s’agissait, dans l’espèce, d’un vol suivi de meurtre, il devait y avoir une riche dépouille en jeu ; le tout était de savoir comment elle passerait aux mains de la loi, car il importait de mettre d’une part le grappin sur le coupable et de fournir du gibier à la potence, puis d’autre part de se saisir du butin et d’enrichir le juge, ce qui, dans l’opinion de l’alcade, était le but suprême de la justice.
Pour donner suite à cette pensée il manda en sa présence son plus fidèle alguazil, un grand efflanqué de limier famélique, vêtu suivant l’usage de l’ancien costume espagnol : chapeau de castor à larges bords relevés, fraise prétentieuse, petite cape noir s’accrochant aux épaules, justaucorps et haut-de-chausse couleur de rouille, faisant ressortir sa charpente mince et osseuse. L’homme avait dans la main une baguette blanche, insigne redoutable de son emploi.
Tel était le chien de chasse remarquable pour la finesse de son flair que l’alcade lança sur la piste du pauvre porteur d’eau, et telle fut la promptitude du sbire à exécuter les ordres de son maître qu’avant même que l’infortuné Pérégil fût revenu chez lui, il fut appréhendé au corps et traîné avec son âne devant le magistrat.
L’alcade laissa peser sur lui son regard le plus terrible.
— Ecoute, bandit ! cria-t-il d’une voix qui fit tressaillir le petit Gallégo en entrechoquant ses genoux, écoute, bandit ! inutile de nier ton crime : je sais tout. Le forfait que tu as commis mérite la potence, mais je suis miséricordieux et prêt en entendre ta défense. L’homme que tu as assassiné chez toi était un More, un infidèle, un ennemi de notre foi. C’est sans doute par excès de zèle religieux, que tu l’as massacré. Je serai donc indulgent : restitue le bien que tu lui as pris et nous passerons l’éponge sur l’affaire.
Le pauvre porteur d’eau invoqua tous les saints pour attester son innocence ; mais hélas ! aucun d’eux ne comparut, et quand même ils auraient fait acte de présence, l’alcade était homme à récuser tout le calendrier.
Le porteur d’eau raconta toute l’histoire du More mourant avec la naïve franchise de la vérité ; mais il se disculpa vainement.
— Oses-tu soutenir, demanda le juge, que ce musulman n’avait ni or, ni bijoux, et que ce n’était point là l’objet de ta cupidité ?
— Sur mon salut, répliqua le porteur d’eau, il n’avait que cette petite boite en bois de sandal qu’il ma léguée pour prix de mes services.
— Une boîte de sandal ! une boîte de sandal ! s’exclama l’alcade, les yeux pétillant à l’idée de joyaux précieux. Et où est-elle cette boîte ? Où l’as-tu cachée ?
— S’il plaît à votre seigneurie de la faire prendre, répondit le porteur d’eau en tremblant, elle est dans l’un des bâts de mon âne, et je vous l’offre volontiers.
A peine avait-il achevé ces paroles que le vigilant alguazil s’éclipsa pour reparaître l’instant d’après avec la mystérieuse boîte de bois de sandal. L’alcade l’ouvrit avec impatience d’une main tressaillante. Tous trois se penchèrent pour admirer le trésor qu’elle devait recéler ; mais, à leur grand désappointement, ils ne virent qu’un petit rouleau de parchemin couvert de caractères arabes, et un bout de chandelle.
Quand il n’y a rien à gagner à la condamnation d’un inculpé, la justice, même en Espagne, incline à se montrer impartiale.
L’alcade, remis de son dépit et trouvant que l’affaire ne lui laissait en fin de compte pas de profit, écouta cette fois avec calme les explications du porteur d’eau, corroborées par le témoignage de sa femme…
Convaincu de son innocence, il le renvoya des fins de la poursuite et poussa même la bienveillance jusqu’à lui laisser emporter l’héritage du More, la boîte en bois de sandal, et tout ce qu’elle contenait, disant que c’était la légitime récompense de son humanité ; mais il garda l’âne pour solde des frais et dépens.
Voilà donc le malheureux petit Gallégo réduit une fois de plus à porter lui-même son eau et à grimper sur la pente raide qui conduit au puits de l’Alhambra avec une grande cruche en terre sur l’épaule.
Tandis qu’il gravissait la colline en ruisselant de sueur sous le soleil accablant de midi, il s’écriait, n’ayant plus rien cette fois de sa bonne humeur accoutumée :
— Chien d’alcade ! Voler ainsi un pauvre homme comme moi, lui dérober ses moyens d’existence et le meilleur ami qu’il eût au monde !
A ce souvenir du fidèle compagnon de ses travaux, toute la tendresse de son bon naturel se réveillait.
— Ah ! baudet de mon cœur ! s’exclama-t-il en déposant son fardeau sur une borne tandis qu’il essuyait la sueur de son front ; ah ! baudet de mon cœur ! Je suis sur que tu penses à ton vieux maître ! Je suis sûr que tu regrettes les cruches, pauvre bête !
Pour comble d’afflictions, sa femme le reçut, au retour, avec des jérémiades et des rebuffades.
Elle était bien sûre de ce qui arriverait, elle l’avait averti de ne pas céder à ces beaux élans généreux d’hospitalité qui avaient attiré sur lui tous ces malheurs ; et en femme qui s’y entend, elle profita de l’occasion pour faire valoir sa supériorité de tact et d’intelligence.
Quand les enfants manquaient de pain ou avaient besoin d’un vêtement neuf, elle leur répondait en ricanant :
— Allez donc trouver votre père ; il est l’héritier du roi de l’Alhambra ; dites-lui d’ouvrir sa fameuse boîte du More.
Jamais mortel ne fut plus cruellement puni d’avoir fait une bonne action.
Le pauvre Pérégil était froissé dans l’âme mais il n’en continuait pas moins à supporter sans murmure les railleries de sa moitié.
A la fin cependant, un soir, après une chaude journée de labeur, elle le taquina d’une manière si inusitée qu’il n’y tint plus.
Il ne se hasarda point à lui riposter, mais son œil se fixa sur la boîte de bois de sandal qui reposait sur une tablette, le couvercle soulevé comme si elle faisait la grimace à ceux qui l’oubliaient là. Il la saisit et la jeta violemment sur le carreau :
— Maudit soit le jour, s’écria-t-il, où j’ai jeté un regard sur toi et où j’ai abrité ici ton maître !
La boîte s’ouvrit tout à fait en tombant et le parchemin roula à terre.
Pérégil le considéra quelque temps en silence. A la fin, rassemblant ses idées :
— Qui sait ? pensa-t-il, peut-être cet écrit a-t-il quelque importance puisque le More semble l’avoir gardé avec tant de soin ?
Il le ramassa donc et le cacha sous son vêtement.
Le lendemain matin, en vendant de l’eau dans les rues, il s’arrêta à la porte d’un More, natif de Tanger, qui vendait de la bijouterie et de la parfumerie dans le Zacatin et lui demanda de lui expliquer le contenu de son rouleau.
Le More lut attentivement le parchemin, puis caressa sa barbe et sourit.
— Ce manuscrit, dit-il, est une formule d’incantation pour recouvrer un trésor caché, qui est sous le pouvoir d’un enchantement.
Cette formule a, prétend-on, une vertu telle que les serrures et les verroux les plus solides ne pourraient lui résister.
— Bah ! s’écria le petit Gallégo, à quo cela peut-il me servir ? Je ne suis pas magicien et je n’entends rien aux trésors cachés.
En disant ces paroles, il hissa sa cruche sur son épaule, laissa le rouleau dans les mains du More et poursuivit sa course accoutumée.
Mais le même soir, comme il se reposait au crépuscule près du puits de l’Alhambra, il trouva un grand nombre de commères assemblées en cet endroit.
Leurs conversations, comme d’ordinaire a cette heure où les ombres commencent à envahir la nature, roulaient sur les vieilles légendes, les traditions du temps jadis et les faits surnaturels.
Comme ils étaient tous, tant qu’ils étaient là, aussi pauvres que des rats d’église, ils prenaient un plaisir tout particulier à ressasser les histoires populaires des trésors enchantés abandonnés par les Mores en divers endroits de l’Alhambra.
Tous s’accordaient d’ailleurs à croire qu’il y avait de grandes richesses enfouies sous la tour des sept étages.
Ces récits firent une impression extraordinaire sur l’esprit de Pérégil et le plongèrent dans de profondes méditations où il s’abîmait encore quand il s’en alla seul en descendant l’avenue déjà ténébreuse.
— S’il était vrai pourtant, dit-il, qu’il y eût un trésor dans cette tour, et si le rouleau que j’ai laissé au More pouvait m’en mettre en possession !
Cette pensée le transportait tellement qu’il faillit laisser tomber sa cruche.
Cette nuit-là, il remua et rumina tout le temps, et put à peine fermer l’œil tant les idées se pressaient en foule dans son cerveau et l’obsédaient.
De bonne heure, il courut à la boutique du More et lui dit ce qu’il avait roulé dans son esprit.
— Vous savez lire l’arabe, dit-il; si nous allions tous deux à la tour essayer l’effet du charme, qu’en pensez-vous ? Supposez que notre expérience échoue, nous ne nous en trouverons pas plus mal ; mais si nous réussissons, nous partagerons ensemble le trésor que nous aurons découvert.
— Un moment, répliqua le musulman ; cet écrit ne suffit point par lui-même pour opérer l’incantation. Il faut qu’on le lise à minuit, à la lumière d’une chandelle composée et préparée avec de singuliers ingrédients que je ne pourrais me procurer. Sans la chandelle, le rouleau ne nous sert à rien.
— Paix ! s’écria le petit Gallégo. J’ai la chandelle dont tu parles. Attends-moi là, je la rapporte en un clin d’œil.
Tout en parlant, il courut chez lui et revint bientôt avec le bout de chandelle de cire jaune qu’il avait trouvée, dans la boîte de sandal.
Le More tâta la chandelle et la flaira.
— Nous avons ici un composé de parfums rares et précieux, dit-il, et de cire jaune. C’est bien le genre de chandelle spécifié dans le rouleau. Tant qu’elle brûle, les murailles les plus épaisses, les cavernes les plus secrètes s’ouvrent d’elles-même. Mais malheur à celui qui s’attarde jusqu’à ce qu’elle soit éteinte : il restera enfermé à jamais avec le trésor.
Il fut donc convenu entre eux qu’ils essayeraient le pouvoir du charme la nuit suivante.
A une heure avancée, quand il n’y avait plus dehors que les chauves-souris et les hiboux, ils gravirent la colline boisée de l’Alhambra et s’approchèrent de la terrible tour, abritée sous les arbres et rendue formidable par tant de récits légendaires.
A la lueur d’une lanterne, ils se frayèrent un chemin à travers les broussailles, bronchant sur les pierres tombées, se heurtant aux ronces, et arrivèrent enfin devant une porte.
La mort dans l’âme, ils descendirent plusieurs marches d’un escalier creusé dans le roc. Cet escalier conduisait à une chambre vide, humide et sinistre, d’où partait une autre série de degrés menant à une voûte plus profonde.
Ils descendirent ainsi quatre escaliers successifs, donnant accès à autant de voûtes de plus en plus basses. Sous la quatrième, on marchait de plain pied.
La tradition rapportait, à vrai dire, qu’il y avait encore trois souterrains au-dessous, mais il était, disait-on, impossible d’y pénétrer parce qu’ils étaient enchantés.
L’atmosphère de cette dernière voûte était humide et glacée, et les émanations y étaient si denses, que la lumière y projetait à peine quelques faibles rayons.
Ils s’arrêtèrent quelque temps pour reprendre haleine, jusqu’à ce qu’ils eussent entendu, à l’horloge de la tour, sonner minuit.
Alors ils allumèrent la chandelle de cire, qui répandit en brûlant une odeur de myrrhe, d’encens et de styrax.
Le More se mit ensuite à lire d’une voix rapide.
Il avait à peine fini qu’on entendit un bruit de tonnerre souterrain. La terre s’ébranla, le sol s’ouvrit violemment et mit à découvert un escalier.
Tremblants d’effroi, ils descendirent, à la lueur de la lanterne, et se trouvèrent bientôt dans une autre voûte, couverte d’inscriptions arabes.
Au centre se voyait un grand coffre, fermé par sept bandes d’acier ; à chaque bout du coffre était assis un More enchanté, revêtu de son armure, mais immobile comme une statue et soumis au pouvoir de l’enchanteur.
Devant le coffre se trouvaient plusieurs cruches remplies d’or, d’argent et de pierres précieuses. Ils y enfoncèrent tous deux leurs bras jusqu’au coude et en retirèrent à chaque fois des poignées de grandes pièces jaunes de monnaie d’or moresque, des bracelets et des ornements du même métal, des colliers de perles d’Orient s’enroulant sur leurs doigts. Ils en remplirent leurs poches, non sans trembler, non sans jeter un regard craintif sur les Mores enchantés, qui, sombres et immobiles, les fixaient du regard sans cligner les yeux.
A la fin, saisis de panique, comme ils s’imaginaient entendre quelque bruit, ils s’élancèrent tous deux en même temps vers l’escalier, tombèrent l’un par-dessus l’autre, gagnèrent la pièce au-dessus, et là, épuisés de fatigue, hors d’haleine, éteignirent la chandelle de cire. Au même instant, les dalles qui couvraient le sol se refermèrent avec le fracas du tonnerre.
Muets de terreur, ils n’osèrent s’arrêter que lorsqu’ils furent sortis de la tour et virent briller les étoiles à travers le feuillage des arbres. Alors ils s’assirent sur l’herbe et firent deux parts égales de leur butin.
Cependant, ils étaient bien décidés à ne pas se borner à écumer les cruches, mais à y revenir la nuit d’après et à les vider jusqu’au fond. Pour être sûrs de leur bonne foi réciproque, ils se partagèrent aussi les talismans, l’un gardant le rouleau, l’autre la chandelle.
Cela fait, ils s’en retournèrent à Grenade, le cœur léger et les poches bien garnies.
Comme ils dévalaient de la colline, le More, aussi rusé que prudent, glissa une parole de bon conseil dans l’oreille du naïf petit porteur d’eau.
— Ami Pérégil, dit-il, tout ceci doit rester profondément secret jusqu’à ce que nous nous soyons emparés de tout le trésor et l’ayons déposé en lieu sûr. S’il en arrivait rien qu’une syllabe aux oreilles de l’alcade, nous serions perdus.
— Assurément, répliqua le Gallégo, rien n’est plus vrai.
— Ami Pérégil, reprit le More, vous êtes un homme discret et je suis absolument sûr que vous pouvez garder un secret ; mais vous avez une femme.
— Elle n’en saura pas un mot, répondit le petit porteur d’eau résolument.
— Soit, dit le More, je compte sur votre discrétion et sur votre promesse.
Et, de fait, il ne pouvait y avoir de promesse plus positive et plus sincère.
Mais, hélas ! quel est l’homme qui peut cacher un secret à sa femme ?
Sans aucun doute, ce n’était pas Pérégil le Gallégo qui était le mari le plus aimant et le plus accommodant.
En rentrant chez lui, il trouva sa femme qui boudait dans un coin.
— Voilà qui va bien, dit-elle en l’apercevant, tu te décides à la fin à rentrer. S’il est permis de rôder ainsi en pleine nuit ! Je m’étonne de ne pas te voir nous remener un autre More.
Puis, fondant en larmes, elle se tordit les mains et se frappa la poitrine.
— Pauvre femme que je suis ! s’exclama-t-elle, que vais-je devenir ! Ma maison pillée par les hommes de loi et par les alguazils ; mon mari un propre à rien qui n’apporte plus de pain chez lui pour sa famille et va flâner nuit et jour avec des Mores infidèles. O mes enfants ! mes enfants ! quel sort vous attend ! nous serons bientôt réduits à mendier dans les rues.
Le brave Pérégil était tellement touché de la désolation de sa femme qu’il ne put s’empêcher d’éclater lui-même en sanglots.
Il avait le cœur aussi plein que la poche et il ne pouvait se maîtriser. A la fin il plongea la main dans cette dernière et il en tira trois ou quatre grandes pièces d’or qu’il glissa dans le corsage de sa femme.
Celle-ci resta abasourdie, ne comprenant rien à cette pluie d’or. Mais avant qu’elle fut revenue de sa surprise, le petit Gallégo avait fait briller à ses yeux une chaîne d’or qu’il balança au-dessus de sa tête, en bondissant de joie, et en ouvrant la bouche d’une oreille à l’autre.
— Sainte Vierge, protégez-moi ! s’exclama la femme. Qu’as-tu fait, Pérégil ? J’espère bien que tu n’as pas commis un vol et un assassinat ?
Le soupçon était à peine entré dans la cervelle de la pauvre femme qu’il devint pour elle une certitude.
Elle vit la prison et la potence à l’horizon, et un petit Gallégo bancal, se balançant au gibet.
Accablée sous les horreurs évoquées dans son imagination, elle eut une violente attaque de nerfs.
Que restait-il à faire au pauvre homme ?
Pour calmer sa femme et chasser les visions qui la hantaient, il n’avait pas d’autre moyen que de lui raconter toute l’histoire de sa bonne fortune.
Il ne le fit toutefois qu’après lui avoir fait faire le serment solennel de ne confier à personne son secret.
Il serait impossible de dépeindre la joie de la femme du Gallégo. Elle jeta ses deux bras au cou de son mari et l’étrangla presque dans son transport.
— Eh bien, femme, fit le petit homme en laissant déborder son contentement, que dis-tu maintement de l’héritage du More ? Désormais tu ne m’en voudras plus d’avoir prêté secours à un de mes semblables en péril.
Le brave Gallégo regagna sa peau de mouton et sa natte et dormit d’un sommeil aussi profond que s’il avait eu un lit de duvet.
Mais il n’en fut pas de même de sa femme. Elle vida tout le contenu des poches de son mari sur la natte et passa toute la nuit à compter et à recompter les pièces d’or arabes, à essayer les colliers et les boucles d’oreilles, à se représenter le rôle qu’elle allait jouer dans le monde, lorsqu’il lui serait permis de jouir de ses richesses.
Le lendemain matin, le brave Pérégil prit une grande pièce d’or qu’il porta à la boutique d’un bijoutier du Zacatin. Il lui proposa de l’acheter, disant qu’il l’avait trouvée dans les ruines de l’Alhambra.
Le bijoutier vit que la pièce portait une inscription arabe et qu’elle était du meilleur aloi. Il n’en offrit toutefois que le tiers de la valeur et le porteur d’eau se montra satisfait du marché.
Pérégil acheta aussi des habits neufs pour son petit troupeau, et toutes sortes de jouets, avec d’amples et excellentes provisions de bouche, puis il revint à la maison, fit danser les enfants autour de lui, sauta lui-même comme un cabri en répétant qu’il était le plus heureux des pères.
La femme du porteur d’eau tint sa promesse et garda le secret avec une fidélité surprenante.
Pendant un jour et demi, on la vit aller et venir avec des airs de mystère, le cœur gonflé à éclater, mais se contenant quand même, bien qu’elle fût entourée de commères.
Il est vrai qu’elle ne put s’empêcher de faire quelques minauderies, en s’excusant de se montrer en haillons, et en ajoutant qu’elle allait se faire faire une basquine neuve toute garnie de dentelles d’or et de jais, avec une mantille neuve en dentelles.
Elle laissa glisser quelques mots sur l’intention qu’avait son mari de quitter son métier de porteur d’eau, qui ne valait rien pour sa santé.
Au fait, elle pensait se retirer à la campagne tout l’été, afin de laisser les enfants profiter du bon air de la montagne en cette saison où dans la ville il n’y a âme qui vive.
Les voisins se regardaient les uns les autres avec de grands yeux. Ils crurent que la pauvre femme avait perdu la raison. Son allure, ses airs, ses projets de luxe étaient l’objet de tous les commentaires et c’était à qui de ses amis en ferait des gorges chaudes dès qu’elle eut le dos tourné.
Cependant, si elle s’était retenue au dehors, elle se rattrapa une fois rentrée chez elle.
Aussitôt elle s’attacha au cou un magnifique collier de perles d’Orient, aux bras des bracelets moresques, sur la tête une aigrette en diamants.
Elle faisait les cent pas dans sa chambre, se drapant fièrement dans ses vêtements crasseux et déguenillés, et s’arrêtant de temps à autre pour se mirer dans un bout de glace cassée.
Enfin, cédant à un mouvement de naïve vanité, elle ne put résister au désir de se montrer un instant à la fenêtre pour jouir de l’effet produit sur les passants par ses bijoux.
Comme si la fatalité s’en fût mêlée, le barbier indiscret, Pédrillo Perdrugo, était en ce moment assis oisif dans sa boutique.
Son regard toujours vigilant saisit les feux des diamants. En un clin d’œil il fut à sa lucarne pour épier la femme d’ordinaire dépenaillée du porteur d’eau, qui se promenait maintenant chez elle aussi splendidement parée qu’une beauté orientale.
Il n’eut pas plus tôt fait un inventaire exact de ses ornements qu’il courut à toutes jambes chez l’alcade.
Quelques instants après l’alguazil famélique était de nouveau en quête, et avant la fin du jour, l’infortuné Pérégil se voyait derechef traîner devant le juge.
— Qu’est-ce à dire, coquin ? s’écria le magistrat d’une voix furieuse. Tu m’avais affirmé que l’infidèle qui est mort chez toi n’avait laissé qu’une boîte vide, et voilà que j’apprends que ta femme se carre et se pavane en haillons, couverte de perles et de diamants des pieds à la tête. Misérable que tu es ! prépare toi à rendre gorge, à me remettre les dépouilles de ta malheureuse victime et à te balancer au gibet qui se lasse de t’attendre !
Le porteur d’eau terrifié tomba à genoux et fit le récit complet de la manière merveilleuse dont il avait acquis son trésor. L’alcade, l’alguazil et le barbier curieux écoutaient avidement ce conte arabe du trésor enchanté.
L’alguazil fut dépêché pour amener le More qui avait assisté à l’incantation.
Le musulman entra à moitié affolé de se trouver dans les griffes des harpies de la loi.
Lorsqu’il vit le porteur d’eau l’oreille basse, l’air penaud et décontenancé, il comprit d’un seul coup toute l’affaire.
— Misérable animal, dit-il en passant à côté de lui, ne t’avais-je pas mis en garde contre ta femme ?
La version du More coïncidait exactement avec celle de son compère ; mais l’alcalde affecta de se montrer rebelle à en accepter l’authenticité, et se répandit en menaces d’emprisonnement et de sévères recherches.
— Doucement, mon bon senor alcalde, dit le musulman qui avait eu le temps de recouvrer sa présence d’esprit et son astuce ordinaire ; ne gâtons pas les faveurs de la fortune en nous les disputant. Personne, hormis nous, ne sait rien de tout ceci. Gardons-en le secret. Il y a dans le souterrain assez de richesses pour nous tous. Promettez-nous d’en faire l’honnête partage et nous vous en mettrons en possession avec nous ; refusez et le souterrain restera fermé à jamais.
L’alcalde se consulta en aparté avec l’alguazil. Celui-ci était un vieux renard.
— Promettez tout ce qu’ils veulent, dit-il, en attendant que vous ayez le trésor sous la main. Il vous sera facile alors de saisir le tout et si le More et son complice osent murmurer, menacez-les du bûcher comme infidèles et sorciers.
L’alcade goûta l’avis. Son front se rasséréna et se tournant vers le More :
— C’est une histoire étrange, fit-il. Je ne dis pas qu’elle n’est pas vraie, mais je veux en avoir la preuve de mes yeux. La nuit prochaine tu répéteras ton incantation en ma présence. S’il y a vraiment un trésor nous le partagerons entre nous en amis et il n’en sera plus question ; si, au contraire, vous m’avez trompé, n’espérez aucune merci de ma part. En attendant vous restez, l’un et l’autre mes prisonniers.
Le More et le porteur d’eau acceptèrent avec joie ces conditions, car ils étaient sûrs que l’événement prouverait la vérité de leurs paroles.
Vers minuit, l’alcade sortit secrètement, escorté de l’alguazil et du barbier factotum, tous trois armés jusqu’aux dents.
Ils conduisirent le More et le porteur d’eau en les faisant marcher comme des captifs. Ils avaient avec eux l’âne du Gallégo pour porter le trésor attendu.
Ils arrivèrent à la tour sans que personne les eût remarqués et ils attachèrent le baudet à un figuier ; puis ils descendirent jusqu’au quatrième souterrain de la tour.
Là, on déroula le parchemin, on alluma la chandelle de cire jaune et le More lut la formule d’incantation.
La terre trembla comme la première fois : les dalles s’ouvrirent avec le fracas du tonnerre, et laissèrent voir un escalier étroit.
L’alcade, l’alguazil et le barbier étaient pétrifiés de stupeur et n’avaient pas le courage de descendre.
Le More et le porteur d’eau entrèrent dans le souterrain ouvert à leurs pieds et virent les Mores assis comme auparavant en silence et immobiles.
Ils emportèrent deux des grandes cruches remplies de monnaie d’or et de pierres précieuses.
Le porteur d’eau les porta l’une après l’autre sur ses épaules; mais quoiqu’il eût le dos et les reins solides et fût accoutumé aux fardeaux, il fléchissait sous leur poids et quand il les eut attachées de chaque côté de l’âne, il trouva que la bête en avait toute sa charge.
— Contentons-nous de ceci, dit le More, nous avons là tout ce que nous pouvons emporter de richesses sans être vu et sans éveiller les soupçons ; et il y en a certes assez pour nous enrichir autant que nous pouvons le souhaiter.
— Il y a donc d’autres trésors dans le souterrain ? demanda l’alcade.
— Il y a le plus grand de tous, dit le More, un coffre immense garni de bandes d’acier et rempli de perles et de pierres précieuses.
— Je veux ce coffre à tout prix, s’écria l’avide alcade.
— Moi, je ne descends plus à aucun prix, dit le More résolument ; je me contente de ma part, elle suffit à un homme raisonnable, le reste n’est plus que du superflu.
— Et moi, dit le porteur d’eau, je ne monterai plus rien; je ne veux pas écraser mon pauvre baudet.
Ordres, menaces, prières, tout fut inutile. Alors l’alcade s’adressa à ses deux acolytes.
— Aidez-moi, dit-il, à porter ce coffre et nous partagerons son contenu entre nous trois.
En disant ces paroles, il descendit les marches suivi de l’alguazil et du barbier hésitants et tremblants.
Le More ne les vit pas plutôt dans le souterrain qu’il éteignit la chandelle jaune ; les dalles se refermèrent avec leur fracas accoutumé et les trois personnages restèrent ensevelis dessous.
Alors le musulman gravit les marches de l’escalier et ne s’arrêta que lorsqu’il fut sous le ciel bleu. Le petit porteur d’eau le suivait d’aussi près que le lui permettaient ses petites jambes.
— Qu’as-tu fait ? s’écria Pérégil, dès qu’il put reprendre haleine. L’alcade et les deux autres sont enfermés dans le souterrain.
— Allah le veut ! dit le More dévotement.
— Et n’iras-tu point les délivrer? demanda le Gallégo.
— Allah le défend ! répliqua le More en caressant sa barbe. Il est écrit dans le livre du destin qu’ils resteront enchantés jusqu’à ce que quelque futur aventurier vienne rompre le charme. Que la volonté d’Allah soit faite !
Il dit et lança le bout de chandelle dans les buissons de la vallée.
Il n’y avait plus de remède. Le More et le porteur d’eau se mirent en marche vers la ville avec l’âne chargé de trésors. Le bon Pérégil ne put s’empêcher de combler de caresses et de baisers son compagnon de labeur aux longues oreilles, qui lui était rendu et échappait comme lui aux griffes de la justice. Il eût été difficile de dire si le naïf petit bonhomme était plus heureux d’avoir le trésor ou de rentrer en possession de son aliboron.
Les deux camarades de bonne fortune partagèrent loyalement leur butin.
Seulement le More, qui avait peu de goût pour les gros objets, s’arrangea de manière à voir dans son tas le plus de perles et de pierres précieuses en laissant le porteur d’eau prendre de magnifiques bijoux d’or qui pesaient quatre et cinq fois plus. Et le brave petit Pérégil était ravi de ce mode d’arrangement.
Ils eurent bien soin cette fois de se garer des curieux et des alcades, et s’empressèrent d’emporter leurs richesses à l’étranger.
Le More retourna en Afrique dans sa ville natale de Tanger, et le Gallégo avec sa femme, ses enfants et son âne prit la route du Portugal. Là, grâce aux conseils de sa femme, il devint un personnage important, car elle apprit au petit homme à porter comme il faut un pourpoint et des hauts-de-chausse, une plume au chapeau, une épée au côte, et lui fit quitter son nom vulgaire de Pérégil pour prendre le titre plus sonore de Don Pedro Gil.
Leurs enfants menèrent une vie prospère et joyeuse, mais restèrent petits et bancals ; quant à la senora Gil, couverte de dentelles, de rubans, de broderies de la tête aux pieds, les doigts chargés de bagues étincelantes, elle donna le ton, elle fut l’arbitre de la mode, de la parure, du gaspillage et du faux goût.
De l’alcade et de ses acolytes il n’en a plus été question. Ils restèrent ensevelis sous la grande tour des sept souterrains et ils y sont très probablement encore.
Partout où il y aura en Espagne disette de barbiers curieux, d’alguazils escrocs, d’alcades corrompus, on se mettra peut-être en quête d’eux ; mais s’ils doivent attendre jusque-là pour leur délivrance, ils courent grand risque de voir se prolonger leur ensorcellemment jusqu’au jugement dernier.
Source : BNF Gallica
Le texte ci-dessus est normalement identique à celui du document scanné (coquilles y compris ; seuls quelques points manquants ont été rajoutés) :
Marc BARBOU & Cie, Imprimeurs-Libraires
LIMOGES
1890
Illustration : Ludwig Deutsch (1855-1935)
LILITH
par Marcel Schwob (1867-1905)
[i]Not a drop of her blood was human,
But she was made like a soft sweet woman[/i].
DANTE-GABRIEL ROSSETTI.
Je pense qu'il l'aima autant qu'on peut aimer une femme ici-bas ; mais leur histoire fut plus triste qu'aucune autre. Il avait longtemps étudié Dante et Pétrarque ; les formes de Béatrice et de Laure flottaient devant ses yeux et les divins vers où resplendit le nom de Françoise de Rimini chantaient à ses oreilles.
Il avait passionnément aimé dans la première ardeur de sa jeunesse les vierges tourmentées du Corrège, dont les corps voluptueusement épris du ciel ont des yeux qui désirent, des bouches qui palpitent et appellent douloureusement l'amour. Plus tard, il admira la pâle splendeur humaine des figures de Raphaël, et leur sourire paisible, et leur contentement virginal. Mais lorsqu'il fut lui-même, il choisit pour maître, comme Dante, Brunetto Latini, et vécut dans son siècle, où les faces rigides ont l'extraordinaire béatitude des paradis mystérieux.
Et, parmi les femmes, il connut d'abord Jenny, qui était nerveuse et passionnée, dont les yeux étaient adorablement cernés, noyés d'une humidité langoureuse avec un regard profond. Ce fut un amant triste et rêveur ; il cherchait l'expression de la volupté avec une âcreté enthousiaste ; et quand Jenny s'endormait, lassée, aux rayons du matin, il épandait les guinées brillantes parmi ses cheveux ensoleillés ; puis, contemplant ses paupières battues et ses longs cils qui reposaient, son front candide qui semblait ignorant du péché, il se demandait amèrement, accoudé sur l'oreiller, si elle ne préférait pas l'or jaune à son amour, et quels rêves désenchantants passaient sous les parois transparentes de sa chair.
Puis il imagina les filles des temps superstitieux, qui envoûtaient leurs amants, ayant été abandonnées par eux ; il choisit Hélène, qui tournait dans une poêle d'airain l'image en cire de son fiancé perfide : il l'aima, tandis qu'elle lui perçait le coeur avec sa fine aiguille d'acier. Et il la quitta pour Rose-Mary, à qui sa mère, qui était fée, avait donné un globe cristallin de béryl comme gage de sa pureté. Les esprits du béryl veillaient sur elle et la berçaient de leurs chants.
Mais lorsqu'elle succomba, le globe devint couleur d'opale, et elle le fendit d'un coup de glaive dans sa fureur ; les esprits du béryl s'échappèrent en pleurant de la pierre brisée, et l'âme de Rose-Mary s'envola avec eux.
Alors il aima Lilith, la première femme d'Adam, qui ne fut pas créée de l'homme. Elle ne fut pas faite de terre rouge, comme Éve, mais de matière inhumaine ; elle avait été semblable au serpent, et ce fut elle qui tenta le serpent pour tenter les autres. Il lui parut qu'elle était plus vraiment femme, et la première, de sorte que la fille du Nord qu'il aima finalement dans cette vie, et qu'il épousa, il lui donna le nom de Lilith.
Mais c'était un pur caprice d'artiste ; elle était semblable à ces figures préraphaélites qu'il faisait revivre sur ses toiles. Elle avait les yeux de la couleur du ciel, et sa longue chevelure blonde était lumineuse comme celle de Bérénice, qui, depuis qu'elle l'offrit aux dieux, est épandue dans le firmament. Sa voix avait le doux son des choses qui sont près de se briser ; tous ses gestes étaient tendres comme des lissements de plumes ; et si souvent elle avait l'air d'appartenir à un monde diffèrent de celui d'ici-bas qu'il la regardait comme une vision.
Il écrivit pour elle des sonnets étincelants, qui se suivaient dans l'histoire de son amour, et il leur donna le nom de Maison de la vie. Il les avait copiés sur un volume fait avec des pages de parchemin ; l'oeuvre était semblable à un missel patiemment enluminé.
Lilith ne vécut pas longtemps, n'étant guère née pour cette terre ; et comme ils savaient tous deux qu'elle devait mourir, elle le consola du mieux qu'elle put.
«Mon aimé, lui dit-elle, des barrières d'or du ciel je me pencherai vers toi ; j'aurai trois lys à la main, sept étoiles aux cheveux. Je te verrai du pont divin qui est tendu sur l'éther ; et tu viendras vers moi et nous irons dans les puits insondables de lumière. Et nous demanderons à Dieu de vivre éternellement comme nous nous sommes aimés un moment ici-bas».
Il la vit mourir, tandis qu'elle disait ces mots et il en fit aussitôt un poème magnifique, le plus beau joyau dont on eût jamais paré une morte. Il pensa qu'elle l'avait quitté déjà depuis dix ans ; et il la voyait, penchée sur les barrières d'or du ciel, jusqu'à ce que la barre fût devenue tiède à la pression de son sein, jusqu'à ce que les lys se fussent assoupis dans ses bras. Elle lui murmurait les mêmes paroles ; puis elle écoutait longtemps et souriait : «Tout cela sera quand il viendra», disait-elle. Et il la voyait sourire ; puis elle tendait ses bras le long des barrières, et elle plongeait sa figure dans ses mains, et elle pleurait. Il entendait ses pleurs.
Ce fut la dernière poésie qu'il écrivit dans le livre de Lilith. Il le ferma - pour jamais - avec des fermoirs d'or, et, brisant sa plume, il jura qu'il n'avait été poète que pour elle, et que Lilith emporterait sa gloire dans sa tombe.
Ainsi les anciens rois barbares entraient en terre suivis de leurs trésors et de leurs esclaves préférés. On égorgeait au-dessus de la fosse ouverte les femmes qu'ils aimaient, et leurs âmes venaient boire le sang vermeil.
Le poète qui avait aimé Lilith lui donnait la vie de sa vie et le sang de son sang ; il immolait son immortalité terrestre et mettait au cercueil l'espoir des temps futurs.
Il souleva la chevelure lumineuse de Lilith, et plaça le manuscrit sous sa tête ; derrière la pâleur de sa peau il voyait luire le maroquin rouge et les agrafes d'or qui resserraient l'oeuvre de son existence.
Puis il s'enfuit, loin de la tombe, loin de tout ce qui avait été humain, emportant l'image de Lilith dans son coeur et ses vers qui sonnaient dans son cerveau. Il voyagea, cherchant les paysages nouveaux, ceux qui ne lui rappelaient pas son amie. Car il voulait en garder le souvenir par lui-même, non que la vue des objets indifférents la fit reparaître à ses yeux, non pas une Lilith humaine en vérité, telle qu'elle avait semblé être dans une forme éphémère, mais une des élues, idéalement fixée au-delà du ciel, et qu'il irait rejoindre un jour.
Mais le bruit de la mer lui rappelait ses pleurs, et il entendait sa voix dans la basse profonde des forêts ; et l'hirondelle, tournant sa tête noire, semblait le gracieux mouvement du cou de sa bien-aimée, et le disque de la lune, brisé dans les eaux sombres des étangs de clairière, lui renvoyait des milliers de regards dorés et fuyants.
Soudain une biche entrant au fourré lui étreignait le coeur d'un souvenir ; les brumes qui enveloppent les bosquets à la lueur bleutée des étoiles prenaient forme humaine pour s'avancer vers lui, et les gouttes d'eau de la pluie qui tombe sur les feuilles mortes semblaient le bruit léger des doigts aimés.
Il ferma ses yeux devant la nature ; et dans l'ombre où passent les images de lumière sanglante, il vit Lilith, telle qu'il l'avait aimée, terrestre, non céleste, humaine, non divine, avec un regard changeant de passion et qui était tour à tour le regard d'Hélène, de Rose-Mary et de Jenny ; et quand il voulait se l'imaginer penchée sur les barrières d'or du ciel, parmi l'harmonie des sept sphères, son visage exprimait le regret des choses de la terre, l'infélicité de ne plus aimer.
Alors il souhaita d'avoir les yeux sans paupières des êtres de l'enfer, pour échapper à de si tristes hallucinations.
Et il voulut ressaisir par quelque moyen cette image divine. Malgré son serment, il essaya de la décrire, et la plume trahit ses efforts. Ses vers pleuraient aussi sur Lilith, sur le pâle corps de Lilith que la terre enfermait dans son sein. Alors il se souvint (car deux années s'étaient écoulées) qu'il avait écrit de merveilleuses poésies où son idéal resplendissait étrangement. Il frissonna.
Quand cette idée l'eut repris, elle le tint tout entier. Il était poète avant tout ; Corrège, Raphaël et les maîtres préraphaélites, Jenny, Hélène, Rose-Mary, Lilith n'avaient été que des occasions d'enthousiasme littéraire. Même Lilith ? Peut-être, - et cependant Lilith ne voulait revenir à lui que tendre et douce comme une femme terrestre. - Il pensa à ses vers, et il lui en revint des fragments, qui lui semblèrent beaux. Il se surprit à dire : «Et pourtant il devait y avoir là des choses bien». Il remâcha l'âcreté de la gloire perdue. L'homme de lettres revécut en lui et le rendit implacable.
.............................................................................................................................
Un soir il se retrouva, tremblant, poursuivi par une odeur tenace qui s'attache aux vêtements, avec de la moiteur de terre aux mains, un fracas de bois brisé dans les oreilles - et devant lui le livre, l'oeuvre de sa vie qu'il venait d'arracher à la mort. Il avait volé Lilith ; et il défailllait à la pensée des cheveux écartés, de ses mains fouillant parmi la pourriture de ce qu'il avait aimé, de ce maroquin terni qui sentait la morte, de ces pages odieusement humides d'où s'échapperait la gloire avec un relent de corruption.
Et lorsqu'il eut revu l'idéal un instant senti, quand il crut voir de nouveau le sourire de Lilith et boire ses larmes chaudes, il fut pris du frénétique désir de cette gloire. Il lança le manuscrit sous les presses d'imprimerie, avec le remords sanglant d'un vol et d'une prostitution, avec le douloureux sentiment d'une vanité inassouvie. Il ouvrit au public son coeur, et en montra les déchirements ; il traîna sous les yeux de tous le cadavre de Lilith et son inutile image parmi les demoiselles élues ; et de ce trésor forcé par un sacrilège, entre les ruissellements des phrases, retentissent des craquements de cercueil.
Illustration : Lilith (1892), par John Collier.
LA DAME NOIRE par Alexandre DUMAS
Alexandre DUMAS
Il y avait déjà deux cents ans que le château n’était plus qu’un monceau de pierres écroulées, et au milieu de ces pierres avait poussé un magnifique érable que plusieurs fois les paysans des environs voulurent abattre sans pouvoir y réussir, tant son bois était dur et noueux. Enfin, un jeune homme, nommé Wilhelm, vint à son tour pour tenter l’aventure ; comme les autres, et après avoir jeté bas son habit, saisissant une hache qu’il avait fait affiler tout exprès, il frappa le tronc de l’arbre de toute sa force, mais l’arbre repoussa le fer comme s’il eut été d’acier. Wilhelm ne se rebuta point et frappa un second coup, la hache fut repoussée de nouveau ; enfin, il leva le bras et, rassemblant toutes ses forces, il frappa un troisième coup, mais à ce troisième coup, ayant entendu comme un soupir, il leva les yeux et aperçut devant lui une femme de vingt-huit à trente ans, vêtue de noir, et qui eût été parfaitement belle si sa pâleur n’eut donné à toute sa personne un aspect cadavéreux qui indiquait que depuis longtemps cette femme n’appartenait plus à ce monde.
– Que veux-tu faire de cet arbre ? demanda la Dame Noire.
– Madame, dit Wilhelm en la regardant avec étonnement, car il ne l’avait pas vue venir, et il ne pouvait deviner d’où elle sortait ; madame, j’en veux faire une table et des chaises, car je me marie à la Saint-Martin prochain avec Roschen, ma fiancée, que j’aime depuis trois ans.
– Promets-moi d’en faire un berceau pour ton premier-né, répondit la Dame Noire, et je lèverai le charme qui défend cet arbre contre la hache du bûcheron.
– Je vous le promets, madame, dit Wilhelm.
– Eh bien ! frappe ! répondit la dame.
Wilhelm leva sa hache, et du premier coup il fit dans le tronc une entaille profonde ; au second coup, l’arbre trembla depuis son faîte jusqu’à ses racines ; au troisième, il tomba entièrement détaché de sa base et roula sur le sol. Alors Wilhelm leva la tête pour remercier la Dame Noire, mais la Dame Noire avait disparu.
Wilhelm n’en tint pas moins la promesse qu’il lui avait faite, et quoiqu’on le plaisantât fort de ce qu’il faisait le berceau de son premier-né avant que le mariage ne fût accompli, il ne s’en mit pas moins à l’ouvrage avec tant d’ardeur et d’adresse, qu’avant que huit jours se fussent écoulés, il avait achevé un charmant berceau.
Le lendemain il épousa Roschen, et neuf mois après, jour pour jour, Roschen accoucha d’un beau garçon, que l’on déposa dans son berceau d’érable.
La même nuit, comme l’enfant pleurait et que sa mère, de son lit, le berçait dans son berceau, la porte de la chambre s’ouvrit, et la Dame Noire parut sur le seuil, tenant à la main un rameau d’érable desséché ; Roschen voulut crier, mais la Dame Noire mit un doigt sur sa bouche, et Roschen, craignant d’irriter l’apparition, resta muette et immobile, les yeux fixés sur elle. La Dame Noire alors s’approcha du lit d’un pas lent et qui n’avait aucun écho.
Arrivée à l’enfant, elle joignit les mains, pria un instant tout bas, puis, après l’avoir embrassé au front :
– Roschen, dit-elle à la pauvre mère tout effrayée, prends cette branche sèche et qui vient de l’érable même dont est fait le berceau de ton fils, garde-la avec soin, et dès que ton enfant aura atteint sa seizième année, mets-la dans l’eau pure, puis, quand sur cette branche auront repoussé les feuilles et les fleurs, donne-la à ton fils, et qu’il aille avec elle toucher la porte de la tour du côté de l’Orient, ce sera pour son bonheur et pour ma délivrance.
Puis, à ces mots, laissant la branche sèche aux mains de Roschen, la Dame Noire disparut.
L’enfant grandit et devint un beau jeune homme ; en tout ce qu’il faisait, un bon génie semblait le garder ; de temps en temps Roschen jetait les yeux sur la branche d’érable qu’elle avait mise au-dessous du crucifix, avec les buis bénits des dimanches des Rameaux. Et comme la branche se desséchait de plus en plus, elle secouait la tête, en doutant qu’un rameau si desséché pût jamais porter ni feuilles ni fleurs.
Cependant, le jour même où son fils eut seize ans, elle n’en obéit pas moins aux injonctions de la Dame Noire, et prenant la branche au-dessous du crucifix, elle alla la planter au milieu d’une source d’eau vive qui coulait dans le jardin.
Le lendemain, elle alla visiter le rameau, et il lui sembla que la sève commençait à se glisser sous l’écorce ; le surlendemain, elle vit poindre les bourgeons, le jour d’après les bourgeons s’ouvrirent, puis les feuilles grandirent, les fleurs parurent, et au bout de huit jours que la branche était dans la source, on eût dit qu’on venait de la cueillir à l’érable voisin.
Alors Roschen prit son fils, le conduisit à la source, et lui raconta ce qui s’était passé le jour de sa naissance. Le jeune homme, aventureux comme un chevalier errant, prit aussitôt la branche, et s’inclinant devant sa mère, il lui demanda sa bénédiction, car il voulait tenter l’aventure à l’instant même. Roschen le bénit, et le jeune homme s’achemina aussitôt vers les ruines.
C’était au moment de la journée où le soleil en s’abaissant à l’horizon fait monter l’ombre des endroits profonds aux endroits élevés. Le jeune homme, tout brave qu’il était, n’était point exempt de cette inquiétude qu’éprouve l’homme le plus courageux au moment où il va au-devant d’un évènement surnaturel et inattendu ; en mettant le pied dans les ruines, son coeur battait si fort qu’il s’arrêta un instant pour respirer. Le soleil alors était caché tout à fait, et l’obscurité commençait à atteindre le pied des murailles, dont les derniers rayons du jour doraient encore le sommet.
Le jeune homme s’avança, son rameau d’érable à la main, vers la tour de l’Orient, et à l’orient de la tour il trouva une porte ; il y frappa trois coups, et au troisième coup la porte s’ouvrit, et la Dame Noire parut sur le seuil. Le jeune homme fit malgré lui un pas en arrière, mais l’apparition étendit la main vers lui, et d’une voix douce et avec un visage souriant :
– N’aie point peur, jeune homme, lui dit-elle, car ce jour est un jour heureux pour toi et pour moi.
– Mais qui êtes-vous, madame, et ne puis-je savoir quel est le service que je vous ai rendu ?
– Je suis la dame de ce château, reprit le fantôme, et comme tu le vois, notre sort est le même ; il n’est plus qu’une ruine et je ne suis plus qu’une ombre. Jeune, je fus fiancée au jeune comte de Windeck, qui demeurait à quelques lieues d’ici, dans le château dont les débris portent encore son nom. Après m’avoir dit qu’il m’aimait, après s’être assuré que je partageais son amour, il m’abandonna pour une autre femme dont il devint l’époux ; mais leur bonheur ne fut pas de longue durée. Le comte de Windeck était ambitieux ; il entra dans la ligue contre l’empereur, et il fut tué dans un combat où son parti fut vaincu ; alors les impériaux se répandirent dans les montagnes, pillant, brûlant les châteaux de leurs ennemis. Le château de Windeck fut pillé et brûlé comme les autres, et la jeune comtesse se sauva, son enfant dans les bras ; mais bientôt épuisée de fatigue, elle cueillit une branche d’érable pour soutenir sa marche. Elle avait vu de loin les tours du château que j’habitais, et comme elle ignorait ce qui s’était passé entre moi et son mari, elle venait me demander l’hospitalité ; mais si elle ne me connaissait pas, je la connaissais, moi ; je l’avais vue passer dans une chasse, enivrée d’amour, ardente au plaisir, suivie au loin de beaux jeunes gens, qui, échos de mon ingrat amant, lui disaient qu’elle était belle. À sa vue, au lieu de prendre pitié d’elle comme devait le faire une chrétienne, toute ma haine se réveilla. Je la vis avec joie écrasée sous le poids de son fardeau maternel, monter les pieds nus et déchirés à travers le sentier rocailleux qui conduisait à la porte de mon château. Mais bientôt elle s’arrêta sur le plateau qui domine cette pièce d’eau sombre que tu vois ; par un dernier effort, enfonçant son bâton en terre pour s’appuyer dessus, elle tendit vers moi ses deux bras chargés de son fils, et mourante, se laissa tomber sans force et serrant encore son pauvre enfant sur sa poitrine. Alors, oui, je le sais bien, j’aurais dû descendre de mon balcon, j’aurais dû aller à elle, la relever dans mes bras, la soutenir sur mon épaule, la conduire en ce château et en faire ma soeur. C’eût été beau et charitable devant Dieu ; oui, je le sais, mais j’étais jalouse du comte, même après sa mort. Je voulus me venger sur sa pauvre femme innocente de ce que j’avais souffert. J’appelai mes valets, et je leur ordonnai de la chasser comme une bohémienne. Hélas ! ils m’obéirent : je les vis s’approcher d’elle, l’insulter, lui dénier jusqu’à cette couche de terre où elle reposait un instant ses membres fatigués. Alors, elle se releva folle, insensée, et prenant son enfant dans ses bras, je la vis courir tout échevelée vers le rocher qui domine le lac, monter jusqu’à son sommet, puis jetant une malédiction terrible sur moi, se précipiter dans l’eau, elle et son enfant. Je poussai un cri. En ce moment je me repentis, mais il était trop tard. La malédiction de ma victime était montée jusqu’au trône de Dieu. Elle avait crié vengeance, et vengeance devait être faite.
» Le lendemain, un pêcheur en jetant ses filets dans le lac en tira la mère et l’enfant qui se tenaient encore embrassés. Comme selon le rapport de mes valets elle avait attenté elle-même à sa vie, le chapelain du château refusa de l’enterrer en terre sainte, et elle fut déposée à l’endroit même où elle avait enfoncé son bâton d’érable ; bientôt ce bâton, qui était vert encore, prit racine, et, au printemps suivant, il portait des fruits et des fleurs.
» Quant à moi, dévorée de repentir, sans tranquillité pendant mes jours, sans repos pendant mes nuits, je passais mon temps à prier, agenouillée dans la chapelle, ou à errer autour du château. Peu à peu je sentis ma santé s’affaiblir, et j’eus la conscience que j’étais atteinte d’une maladie mortelle. Bientôt une langueur insurmontable s’empara de moi et me força de garder le lit. On fit venir les meilleurs médecins de l’Allemagne, mais tous secouaient la tête en me regardant, et disaient : « Nous n’y pouvons rien, la main de Dieu est sur elle. » Ils avaient raison, j’étais condamnée. Et le jour anniversaire de la troisième année où était morte la comtesse, je mourus à mon tour. On me revêtit de ma robe noire, que je portais toujours, afin, comme je l’avais recommandé, de porter même après ma mort le deuil de mon crime ; et comme, toute coupable que j’étais, on m’avait vu mourir en sainte, on me déposa dans la chapelle funéraire de ma famille, et l’on scella sur moi la pierre de ma tombe.
» La nuit même du jour où je m’y étais couchée, il me sembla, au milieu de mon sommeil mortel, entendre sonner l’heure à l’horloge de la chapelle. Je comptai les coups du battant, et je l’entendis frapper douze fois.
» Au dernier coup, il me sembla qu’une voix me disait à l’oreille :
» – Femme, lève-toi.
» Je reconnus la voix de Dieu et je m’écriai :
» – Seigneur ! Seigneur ! ne suis-je donc pas morte, et quand je croyais être à jamais endormie dans votre miséricorde, allez-vous me rendre à la vie ?
» – Non, dit la même voix, ne crains rien, on ne vit qu’une fois ; oui, tu es bien morte, mais avant d’implorer ma miséricorde, il faut que tu satisfasses à ma justice.
» – Mon Dieu, Seigneur ! m’écriai-je tout en frissonnant, qu’allez-vous ordonner de moi ?
» – Tu erreras, pauvre âme en peine, répondit la voix, jusqu’à ce que l’érable qui ombrage la tombe de la comtesse soit assez gros pour fournir les planches du berceau de l’enfant qui doit te délivrer. Lève-toi donc de la tombe et accomplis ton jugement.
» Alors, du bout de mon doigt je levai la pierre de mon sépulcre, et je descendis pâle, froide, inanimée, et j’errai ainsi autour de mon château jusqu’à ce que se fit entendre le premier chant du coq ; aussitôt, de moi-même, et comme poussée par un bras irrésistible, je rentrai dans cette tour dont la porte s’ouvrit toute seule devant moi, et je me couchai dans mon tombeau, dont le couvercle se referma de lui-même. La seconde nuit ce fut la même chose, et toutes les nuits qui suivirent la seconde nuit, il en fut ainsi.
» Cela dura près de trois siècles. Je vis chaque année tomber une à une toutes les pierres du château, et pousser une à une toutes les branches de l’érable. Enfin, du bâtiment et des quatre tours, il ne resta que celle-ci ; enfin, l’arbre grandit et grossit au point que je vis l’heure de ma délivrance approcher.
» Un jour ton père vint une hache à la main. L’érable, qui jusque-là avait résisté à l’acier le plus tranchant, amolli par moi, céda au fer de sa cognée ; à ma prière, il fit du tronc un berceau où tu fus couché le jour de ta naissance.
» Le Seigneur m’a tenu parole, le Seigneur soit béni, car il est puissant et miséricordieux.
Le jeune homme se signa.
– Et maintenant, dit-il, ne me reste-t-il rien à faire ?
– Si fait, répondit la Dame Noire, si fait, jeune homme, il vous reste à achever votre oeuvre.
– Ordonnez, madame, dit le jeune homme, et j’obéirai.
– Creusez au pied de l’érable, et vous trouverez les ossements de la comtesse de Windeck et de son fils ; faites enterrer ces ossements en terre sainte, et quand ils seront enterrés, levez la pierre de mon tombeau, mettez-moi un rameau de buis béni de la dernière Pâque dans la main, et faites sceller hardiment le couvercle, car je ne le soulèverai plus qu’au jour du jugement dernier.
– Mais comment reconnaîtrai-je votre tombeau ?
– C’est le troisième à droite en entrant ; d’ailleurs, ajouta la Dame Noire en étendant vers le jeune homme une main qui eût été parfaite sans son extrême pâleur, regardez cette bague, vous la reconnaîtrez à mon doigt.
Le jeune homme regarda et vit une escarboucle si pure qu’elle éclairait non seulement la main de la dame, mais encore son beau et mélancolique visage, auquel, comme à la main, on ne pouvait reprocher qu’une trop grande blancheur.
– Il sera fait comme vous le désirez, dit le jeune homme en couvrant ses yeux avec sa main, ébloui qu’il était par les feux que jetait l’escarboucle, et cela dès demain matin.
– Ainsi soit-il ! répondit la Dame Noire.
Et elle disparut comme si elle s’était abîmée dans la terre.
Le jeune homme sentit bien qu’il venait de se passer quelque chose d’étrange, il retira sa main de dessus ses yeux et regarda autour de lui, mais il était seul au milieu des ruines, son rameau d’érable à la main, en face de la porte de la tour de l’Orient, et cette porte était fermée.
Le jeune homme revint chez lui, et raconta tout à son père et à sa mère, qui reconnurent la main de Dieu dans tout cela ; le lendemain, on prévint le curé d’Achern, qui se rendit à l’endroit indiqué par le jeune homme, chantant le Magnificat, tandis que deux fossoyeurs creusaient au pied de l’érable. À cinq ou six pieds de profondeur, comme l’avait dit la Dame Noire, on trouva les deux squelettes, les os des bras de la mère serraient encore l’enfant contre les os de sa poitrine.
Le même jour, la comtesse et son fils furent inhumés en terre sainte.
Puis, en sortant de l’église, le jeune homme prit au-dessous du crucifix un rameau béni à la dernière Pâque, et appelant deux de ses amis dont l’un était maçon et l’autre serrurier, il les emmena avec lui vers la tour de l’Orient. Quand ils virent où on les conduisait, les deux compagnons hésitèrent, mais le jeune homme leur dit avec une telle confiance qu’en lui obéissant ils obéissaient à Dieu lui-même, qu’ils n’hésitèrent plus et le suivirent.
En arrivant à la porte de la tour, le jeune homme s’aperçut qu’il avait oublié le rameau d’érable avec lequel il l’avait touchée la veille, mais il pensa que son rameau bénit aurait sans doute la même puissance ; il ne se trompait pas. À peine du bout de la branche sèche eut-il effleuré la porte massive qu’elle tourna sur ses gonds, comme si un géant l’eut poussée, et que l’escalier s’offrit à lui et à ses deux compagnons.
Alors ils allumèrent chacun une torche dont ils s’étaient munis à l’avance, et descendirent : à la vingtième marche, ils se trouvèrent dans le caveau.
Le jeune homme marcha droit au troisième tombeau, et appela ses deux compagnons pour qu’ils l’aidassent à en soulever le couvercle ; encore une fois ils hésitèrent, mais leur camarade leur assura que ce qu’ils allaient faire, au lieu d’être une profanation, était une piété, ils réunirent donc leurs efforts aux siens, et découvrirent la tombe.
Elle renfermait un squelette décharné dans lequel le jeune homme hésita d’abord à reconnaître cette belle femme qui lui avait parlé la veille, et à laquelle, comme nous l’avons dit, on ne pouvait reprocher qu’une trop grande pâleur. Mais à l’os de son doigt, il vit briller cette escarboucle si magnifique qu’il n’y en avait pas deux pareilles au monde ; il lui mit donc à la main le rameau bénit et, refermant la pierre de la tombe, il invita ses deux amis à la sceller le plus solidement qu’il leur était possible. Les deux compagnons obéirent.
C’est dans cette tombe, que l’on montre encore aux voyageurs assez courageux pour se hasarder sous les voûtes croulantes de la chapelle souterraine, que repose la dame Noire, dans l’attente du dernier jugement.
Alexandre DUMAS, Excursions sur les bords du Rhin, 1841.
Recueilli par Francis Lacassin dans
Contes et légendes des grands chemins,
Édition établie et préparée par
Francis Lacassin, Bartillat, 2000.
Illustration : Victor Hugo, Le Gai Château, 1897
LA MESSE DES ANGES
D' Émile BLÉMONT (1839-1927)
I
La Messe des Anges se dit, comme on le sait, devant le cercueil des petits enfants.
Qui de nous n’y a assisté une fois au moins ? Quand on est jeune, on y vient d’un coeur distrait ; on pense à bien autre chose, en vérité. On s’étonne de ces cérémonies, de ces douleurs, de ces pleurs, de ces sanglots. Tout cela pour un petit être, né d’hier, qui savait à peine parler, et dont le chétif cadavre tient dans une bière à peine plus large qu’une boîte à violon !
Quand on a soi-même un enfant, l’impression est toute différente.
Voici. On rentre chez soi, on trouve une lettre bordée de noir, on lit ces mots si étrangement douloureux : « Vous êtes prié d’assister aux Convoi, Service et Enterrement de mademoiselle Blanche-Marie, décédée dans sa troisième année, chez ses parents. Laudate, pueri, Dominum ! » Et ces simples lignes vous émeuvent jusqu’au fond du coeur. Subitement assombri, vous embrassez la chère et tendre fillette qui vous reste, à vous, qui vous sourit, un peu gênée par votre tristesse, et que la mort peut aussi, tout d’un coup, sans motif, irréparablement, arracher de vos bras.
Puis, vous allez à la Messe des Anges.
II
Au milieu du choeur apparaît le cercueil, tout petit sur de larges supports, et drapé de blanc. La flamme pâle des grands cierges tremble aux quatre coins.
À l’autel, le prêtre va et vient, se tourne et se retourne, joint les mains et s’agenouille, psalmodie un latin nasal et se recueille en des silences mesurés.
Sous les cierges, sept ou huit enfants de choeur, la calotte rouge sur le sommet de la tête, les cheveux plaqués au front, chantent, en faisant chacun leur mouvement machinal, autour d’un grand jeune homme barbu qui marque les temps en levant et en abaissant la main, et qui gourmande ses élèves à voix basse. Des diacres et des sous-diacres, enchâssés dans de grands sacs dorés d’étoffe droite et métallique, suivent de l’oeil et copient les mouvements du prêtre.
Un ténor à figure ronde et rasée enfle sa bouche d’harmonie ; les deux autres musiciens, près de lui, regardent avec la plus parfaite indifférence, tantôt les notes noires et blanches perchées çà et là dans les cinq fils des cahiers à musique, tantôt les statues de marbre jauni ou les fresques un peu passées, que semble animer un rayon de soleil irisé par les vitraux.
Dans les stalles de bois luisant, qui encadrent le choeur de leurs deux rangées symétriques, s’échelonnent les proches parents de ce petit cercueil. Là, point de dames ; deux doubles rangs d’habits noirs. Les dames sont dans la nef, un côté leur en est réservé ; elles sont en grand deuil, courbent la tête, et quelques-unes pleurent. De l’autre côté sont les amis.
Par moment, du fond de l’église, une ombre triste et lente vient se joindre à l’assistance. Les nouveaux venus serrent silencieusement la main des premiers arrivés.
On se murmure un mot à l’oreille :
« De quoi est-elle donc morte ?
– Oh ! ne m’en parle pas. Les médecins n’ont rien pu faire ; la maladie a été subite, cruelle. Un coup de vent qui souffle une flamme. Il y a huit jours, j’ai vu la chère petite en parfaite santé. Et comme elle était mignonne dans sa robe blanche brodée, avec ses fins cheveux blonds noués d’un ruban bleu ! Sa gaîté rieuse et chantante était pleine d’aurore. Elle disait les mots avec un accent si simple et une si fraîche intensité d’expression, qu’il semblait qu’on les entendît pour la première fois. Les phrases les plus banales, les plus fanées, avaient l’air de refleurir sur ses lèvres ; et quand on jasait avec elle, on se sentait au printemps.
– C’était un charme. Quel bon naturel ! La dernière fois que je l’ai embrassée, elle m’a dit : Monsieur, vous avez un petit garçon. Amenez-le, je l’aimerai bien et nous jouerons ensemble ! Je serai sa maman !
– Regardez le père ! Il a l’air brisé ! »
III
Le père ! il est là, voyez-vous, dans la première stalle du choeur, pâle, les yeux rouges, la figure gonflée. Oui, il a réellement l’air accablé, brisé. Le chapeau à la main, correctement vêtu de noir, se levant et s’asseyant comme les autres au bruit que fait en tombant sur les dalles la hallebarde du suisse, sa douleur est d’autant plus poignante qu’elle est plus correcte et plus éteinte.
Le regard vague, il est tout absorbé par des visions intérieures ; il suit un souvenir, un rêve ; brusquement éveillé, il tressaille, il se demande si la funèbre réalité qui le ressaisit n’est pas un songe également, s’il est bien là pour son propre compte aujourd’hui, si c’est le deuil de son enfant qu’il mène, et s’il n’est pas venu, comme cela lui est déjà plusieurs fois arrivé, en ami, en étranger, pour un père autre que lui-même, pour un autre enfant que sa petite Marie.
Pendant une semaine, ô la terrible, la longue et lugubre semaine ! Il a suivi les progrès incessants de l’implacable maladie. Il a vu, jour par jour, l’âme frêle s’enfuir, insaisissable, du pauvre petit corps martyrisé. Il a vu les médecins pencher leurs cheveux blancs sur le berceau, et se retourner silencieusement vers lui en hochant la tête. Il a guetté, des nuits entières, un signe d’espoir et de renouveau, un regard plus clair, un sourire moins souffrant. Rien ! L’enfant ne se plaignait seulement pas ; elle avait l’expression mystérieusement résignée des innocents qui se sentent emportés du monde et de la vie. En la retrouvant toujours plus faible, toujours plus émaciée, il regardait alors autour de lui, il écoutait, il cherchait qui pouvait maltraiter ainsi sa fille, et ne voyant personne, n’entendant personne, dans le morne apaisement que l’on fait autour des malades, il se sentait frappé de stupeur, il restait là, sur une chaise, au chevet de l’enfant, sans parole, sans mouvement, la tête lourde, les yeux fixes.
Puis, un matin, tandis que le jour blafard, se glissant à travers volets et rideaux, isolait et atténuait la lueur jaune des lampes, – sans un bruit, sans un mouvement, sans un signe, sans un adieu, elle avait expiré.
De tant d’amour et de bonheur, de tant d’espérance, il n’était resté qu’un petit corps froid, inerte, un visage fermé, où le suprême sourire s’était figé, s’était glacé en des pâleurs d’ivoire. Une fleur flétrie, un parfum envolé ! Et plus de traces de cette frêle existence, sauf dans la douleur, dans le désespoir, hélas ! d’un père et d’une mère.
IV
Toutes ces choses reviennent maintenant, pendant cette Messe des Anges, à l’esprit de cet homme en noir, que vous voyez, le chapeau à la main, debout, dans la première stalle du choeur. Elles reviennent en leurs moindres détails, avec une netteté déchirante, cuisante. Il entend le son d’une voix faible, les sanglots convulsifs des crises, le bruit des pas du médecin qui se rapprochent, le son argentin et mouillé d’une cuiller dans un verre de tisane. Et pourtant, c’est à peine s’il peut admettre que tout cela se soit passé ainsi, que sa fille ait été malade et qu’elle soit morte. Hier, les gens des pompes funèbres sont venus ; hier, on a pris mesure du mince cadavre de Marie ; hier, on l’a habillée et parée pour la tombe ; hier, on l’a déposée dans le cercueil. Mais il doute encore.
Il a dû les commander, les lettres noires ! Il a dû en donner la rédaction, chercher et compléter la liste de ses parents, de ses amis, des personnes connues par lui ; il ne voulait pas faire d’impolitesses. Il a dû conférer avec un homme d’affaires pour le cimetière, avec un prêtre pour le service mortuaire. Mais il doute toujours.
En vain le cercueil est là, devant lui, drapé de blanc, au milieu du choeur ; en vain les cierges brûlent, tandis que la musique sourde et pleurante l’enveloppe, le pénètre ; vainement l’assistance en deuil, convoquée par lui, le regarde avec une sympathique tristesse, et vainement il se sent lui-même brisé de douleur : il se refuse toujours, toujours, à concevoir que sa fille soit morte, morte pour ne plus revenir.
C’est qu’aussi les bons moments, qui ont précédé cette semaine sinistre, cette semaine fatale, le reprennent tout d’un coup avec tant de caresse ! Son mariage, les premières entrevues, la robe blanche de la mariée au jour des noces, les chants et les fleurs de l’église, alors parée et rayonnante, le repas du soir autour de la grande table longue, le rubis des vins vieux qui tremble dans le fin cristal aux doigts mal assurés des vieux parents, et la première valse, et les premiers abandons, tout cela revit, réel, distinct, clair, sur le fond sombre de son désespoir. Puis c’est la jeune femme qui se sent devenir mère ; ce sont les soins, les attentions dont chacun l’entoure, l’anxiété et les cris aigus de l’enfantement, le regard apaisé, triomphal, de la faible accouchée sur la chère petite créature qui vient de sortir d’elle, qui, aveugle encore et presque sans organes, déjà pourtant souffre et vagit, et que l’on consolera, et que l’on aura tant de bonheur à consoler, à rendre heureuse et digne d’amour !
Ensuite passent trois années de contentement, de félicité. Elle voit, elle parle, la chère enfant ! Elle apprend à jaser, à sourire, à aimer. Ô les belles toilettes mignonnes, depuis la longue pelisse blanche des premiers jours jusqu’à la fine jupe écossaise, très élégante, qu’elle portait le mois dernier ! Ô les beaux petits souliers bleus, les beaux petits bonnets à ruches ! Et les premiers joujoux, le mouton qui bêle, le lapin qui joue du tambour, le chemin de fer minuscule où monte et descend la file des wagons de métal léger, aux étroites fenêtres et aux caisses peintes en vert ! Et l’avènement de la poupée, et les joyeux ébats sur le tapis bariolé de la chambre à coucher, et les dînettes sur la chaise haute, à table, entre père et mère ! Et les baisers à la ronde, et les recommandations d’être bien sage et de s’endormir bien tranquillement, à neuf heures, avec la poupée rose !
Tout ce bonheur-là n’a-t-il été qu’un rêve, une illusion fugitive ?
Le rêve, n’est-ce pas plutôt cet affreux cauchemar de huit jours et cette funèbre cérémonie qui se poursuit, qui s’achève ?
V
Elle s’achève, hélas ! et le doute n’est pas possible. La réalité, c’est la mort, c’est le désespoir. On conduit le père au catafalque, on lui donne le goupillon, et ses jambes fléchissent quand il jette l’eau bénite sur le coffre étroit où gît inanimé ce qu’il aimait le plus au monde. Le défilé commence ; chacun vient serrer la main à l’infortuné qui voudrait être seul. C’est interminable ; et les larmes lui montent aux yeux, quand il voit les femmes, l’une après l’autre, le regarder en pleurant.
On emporte la bière. La voilà hissée sur la voiture, il n’a pas fallu grand effort ; et voilà cet homme, il y a huit jours le plus heureux des hommes, qui chemine, tête nue sous le ciel gris, le long des rues boueuses, derrière le lent corbillard, dans la pleine conscience de son irrémédiable malheur.
La mère est restée à la maison, affaissée, immobile. Elle pleure, elle prie. On lui parle, mais elle n’écoute pas. Elle a les mains jointes et regarde fixement devant elle. On a peur qu’elle ne meure de cette mort, qu’elle ne suive l’enfant parti. Toutefois, elle se consolera peut-être plus vite et mieux que le père. Elle a la religion. Elle croit à une éternité où l’on retrouve tout ce qu’on a perdu.
Mais lui, lui n’est pas un être de sentiment ; il est un être de raison, il sait. Il a compris dès longtemps que toutes nos visions d’immortalité ne sont que de frêles hypothèses, sinon de pures chimères. Il ne croit plus aux mirages. Allez donc lui dire que madame la Vierge attend là-haut, dans une étoile, les petites filles mortes, et les fait jouer avec l’enfant Jésus en blouse d’or ! Il sourira tristement. Pour lui, cela n’est pas, cela ne peut pas être.
Sa tête se perd. Le cerveau vide, les yeux vagues, il monte le long chemin pavé qui mène au cimetière. Il se rappelle soudain, dans des lueurs intenses de mémoire, des coïncidences, des réflexions faites jadis ; il se rappelle le pressentiment qui lui serra le coeur, un jour, en voyant un pauvre homme, humblement vêtu, suivre tout seul, à pied, un tout petit, tout petit cercueil, que portaient, en se dandinant sous le poids, deux croque-morts à uniforme noir usé et à chapeau luisant, dont le premier mangeait, chemin faisant, une pomme rouge ; – un tout petit, tout petit cercueil blanc, sur lequel il y avait deux bouquets de violettes d’un sou. Il s’était demandé, alors, ce qu’éprouvait le pauvre homme qui marchait derrière ; et le pauvre homme, aujourd’hui, c’est lui-même. Hélas ! le cortège piétine, bourdonne à sa suite, et les passants se découvrent et s’arrêtent pour voir, comme lui jadis, ce deuil et cette douleur.
Et pourtant il n’arrivera que trop tôt au cimetière. Pauvre père ! qui donc vous consolera maintenant des amers soucis de la vie ingrate qu’on mène en notre âpre siècle, des luttes acharnées, des fausses amitiés, des calomnies, des vols, des ingratitudes et des banalités écoeurantes ? À quoi bon travailler, à quoi bon gagner de l’argent ou de la gloire, maintenant ? N’êtes-vous pas ruiné, ruiné dans l’âme ?
Il cherche pour quelle fin le destin veut que ces petits enfants, qui nous sont si chers et qui sont si innocents, souffrent et meurent. Et puis, malgré tout, lentement, irrésistiblement, il se prend à penser que pas une parcelle d’amour ne doit se perdre ici-bas, – qu’il vaut mieux avoir aimé et avoir vu fuir ce qu’on aimait, que n’avoir pas aimé du tout, – et que la loi universelle, quelles que soient les apparences contraires, doit être justice, bonté, bonheur.
Autrement, pourquoi l’univers, pourquoi l’existence ?
Paru dans La Renaissance artistique
et littéraire, 22 mars 1873.
BERTHE ET RODOLPHE
par Alphonse KARR (1808-1890)
Un soir, le jeune musicien Rodolphe Arnheim et Berthe, la plus jolie des filles de Mayence, se trouvaient seuls. Rodolphe et Berthe étaient promis, et cependant ils allaient être séparés le lendemain. Rodolphe partait pour une province éloignée. Pendant deux ans, il devait y prendre des leçons d’un maître habile ; puis à son retour le père de Berthe lui résignerait ses fonctions de maître de chapelle et lui donnerait sa fille.
« Berthe, dit Rodolphe, jouons encore une fois ensemble cet air que tu aimes tant. Quand nous serons séparés, à la fin du jour, heure des pensées graves, nous jouerons chacun notre partie et cela nous rapprochera. »
Berthe prit sa harpe, Rodolphe l’accompagna avec sa flûte, et ils jouèrent plusieurs fois l’air favori de Berthe. À la fin, ils se prirent à pleurer et s’embrassèrent : Rodolphe partit.
Tous deux furent fidèles à leur promesse. Chaque soir, à l’heure où ils s’étaient vus pour la dernière fois, Berthe se mettait à sa harpe, Rodolphe prenait sa flûte, et ils jouaient chacun leur partie. Cette heure du soir est solennelle et mystérieuse, elle dispose invinciblement à la rêverie ; dans les vapeurs qui montent rougeâtres à l’horizon, il semble que l’on voit apparaître vivants et animés tous ses souvenirs, toutes ses journées, les unes riantes et couronnées de roses, les autres pâles et voilées d’un crêpe.
À cette heure, le dernier frémissement du vent dans les feuilles semble moduler les airs auxquels nous rattachons de doux ou de tristes souvenirs : la musique est la voix de l’âme.
Rodolphe par moments s’arrêtait ; il lui semblait entendre se mêler aux sons de sa flûte les vibrations de la harpe de Berthe. Deux ans se passèrent ainsi.
Un soir, Berthe se trouvait avec son père sous la tonnelle de leur petit jardin. Cette tonnelle était fermée par cinq acacias, qui mêlaient dans le haut leur feuillage et leurs grappes blanches et parfumées ; entre les acacias, des lilas d’un vert sombre fermaient les espaces vides de leur feuillée épaisse ; trois ou quatre chèvrefeuilles grimpaient autour des acacias, et laissaient pendre de longues guirlandes fleuries.
À travers l’entrée étroite laissée à la tonnelle, on voyait à l’horizon une bande de pourpre produite par les reflets du soleil couchant. C’était l’heure consacrée aux souvenirs : Berthe joua sur la harpe son air favori, mais tout à coup elle s’arrêta pour écouter.
Tout était silence ; le vent même à cette heure cesse d’agiter le feuillage. Berthe recommença l’air et elle entendit encore la flûte de Rodolphe l’accompagner.
C’était Rodolphe qui revenait.
Deux ans après, Rodolphe et Berthe possédaient une charmante petite fille, fruit chéri d’une union que le père de Berthe avait bénie avant de mourir. Rodolphe était maître de chapelle et le revenu de sa place donnait aux jeunes gens une aisance suffisante.
Rodolphe venait d’acheter une jolie petite maison. Derrière se trouvait un épais couvert de tilleuls ; devant, une verte pelouse sur laquelle se roulait l’enfant. Les murailles blanches étaient tapissées par de grands rosiers du Bengale ; et puis tout cela fermait si bien, il n’y avait pas la moindre fente aux portes par laquelle pût pénétrer un regard de dehors : les gens heureux sont d’un accès difficile.
Alors mourut l’enfant, et Berthe mourut de chagrin quelques mois après.
Quand elle sentit sa fin approcher, elle dit à Rodolphe :
« En vain, je veux me rattacher à la vie par mes prières ; il faut que j’aille rejoindre notre enfant, que je t’abandonne et que j’aille t’attendre dans une vie meilleure. Si la puissance reste aux morts de reparaître sur la terre, tu me reverras ; mon ombre errera autour de toi, car mon ciel, c’est le lieu où est Rodolphe. Quand le jour sera venu où nous pourrons nous réunir, je viendrai te chercher, et nos deux âmes confondues s’élèveront pour ne plus redescendre sur une terre où elles n’auront plus aucun lien. Chaque année, au jour de ma naissance, heureux ou malheureux, aimé ou abandonné, triste ou gai, à l’heure où le soleil se couche, à l’heure où les prières montent au ciel avec les sons de la cloche du soir et le parfum qu’exhalent les fleurs avant de fermer leur calice, tu joueras cet air qui a si longtemps pour nous charmé les douleurs de l’absence, seule consolation qui te restera dans une bien longue absence. Cette musique sera plus harmonieuse à mon âme que les concerts des séraphins. »
Puis elle l’embrassa et mourut.
Rodolphe devint fou. On le fit voyager quelque temps. À son retour, sa tête était plus calme, mais une sombre mélancolie s’empara de lui et ne le quitta plus. Il se renferma dans sa maison sans y vouloir recevoir personne, sans vouloir sortir et aller nulle part. Il laissa la chambre de Berthe telle qu’elle se trouvait au moment de sa mort, le lit encore défait, la harpe dans un coin.
Quand arriva le jour de la naissance de Berthe, il se para, ce qui ne lui était pas encore arrivé. Il remplit la chambre de fleurs ; et lorsque vint le soir, il s’enferma et joua sur la flûte l’air qu’ils avaient si souvent joué ensemble.
Le lendemain, on le trouva raide étendu sur le plancher. Quand il reprit ses sens, il était devenu fou ; il fallut encore le faire voyager. Au bout d’une année, il revint dans sa maison ; son cerveau paraissait rétabli, seulement il était triste et silencieux.
Arriva encore le jour de la naissance de Berthe, il remplit la chambre de fleurs fraîches, et, vers le soir, il s’enferma, paré comme au jour de ses noces ; puis il joua sur sa flûte toujours le même air.
Le lendemain, on le trouva encore étendu par terre.
Mais quand on voulut l’emmener, il dit froidement que si on ne le laissait pas dans la maison où était morte sa femme, il se tuerait. On crut devoir lui céder, d’autant que sa raison ne paraissait pas ébranlée de ce nouvel accident.
Voici ce qui lui était arrivé.
Au premier anniversaire, dès qu’il avait joué, les cordes de la harpe avaient vibré, et d’elles-mêmes accompagné la flûte.
Quand il s’arrêtait, les sons de la harpe s’arrêtaient de leur côté.
Au second anniversaire, pensant qu’il avait été victime d’une illusion, il recommença, et la harpe joua sa partie ; il cessa, et les sons de la harpe cessèrent ; il porta la main sur les cordes, et sa main sentit les dernières vibrations de ces cordes.
Aux deux fois, il était tombé frappé de terreur, et avait passé la nuit dans un profond évanouissement.
Mais il finissait par s’habituer à cette violente émotion, et par n’y trouver qu’une sorte de plaisir poignant.
Toutes ses soirées et la plus grande partie de ses nuits se passaient ainsi. Ses joues se creusaient ; ses yeux seuls paraissaient vivants au fond de leur orbite, et brillaient d’un éclat surnaturel : il n’avait plus de vie que précisément de quoi sentir et souffrir.
Un ami que le hasard ou une fatuité de constance lui avait conservé dans son malheur s’alarma et voulut savoir ce que Rodolphe faisait dans cette chambre. Il dit qu’il jouait de la flûte et que l’ombre de Berthe jouait de la harpe ; que la mort était bien réellement le commencement d’une autre vie ; qu’à mesure qu’il se sentait mourir, il se sentait vivre plus intimement avec sa femme qu’il avait tant aimée ; que pendant cette mystérieuse harmonie qu’il entendait tous les soirs, il lui semblait voir Berthe à sa harpe ; qu’il se trouvait heureux, qu’il ne désirait rien de plus, et ne demandait rien de plus au ciel ni aux hommes.
C’était le troisième anniversaire de la naissance de Berthe. Rodolphe remplit encore la chambre de fleurs ; lui-même était paré d’un bouquet. Il avait jonché le lit de la morte de roses effeuillées.
Puis, au soleil couchant, il prit sa flûte et joua l’air de Berthe.
L’ami s’était caché derrière une draperie ; il frissonna en entendant les sons de la harpe se mêler à ceux de la flûte. Rodolphe se mit à genoux et pria.
La harpe alors continua seule ; on voyait les cordes vibrer, sans qu’aucune main les touchât. Elle joua une musique céleste que personne n’avait jamais entendue, et que personne n’entendra jamais. Puis elle reprit l’air de Berthe ; et quand il fut fini, tout à coup toutes les cordes de la harpe se brisèrent, et Rodolphe tomba sur le parquet.
L’ami resta quelque temps aussi immobile que son ami ; puis quand il alla pour le relever, Rodolphe était mort.
Paru dans Contes et nouvelles, 1852.
Recueilli dans Les maîtres de l’étrange et de la peur,
de l’abbé Prévost à Guillaume Apollinaire,
Édition établie par Francis Lacassin,
Éditions Robert Laffont, 2000.
L'HISTOIRE DU FORGERON
par Anatole LE BRAZ (1859-1926)
Fanch ar Floc’h était forgeron à Ploumilliau. Comme c’était un artisan modèle, il avait toujours plus de travail qu’il n’en pouvait exécuter. C’est ainsi qu’une certaine veille de Noël, il dit à sa femme après le souper :
– Il faudra que tu ailles seule à la messe de minuit avec les enfants : moi, je ne serai jamais prêt à t’accompagner : j’ai encore une paire de roues à ferrer que j’ai promis de livrer demain matin, sans faute et, lorsque j’aurai fini, c’est, ma foi, de mon lit que j’aurai surtout besoin.
À quoi sa femme répondit :
– Tâche au moins que la cloche de l’Élévation ne te trouve pas encore travaillant.
– Oh ! fit-il, à ce moment-là, j’aurai déjà la tête sur l’oreiller.
Et, sur ce, il retourna à son enclume, tandis que sa femme apprêtait les enfants et s’apprêtait elle-même pour se rendre au bourg, éloigné de près d’une lieue, afin d’y entendre la messe. Le temps était clair et avec un peu de givre. Quand la troupe s’ébranla, Fanch lui souhaita bien du plaisir.
– Nous prierons pour toi, dit la femme, mais souviens-toi, de ton côté, de ne pas dépasser l’heure sainte.
– Non, non. Tu peux être tranquille.
Il se mit à battre le fer avec ardeur, tout en sifflotant une chanson, comme c’était son habitude quand il voulait se donner du coeur à l’ouvrage. Le temps s’use vite lorsqu’on besogne ferme. Fanch ar Floc’h ne le sentit pas s’écouler. Puis, il faut croire que le bruit de son marteau sur l’enclume l’empêcha d’entendre la sonnerie lointaine des carillons de Noël, quoiqu’il eût ouvert tout exprès une des lucarnes de la forge. En tout cas, l’heure de l’Élévation était passée qu’il travaillait encore. Tout à coup, la porte grinça sur ses gonds.
Étonné, Fanch ar Floc’h demeura, le marteau suspendu, et regarda qui entrait.
– Salut ! dit une voix stridente.
– Salut ! répondit Fanch.
Et il dévisagea le visiteur, mais sans réussir à distinguer ses traits que les larges bords rabattus d’un chapeau de feutre rejetaient dans l’ombre.
C’était un homme de haute taille, le dos un peu voûté, habillé à la mode ancienne, avec une veste à longues basques et des braies nouées au-dessus du genou. Il reprit, après un court silence :
– J’ai vu de la lumière chez vous et je suis entré, car j’ai le plus pressant besoin de vos services.
– Sapristi ! dit Fanch, vous tombez mal, car j’ai encore à finir de ferrer cette roue et je ne veux pas, en bon chrétien, que la cloche de l’Élévation me surprenne au travail.
– Oh ! fit l’homme, avec un ricanement étrange, il y a plus d’un quart d’heure que la cloche de l’Élévation a tinté.
– Ce n’est pas Dieu possible ! s’écria le forgeron en laissant tomber son marteau.
– Si fait ! repartit l’inconnu. Ainsi, que vous travailliez un peu plus, un peu moins !... D’autant que ce n’est pas ce que j’ai à vous demander qui vous retardera beaucoup ; il ne s’agit que d’un clou à river.
En parlant de la sorte, il exhiba une large faux dont il avait jusqu’alors caché le fer derrière ses épaules, ne laissant apercevoir que le manche, que Fanch ar Floc’h avait au premier aspect pris pour un bâton.
– Voyez, continua-t-il, elle branle un peu : vous aurez vite fait de la consolider.
– Mon Dieu, oui ! Si ce n’est que cela, répondit Fanch, je veux bien.
L’homme s’exprimait, d’ailleurs, d’une voix impérieuse qui ne souffrait point de refus. Il posa lui-même le fer de la faux sur l’enclume.
– Eh ! mais il est emmanché à rebours, votre outil ! observa le forgeron. Le tranchant est en dehors ! Quel est le maladroit qui a fait ce bel ouvrage ?
– Ne vous inquiétez pas de cela, dit sévèrement l’homme. Il y a faux et faux. Laissez celle-ci comme elle est et contentez-vous de la bien fixer.
– À votre gré, marmonna Fanch ar Floc’h à qui le ton du personnage ne plaisait qu’à demi.
Et, en un tour de main, il eut rivé un autre clou à la place de celui qui manquait.
– Maintenant, je vais vous payer, dit l’homme.
– Oh ! ça ne vaut pas qu’on en parle.
– Si ! tout travail mérite salaire. Je ne vous donnerai pas d’argent, Fanch ar Floc’h, mais, ce qui a plus de prix que l’argent et que l’or : un bon avertissement. Allez vous coucher, pensez à votre fin et, lorsque votre femme rentrera, commandez-lui de retourner au bourg vous chercher un prêtre. Le travail que vous venez de faire pour moi est le dernier que vous ferez de votre vie. Kénavo ! (Au revoir.)
L’homme à la faux disparut. Déjà Fanch ar Floc’h sentait ses jambes se dérober sous lui : il n’eut que la force de gagner son lit où sa femme le trouva suant les angoisses de la mort.
– Retourne, lui dit-il, me chercher un prêtre.
Au chant de coq, il rendit l’âme, pour avoir forgé la faux de l’Ankou.
Anatole LE BRAZ, La légende de la mort
chez les Bretons armoricains, 1893.
LA TUEUSE D'ECHO
par Catulle Mendés (1841-1909)
C’était dans le sous-sol d’une de ces sales brasseries où la police tolère que l’on boive encore après que tous les cafés et tous les débits de vin sont fermés. A des tables de bois, sous la poussière jaune du gaz, s’accoudaient les lassitudes saoules des rôdeuses nocturnes qui avaient fini leur besogne et de quelques hommes qui les avaient attendues tout le soir ; elles, fardées, eux, très blêmes et rasés de près comme des cabotins.
Comme nous allions sortir, écœurés de notre curiosité satisfaite :
- Regarde, me dit mon compagnon.
Il me désignait, seule, assise au fond de la salle, une femme très grande, très grasse, dont les cheveux roux en touffes bouffaient hors d’une toque à plume. Plus lasse que vieille, et la gorge tombant dans la soie lâche du corsage, elle avait dû être belle, elle l’était encore par la blancheur laiteuse de sa peau, par ses larges yeux noirs, profonds, fixes, où l’hébétude s’animait quelquefois d’un reste de pensée. Une fille, certainement, comme ses voisines ; on voyait de la crotte de trottoir au bas de son jupon, à la semelle de ses bottines ; mais, énorme, et pesamment assise avec l’air d’une colossale idole, elle semblait, cette créature, le type exagéré, la personnification presque grandiose de toute une espèce.
Etonnés, nous approchâmes.
D’une voix enrouée, très forte, qui domina tout le chuchotement des conversations à voix basse, elle nous demanda de lui payer à boire. Elle se fit servir quatre verres de genièvre qu’elle versa dans une chope où restait de la bière, et vida la chope d’un seul trait. Puis elle se mit à chanter le refrain d’une chanson de café-concert. Ce fut un râle rauque, gras, avec des traînements faubouriens, un geignement étranglé d’ivrogne. « A la bonne heure ! » Dit-elle en éclatant de rire. Puis familière, elle nous parla.
« Il n’y en a pas une pour boire autant que moi. Une bouteille d’eau-de-vie, après douze bocks, ne me fait pas peur, et je ne me grise jamais. Je connais des femmes qu’on ramasse tous les soirs, ivres, au coin des rues ; moi, je marche plus droit quand je sors de chez le marchand de poivre ; la boisson, ça me leste. Mais il ne faut pas croire que je boive pour mon plaisir. Ah ! Bien, oui. Je n’aime pas la bière, ni l’absinthe, ni le rogomme ; il y a des moments où je donnerais je ne sais quoi pour avaler un verre d’eau pure, bien claire, qui me caresserait la gorge et me mettrait de la fraîcheur dans l’estomac. Et, si je bois, ce n’est pas non plus pour être amusante ! Je fais mon métier tout juste. Je donne ce qu’on m’achète, pas autre chose. Est-ce que je suis obligée d’être de bonne humeur, d’avoir des mots drôles, de faire rire les gens par-dessus le marché ? Il ne manquerait plus que ça. Ils croient peut-être qu’ils m’amusent, eux ? Non, si j’ai pris l’habitude de m’en fourrer jusque-là, de l’alcool à trois sous le verre, c’est pour une autre raison, et ça ne regarde personne. »
Elle parlait bas, maintenant, comme pleine d’une pensée triste, et, détournée à demi, elle prit sa tête entre ses larges mains grasses, la fit pencher à droite, la fit pencher à gauche, berçant son front comme on berce un enfant malade.
Puis, bien que nous ne l’eussions pas interrogée, elle continua sans nous regarder.
« Oui, pour une autre raison. Si vous voulez la savoir, je veux bien vous la dire. Il faut que je vous explique une chose : ce n’est pas gai tous les jours, ni toutes les nuits, la vie que je mène. Patauger dans la boue de neuf heures du soir à deux heures du matin, parler aux gens qui rentrent chez eux, être rudoyée de coups de coude quand les passants sont de mauvaise humeur, retirer son corset dans une chambre d’hôtel garni où il n’y a pas toujours de feu, redescendre l’escalier, recommencer la promenade sous la pluie, ce sont des amusements dont je me passerais bien. Dans les commencements, surtout, c’était dur. Au moment d’aller sur le boulevard, j’avais des envies de sortir par la fenêtre. Mais quoi ? Que voulez-vous ? Il fallait manger, n’est-ce pas ? Et je vous demande un peu si j’aurais trouvé du travail ailleurs que dans l’atelier des quatre vents ? Quand on est tombé où je suis, plus moyen de s’en tirer ; c’est une glu qui tient ferme, la crotte du ruisseau. Enfin, peu à peu, je me suis habituée. Tous les métiers ont quelque chose de désagréable. A présent, je me suis faite au mien. Si on me mettait dans mes meubles, si je n’étais plus obligée de descendre dans la rue, je ne saurais peut-être pas à quoi passer le temps ; ça me manquerait de ne pas être mouillée par la pluie, salie par la boue, battue par le vent, bousculée par les hommes. Bref, je vous dis que j’ai pris mon parti, et puisque c’est comme ça, tant pis, voilà, c’est comme ça. Ah ! Seulement, il y a une chose à laquelle je n’ai jamais pu m’habituer. Pour que les gens fassent attention à vous le soir, il faut leur parler, n’est-ce pas ? Eh ! Bien, chaque fois que je parle à quelqu’un en le tirant par le bras, - les mots que nous disons, vous les savez bien, - je ne puis m’empêcher, c’est plus fort que moi, d’avoir le cœur serré, affreusement, comme si j’allais mourir, et j’ai toutes les peines du monde à ne pas pleurer toutes les larmes de mon corps. Ce n’est pas à cause des paroles que je dis, oh ! Non, ni à cause de la honte de faire ce que je fais, - je ne suis pas si bête, bien sûr ! - mais c’est à cause de ma voix, que j’entends. Quand je me suis bien reposée, quand j’ai dormi toute la journée, ma voix n’est pas rauque et grasse ; je l’entends très douce au contraire, très pure comme elle était autrefois, du temps que j’étais gamine, chez nous, à la campagne. Elle me tue, cette voix-là ! Je la reconnais, elle me rappelle les choses qu’elle disait. Je me souviens de la maison du père et de la mère, et des petites sœurs, qui ne sont pas venues à Paris, elles, qui se sont mariées au pays ; elle me fait penser aussi aux rendez-vous que j’avais derrière la haie avec le fils du forgeron, un beau gars qui m’embrassait à plein bras, me baisait bruyamment la bouche, - vous savez, nous, on ne nous baise pas sur les lèvres, - et qui m’aimait, pour sûr, et que j’aimais aussi. Ça me rend folle de demander : « Vous ne montez pas chez moi, beau blond ? » Avec la voix qui disait à ma mère : « Bonjour, maman », avec la voix qui disait à mon amoureux que je ne le quitterais jamais. J’essaye de parler bas, pour ne pas m’entendre, ou de rire aux éclats, tout en parlant. Ça ne sert à rien. Je la reconnais toujours, la voix d’autrefois, et je me cache la tête entre les mains, et je ne prononce plus un mot, et je m’en vais avec la peur d’être suivie, d’être obligée de répondre à l’homme qui me suivrait.
Dans un sanglot, ses grands yeux pleins de larmes, la triste fille se tut. Autour de nous, on ne prenait point garde à ce désespoir ; sans doute, on pensait qu’elle était ivre.
Elle ajouta lentement :
- Voilà pourquoi je bois autant que je puis. L’absinthe enroue, le genièvre aussi. Après avoir bu, je n’ai plus le son de parole que j’avais dans le temps. Et, à force d’avaler tout ce qui sèche et brûle la gorge, j’espère bien arriver à ne jamais plus entendre, quand je tire le bras aux hommes de la rue, la voie douce dont j’appelais maman et dont je disais que je l’aimais à mon premier amoureux. »
Le Masque De La Mort Rouge
D’Edgar Allan Poe (1809-1849)
Traduction de Charles Baudelaire
La Mort Rouge avait pendant longtemps dépeuplé la contrée. Jamais peste ne fut si fatale, si horrible. Son avatar, c'était le sang, la rougeur et la hideur du sang. C'étaient des douleurs aiguës, un vertige soudain, et puis un suintement abondant par les pores, et la dissolution de l'être. Des taches pourpres sur le corps, et spécialement sur le visage de la victime, la mettaient au ban de l'humanité, et lui fermaient tout secours et toute sympathie. L'invasion, le progrès, le résultat de la maladie, tout cela était l'affaire d'une demi-heure.
Mais le prince Prospero était heureux, et intrépide, et sagace. Quand ses domaines furent à moitié dépeuplés, il convoqua un millier d'amis vigoureux et allègres de cœur, choisis parmi les chevaliers et les dames de sa cour, et se fit avec eux une retraite profonde dans une de ses abbayes fortifiées. C'était un vaste et magnifique bâtiment, une création du prince, d'un goût excentrique et cependant grandiose. Un mur épais et haut lui faisait une ceinture. Ce mur avait des portes de fer. Les courtisans, une fois entrés, se servirent de fourneaux et de solides marteaux pour souder les verrous. Ils résolurent de se barricader contre les impulsions soudaines du désespoir extérieur et de fermer toute issue aux frénésies du dedans. L'abbaye fut largement approvisionnée. Grâce à ces précautions, les courtisans pouvaient jeter le défi à la contagion. Le monde extérieur s'arrangerait comme il pourrait. En attendant, c'était folie de s'affliger ou de penser. Le prince avait pourvu à tous les moyens de plaisir. Il y avait des bouffons, il y avait des improvisateurs, des danseurs, des musiciens, il y avait le beau sous toutes ses formes, il y avait le vin. En dedans, il y avait toutes ces belles choses et la sécurité. Au-dehors, la Mort Rouge.
Ce fut vers la fin du cinquième ou sixième mois de sa retraite, et pendant que le fléau sévissait au-dehors avec le plus de rage, que le prince Prospero gratifia ses mille amis d'un bal masqué de la plus insolite magnificence.
Tableau voluptueux que cette mascarade! Mais d'abord laissez-moi vous décrire les salles où elle eut lieu. Il y en avait sept, une enfilade impériale. Dans beaucoup de palais, ces séries de salons forment de longues perspectives en ligne droite, quand les battants des portes sont rabattus sur les murs de chaque côté, de sorte que le regard s'enfonce jusqu'au bout sans obstacle. Ici, le cas était fort différent, comme on pouvait s'y attendre de la part du duc et de son goût très vif pour le bizarre. Les salles étaient si irrégulièrement disposées que l’œil n'en pouvait guère embrasser plus d'une à la fois. Au bout d'un espace de vingt à trente yards il y avait un brusque détour, et à chaque coude un nouvel aspect. A droite et à gauche, au milieu de chaque mur, une haute et étroite fenêtre gothique donnait sur un corridor fermé qui suivait les sinuosités de l'appartement. Chaque fenêtre était faite de verres colorés en harmonie avec le ton dominant dans les décorations de la salle sur laquelle elle s'ouvrait. Celle qui occupait l'extrémité orientale, par exemple, était tendue de bleu, et les fenêtres étaient d'un bleu profond. La seconde pièce était ornée et tendue de pourpre, et les carreaux étaient pourpres. La troisième, entièrement verte, et vertes les fenêtres. La quatrième, décorée d'orange, était éclairée par une fenêtre orangée, la cinquième, blanche, la sixième, violette.
La septième salle était rigoureusement ensevelie de tentures de velours noir qui revêtaient tout le plafond et les murs, et retombaient en lourdes nappes sur un tapis de même étoffe et de même couleur. Mais, dans cette chambre seulement, la couleur des fenêtres ne correspondait pas à la décoration. Les carreaux étaient écarlates, d'une couleur intense de sang.
Or, dans aucune des sept salles, à travers les ornements d'or éparpillés à profusion çà et là où suspendus aux lambris, on ne voyait de lampe ni de candélabre. Ni lampes, ni bougies; aucune lumière de cette sorte dans cette longue suite de pièces. Mais, dans les corridors qui leur servaient de ceinture, juste en face de chaque fenêtre, se dressait un énorme trépied, avec un brasier éclatant, qui projetait ses rayons à travers les carreaux de couleur et illuminait la salle d'une manière éblouissante. Ainsi se produisait une multitude d'aspects chatoyants et fantastiques. Mais dans la chambre de l'Ouest, la chambre noire, la lumière du brasier qui ruisselait sur les tentures noires à travers les carreaux sanglants était épouvantablement sinistre, et donnait aux physionomies des imprudents qui y entraient un aspect tellement étrange, que bien peu de danseurs se sentaient le courage de mettre les pieds dans son enceinte magique.
C'était aussi dans cette salle que s'élevait, contre le mur de l'Ouest, une gigantesque horloge d'ébène. Son pendule se balançait avec un tic-tac sourd, lourd, monotone; et quand l'aiguille des minutes avait fait le circuit du cadran et que l'heure allait sonner, il s'élevait des poumons d'airain de la machine un son clair, éclatant, profond et excessivement musical, mais d'une note si particulière et d'une énergie telle, que d'heure en heure, les musiciens de l'orchestre étaient contraints d'interrompre un instant leurs accords pour écouter la musique de l'heure; les valseurs alors cessaient forcément leurs évolutions; un trouble momentané courait dans toute la joyeuse compagnie; et, tant que vibrait le carillon, on remarquait que les plus fous devenaient pâles, et que les plus âgés et les plus rassis passaient leurs mains sur leurs fronts, comme dans une méditation ou une rêverie délirante. Mais quand l'écho s'était tout à fait évanoui, une légère hilarité circulait, par toute l'assemblée; les musiciens s'entre-regardaient et souriaient de leurs nerfs et de leur folie, et se juraient tout bas, les uns aux autres, que la prochaine sonnerie ne produirait pas en eux la même émotion; et puis, après la fuite des soixante minutes qui comprennent les trois mille six cents secondes de l'heure disparue, arrivait une nouvelle sonnerie de la fatale horloge, et c'étaient le même trouble, le même frisson, les mêmes rêveries.
Mais en dépit de tout cela, c'était une joyeuse et magnifique orgie. Le goût du duc était tout particulier. Il avait un oeil sûr à l'endroit des couleurs et des effets. Il méprisait le décorum de la mode. Ses plans étaient téméraires et sauvages et ses conceptions brillaient d'une splendeur barbare. Il y a des gens qui l'auraient jugé fou. Ses courtisans sentaient bien qu'il ne l'était pas. Mais il fallait l'entendre, le voir, le toucher, pour être sûr qu'il ne l'était pas.
Il avait, à l'occasion de cette grande fête, présidé en grande partie à la décoration mobilière des sept salons, et c'était son goût personnel qui avait commandé le style des travestissements. A coup sûr, c'étaient des conceptions grotesques. C'était éblouissant, étincelant; il y avait du piquant et du fantastique, beaucoup de ce qu'on a vu depuis dans Hernani. Il y avait des figures vraiment grotesques, absurdement équipées, incongrûment bâties; des fantaisies monstrueuses comme la folie; il y avait du beau, du licencieux, du bizarre en quantité, tant soit peu de terrible, et du dégoûtant à foison. Bref, c'était comme une multitude de rêves qui se pavanaient çà et là dans les sept salons. Et ces rêves se contorsionnaient en tous sens, prenant la couleur des chambres, et l'on eût dit qu'ils exécutaient la musique avec leurs pieds, et que les airs étranges de l'orchestre étaient l'écho de leur pas.
Et de temps en temps on entend sonner l'horloge d'ébène dans la salle de velours. Et alors, pour un moment, tout s'arrête, tout se tait, excepté la voix de l'horloge. Les rêves sont glacés, paralysés dans leurs postures. Mais les échos de la sonnerie s'évanouissent, ils n'ont duré qu'un instant, et à peine ont-ils fui, qu'une hilarité légère et mal contenue circule partout. Et la musique s'enfle de nouveau, et les rêves revivent, et ils se tordent çà et là plus joyeusement que jamais, reflétant la couleur des fenêtres à travers lesquelles ruisselle le rayonnement des trépieds. Mais dans la chambre qui est là-bas tout à l'Ouest aucun masque n'ose maintenant s'aventurer; car la nuit avance, et une lumière plus rouge afflue à travers les carreaux couleur de sang, et la noirceur des draperies funèbres est effrayante; et à l'étourdi qui met le pied sur le tapis funèbre l'horloge d'ébène envoie un carillon plus lourd, plus solennellement énergique que celui qui frappe les oreilles des masques tourbillonnant dans l'insouciance lointaine des autres salles.
Quant à ces pièces-là, elles fourmillent de monde, et le cœur de la vie y battait fiévreusement. Et la tête tourbillonnait toujours, lorsque s'éleva enfin le son de minuit de l'horloge. Alors, comme je l'ai dit, la musique s'arrêta; le tournoiement des valseurs fut suspendu; il se fit partout, comme naguère, une anxieuse immobilité. Mais le timbre de l'horloge avait cette fois douze coups à sonner; aussi il se peut bien que plus de pensée se soit glissée dans les méditations de ceux qui pensaient parmi cette foule festoyante. Et ce fut peut-être aussi pour cela que plusieurs personnes parmi cette foule, avant que les derniers échos du dernier coup fussent noyés dans le silence, avaient eu le temps de s'apercevoir de la présence d'un masque qui jusque-là n'avait aucunement attiré l'attention. Et, la nouvelle de cette intrusion s'étant répandue en un chuchotement à la ronde, il s'éleva de toute l'assemblée un bourdonnement, puis, finalement de terreur, d'horreur et de dégoût.
Dans une réunion de fantômes telle que je l'ai décrite, il fallait sans doute une apparition bien extraordinaire pour causer une telle sensation. La licence carnavalesque de cette nuit était, il est vrai, à peu près illimitée; mais le personnage en question avait dépassé l'extravagance d'un Hérode, et franchi les bornes, cependant complaisantes, du décorum imposé par le prince. Il y a dans les cœurs des plus insouciants des cordes qui ne se laissent pas toucher sans émotion. Même chez les plus dépravés, chez ceux pour qui la vie et la mort sont également un jeu, il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer. Toute l'assemblée parut alors sentir prondément le mauvais goût et l’inconvenance de la conduite et du costume de l'étranger. Le personnage était grand et décharné, et enveloppé d'un suaire de la tête aux pieds. Le masque qui cachait le visage représentait si bien la physionomie d'un cadavre raidi, que l'analyse la plus minutieuse aurait difficilement découvert l'artifice. Et cependant, tous ces fous joyeux auraient peut-être supporté, sinon approuvé, cette laide plaisanterie. Mais le masque avait été jusqu'à adopter le type de la Mort rouge. Son vêtement était barbouillé de sang, et son large front, ainsi que tous les traits de sa face, étaient aspergés de l'épouvantable écarlate.
Quand les yeux du prince Prospero tombèrent sur cette figure de spectre qui, d'un mouvement lent, solennel, emphatique, comme pour mieux soutenir son rôle, se promenait çà et là à travers les danseurs, on le vit d'abord convulsé par un violent frisson de terreur ou de dégoût; mais une seconde après, son front s'empourpra de rage.
- Qui ose, demanda-t-il, d'une voix enrouée, aux courtisans debout près de lui; qui ose nous insulter par cette ironie blasphématoire? Emparez-vous de lui, et démasquez-le; que nous sachions qui nous aurons à prendre aux créneaux, au lever du soleil!
C'était dans la chambre de l'Est ou chambre bleue, que se trouvait le prince Prospero, quand il prononça ces paroles. Elles retentirent fortement et clairement à travers les sept salons, car le prince était un homme impétueux et robuste, et la musique s'était tue à un signe de sa main.
C'était dans la chambre bleue que se tenait le prince, avec un groupe de pâles courtisanes à ses côtés. D'abord, pendant qu'il parlait, il y eut parmi le groupe un léger mouvement en avant dans la direction de l'intrus, qui fut un instant presque à leur portée, et qui maintenant, d'un pas délibéré et majestueux, se rapprochait de plus en plus du prince. Mais par suite d'une certaine terreur indéfinissable que l'audace insensée du masque avait inspirée à toute la société, il ne se trouva personne pour lui mettre la main dessus; si bien que, ne trouvant aucun obstacle, il passa à deux pas de la personne du prince; et, pendant que l'immense assemblée, comme obéissant à un seul mouvement, reculait du centre de la salle vers les murs, il continua sa route sans interruption, de ce même pas solennel et mesuré qui l'avait tout d'abord caractérisé, de la chambre bleue à la chambre pourpre, de la chambre pourpre à la chambre verte, de la verte à l'orange, de celle-ci à la blanche, et de celle-là à la violette, avant qu'on eût fait un mouvement décisif pour l'arrêter.
Ce fut alors, toutefois, que le prince Prospero, exaspéré par la rage et la honte de sa lâcheté d'une minute, s'élança précipitamment à travers les six chambres, où nul ne le suivit; car une terreur mortelle s'était emparée de tout le monde. Il brandissait un poignard nu, et s'était approché impétueusement à une distance de trois ou quatre pieds du fantôme qui battait en retraite, quand ce dernier, arrivé à l'extrémité de la salle de velours, se retourna brusquement et fit face à celui qui le poursuivait. Un cri aigu partit, et le poignard glissa avec un éclair sur le tapis funèbre où le prince Prospero tombait mort une seconde après.
Alors, invoquant le courage violent du désespoir, une foule de masques se précipita à la fois dans la chambre noire ; et, saisissant l'inconnu, qui se tenait, comme une grande statue, droit et immobile dans l'ombre de l'horloge d'ébène, ils se sentirent suffoqués par une terreur sans nom, en voyant que sous le linceul et le masque cadavéreux, qu'ils avaient empoigné avec une si violente énergie, ne logeait aucune forme palpable.
On reconnut alors la présence de la Mort rouge. Elle était venue comme un voleur de nuit. Et tous les convives tombèrent un à un dans les salles de l'orgie inondées d'une rosée sanglante, et chacun mourut dans la posture désespérée de sa chute.
Et la vie de l'horloge d'ébène disparut avec celle du dernier de ces êtres joyeux. Et les flammes des trépieds expièrent. Et les Ténèbres, et la Ruine, et la Mort rouge établirent sur toutes choses leur empire illimité.
FIN